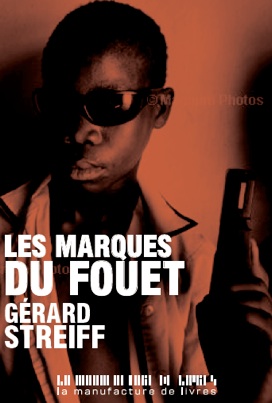Les marques du fouet
Gérard Streiff
SYNOPSIS
François Graffin, dit le Flamand rosse, PDG de TRANSFER, qui gère notamment la ligne Bamako-Dakar, est assassiné au Mali dans des conditions plutôt spectaculaires. Magali, thésarde, et son ami Racine viennent en aide à Tiecoura Traore, cheminot et syndicaliste accusé du crime. Ils plongent en catastrophe dans une société malienne dont ils ignorent à peu près tout. L’étudiante et le libraire vont mener chacun de leur côté l’enquête. Lutte de classes ? Trafic de drogue ? Séquelle coloniale ? Terrorisme ? Vengeance sectaire ? Jalousie de polygame ? Comme toujours en Afrique, les pistes ne manquent pas...
Chapitre 1
« Kayes, Diamou »
L’homme, à terre, marmonne dans une langue étrange, on dirait une incantation vaudoue. De sa bouche sort une suite de sons insensés. Il cherche à se réveiller mais l’effort est trop pénible, il y renonce. Ses lèvres découvrent une langue pâle, tremblent un peu, son corps frissonne puis s’immobilise.
« Galougo, Mahina »
Il continue de baragouiner. Impossible de comprendre ce qu’il raconte, c’est comme un chapelet de formules magiques. Va-t-il se mettre à chanter ? Une litanie s’échappe de lui sans qu’il le décide. Sa tête dodeline, à droite, à gauche. Ses yeux clignotent. Il est couché sur le dos à même le sol. On dirait qu’il est étendu sur une sorte d’échelle, sur des barreaux d’échelle.
« Tioubeta, Oualia »
Il s’ébroue, reprend peu à peu possession de son corps. Il a mal aux épaules, une douleur aigüe, comme si on lui enfonçait une lame dans les omoplates. Ses bras écartés, écartelés le tirent en arrière, bien au dessus de sa tête. Il tente de les bouger, ses poignets restent bloqués, emprisonnés ; c’est à peine si ses mains peuvent palper, de part et d’autre une sorte de barre d’acier. Ses jambes aussi sont prisonnières. Il se contorsionne.
« Fangala, Toukoto »
Il fait chaud. Le soleil est au zénith. Un léger souffle de vent balaie en permanence un brouillard âcre. Des paysans du coin ont l’habitude de brûler les hautes herbes. De la savane carbonisée s’élèvent d’incessants filets de fumée. Le vent n’apaise pas la chaleur. Des particules de poussière se glissent dans le nez de l’homme, dans sa bouche, craquent sous ses dents. Ses yeux se décillent enfin et découvrent un immense ciel gris-bleu. Quelque chose lui enserre le crâne, il ne comprend pas ce que c’est. On l’a affublé d’un chapeau étroit, conique, en feutre rouge, une sorte de tuyau qui lui donne un air ridicule. Dans un mouvement douloureux, il se tord le cou, regarde ses mains, l’une après l’autre puis dresse en tremblant sa tête, regarde son corps, ses jambes. Il est torse nu, pieds nus également. Et ligoté sur une voie de chemin de fer.
« Boulouli, Kita »
Il rugit, trépigne. Ses pieds bougent un peu ; il insiste, secoue ses jambes comme un fou, sent qu’il arrive à distendre les liens. Il crie, il rit, il pleure, il jappe. Ses jambes se libèrent. Il les bouge, les déplie, les replie, comme pour vérifier que ça fonctionne, pour se protéger aussi ; son pantalon s’est défait dans ses contorsions, il tirebouchonne, le voici cul nul.
Les voies sont étroites, à l’africaine, un mètre à peine. « Putains de négros ! » râle-t-il. En Europe, on n’aurait pas pu le coincer ainsi. L’écartement est trop large. Il trouve l’idée presque drôle, ricane, halète, lève encore ses jambes au ciel ; l’exercice entraîne une douleur fulgurante dans les reins, qui lui cisaille le dos, il se laisse retomber, lourdement. Epuisé, il reprend son souffle. Les mains demeurent prisonnières, congestionnées. Il a eu beau secouer la tête, le chapeau tient bon, comme vissé sur lui. Immobile, il finit par entendre un grondement, un peu comme le bruit que ferait un glissement de terrain. Sous lui, ça ronfle, ça grogne. Un fauve ? Non, de l’eau. Il est sur un pont. Il est ligoté sur une voie ferrée qui passe sur un pont. Il n’y a pas 36 ponts dans le coin. On ne doit pas être loin de Bafoulabé, là où le Bafing et le Bakoye se réunissent pour former le fleuve Sénégal. En se martyrisant à nouveau la nuque, il aperçoit le fleuve, tout en bas ; il distingue aussi un bout de rive droite ; une piste en latérite serpente à travers la savane calcinée, comme un trait rouge sur un tableau noir, une balafre.
« Badinko, Kassaro »
Comment est-il arrivé là ? sa mémoire est confuse. Il était, hier ?, en voiture, avec ce chauffeur inconnu, un vieux malien sarcastique. Boubakar, son employé habituel, s’était excusé au dernier moment ; il était retenu par des histoires de famille, prétendait-il, et il lui avait recommandé, imposé serait plus juste, cet ancêtre. Le bonhomme conduisait bien, le problème n’était pas là, mais lui avait horreur qu’on bouscule ses habitudes. Et puis, durant tout le voyage, ce connard n’arrêtait pas de le fixer dans le rétroviseur, silencieux, appliqué.
« Sébékoro, Nafadji »
Des souvenirs lui revenaient, lentement. On était en fin de journée, le chauffeur lui avait proposé de s’arrêter dans une gargote faite de planches et de tôles devant lequel stationnaient plusieurs semi-remorques. Le car qui faisait la liaison Bamako-Kayes était aussi sur le parking. Sur l’enseigne du routier, on lisait « L’Harmattan », en lettres blanches et légèrement baveuses. Cela faisait une bonne heure qu’ils avaient pris la route. D’où venaient-ils déjà ? Où allaient-ils ? Il ne s’en rappelait plus. Le conducteur – il ne connaissait même pas son nom, ou alors il l’avait oublié - dit qu’il avait une petite faim. Lui l’avait suivi. Il y avait dans l’établissement trois ou quatre longues tables avec des bancs. Ils prirent place sous une télé braillarde qui était branchée sur une chaîne de sport. Il n’avait pas faim, il avait à peine grignoté et bu un thé. Une jeune femme les avait abordés. Elle prétendait avoir loupé sa correspondance et demandait si elle pouvait repartir avec eux. Puis elle disparut, de son champ de vision en tout cas. Le chauffeur avait dû l’éconduire. Peu après, ils étaient retournés tous les deux à la voiture.
« Négala, Dio »
La suite ? Le chauffeur a repris la piste, il faisait déjà nuit, on ne croisait pas grand monde, une ou deux motos peut-être, un camion surchargé, c’était tout. Le vieux continuait de le fixer, obstiné, effronté et lui avait dû s’endormir assez vite. Le loufiat l’avait drogué, ce fils de pute avait sans doute blindé son thé pendant que lui était allé au bar ou aux toilettes...
L’homme recommence à hurler, un beuglement interminable mais personne ne l’entend ; ou plutôt si, quelqu’un l’écoute, un chien, plus bas, sur la rive. L’animal lui répond : en écho à sa plainte, il se met à aboyer à la mort. C’est tout ce qu’il a pu attirer dans ce désert, un chien ! Sa propre voix s’effiloche. Comme PDG pourtant, et PDG colon en terre noire, il avait l’habitude de gueuler, contre les noirs surtout, contre les blancs aussi, contre les cadres et les prolos, les fonctionnaires et les planqués, contre Paris ou Bamako ; au fond il gueulait tout le temps et contre tout le monde ; il s’était fait des ennemis partout mais on ne tue pas pour ça, tout de même !
« Kati, Bamako »
Il fait nuit. L’homme a cessé de crier, de gigoter ; il n’a plus de voix de toute façon, ni de forces. Il s’est à moitié démis les épaules à force de gesticuler, ses poignées le brûlent, ses mains sont totalement ankylosées. Il se rappelle qu’il piquait du nez dans la voiture quand le chauffeur, le fixant dans le rétro, lui demanda : « Ça va pas ? » Faux cul ! Putain de faux cul ! Il semblait presque guilleret, le con ! Lui était déjà trop groggy pour réagir.
Soudain, l’homme entravé se fige. Sous le coup de l’adrénaline, sans doute, ses neurones se remettent en place à toute vitesse, lui proposent une explication sur ce vieux chauffeur, son attitude, ses mots, sur son aventure ici... Au même moment, il sent un léger tremblement, une vibration de la voie, qui se prolonge en un début de sifflement, de couinement, lequel se transforme vite en un martèlement avant de devenir un infernal bruit de ferraille, comme une caisse à outils qu’on secouerait en tout sens : il arrive ! Pour une fois, le Dakar - Bamako est à l’heure ; et il a fallu que ce soit aujourd’hui. « Putains de négros ! » L’homme en pisse de peur ; il va hurler mais de sa bouche ne sort qu’un souffle ridicule, un silence étranglé. Il met ses dernières forces à bander son torse, à se dresser, se redresser, à faire barrage ; il sent que le lien qui lui entrave la main droite se détend...
Plus tard, Sissoko Touré, conducteur de la loco 3147, sans doute le seul cheminot albinos de la ligne Bamako – Kayes - Dakar, dira qu’on n’avait vraiment laissé aucune chance au toubab. D’abord, avec ces locos argentines, on freine moins bien et moins vite qu’avant, du temps des bonnes vieilles CC 6500, les recalés du Paris-Lyon-Marseille qui s’offraient ici une deuxième vie et que lui, vétéran du rail malien, regrettait vivement. Mais ses regrets, la direction n’en n’avait rien à secouer. Or donc la voie à cet endroit était pentue. Sissoko Touré dira ensuite que le pont offrait une assez mauvaise visibilité, le convoi y accédait en sortant d’un long virage, et puis des restes de feux de brousse embrumaient toujours le coin. Jour et nuit. Enfin ce pont lui-même l’inquiétait. Chaque fois qu’il y passait, le conducteur priait le ciel, ses saints et ses marabouts pour que ça tienne ; ce pont n’était plus qu’une dentelle de rouille qui restait plantée là par miracle ou par habitude... Chaque fois, il n’avait rien de plus pressé que d’arriver sur l’autre rive ; enfin, le mot « pressé » était une façon de parler car il ne devait pas rouler alors à plus de 30 kilomètres à l’heure, selon le règlement en vigueur. C’est dire s’il ne pouvait être question de stationner là. Bref le blanc n’avait strictement aucune chance, sauf celle de se voir écrasé à petite vitesse, et ceux qui l’avaient attaché là savaient bien ce qu’ils faisaient.
Sissoko Touré dira encore que c’était fou, le nombre d’images qui lui étaient passés par la tête quand sa loco déboucha sur le pont et qu’il vit dans le faisceau de ses trois phares l’Autre tournicoter. L’espace de quelques secondes, il eut le sentiment que le temps s’était arrêté. D’abord, il n’avait pas cru à ce qu’il voyait, mal : s’agitait sur la voie un animal étrange, inconnu dans la région ; il pensa à un girafon bicéphale égaré, voire à un cyclope fantasque, c’est dire son état de sidération ; puis il réalisa que ce qui lui faisait face, ce qui se dressait devant sa machine était tout simplement un cul, un cul nu et un dos d’homme mais à l’envers, les jambes en l’air, la tête en bas. C’était un peu comme si ce type était tombé du ciel la tête la première pour se planter entre les traverses de la voie. Mais le temps d’apprécier, de comprendre, de s’émouvoir, l’autre, qui venait tout juste de libérer sa main droite et tentait désespérément de sauter hors de la voie, passait sous les roues, autant dire au broyeur.
Quand le train s’immobilisa sur la rive opposée, on récupéra un bout de la victime, tout rapetissé, plaqué sous le huitième et dernier wagon, celui des valises et des marchandises ; cette voiture était un peu plus basse de caisse et sans doute ceci expliquait cela ; on pensa que le reste du corps avait fini dans le gouffre du fleuve Sénégal mais des cheminots, un peu plus tard, retrouvèrent, au milieu du pont, dans une petite cavité entre deux traverses, la tête du bonhomme, tranchée net, proprement décapité par le chasse-pierres. La face empoussiérée était toujours surmontée d’un chapeau de feutre rouge qui racontait une drôle d’histoire.
Chapitre 2
Paris, vendredi
Magali est en retard. Elle a rendez-vous avec Racine à treize heure à « La Béarnaise » mais un « incident technique », ils sont désormais quotidiens, l’immobilise sur la ligne 6 du métro... Seul avantage, les voitures sont bloqués sur le pont de Bercy d’où la vue sur la Seine, chaque fois, l’émeut. Une grève des bateliers, du côté du ministère des Finances, bloque aujourd’hui le fleuve. Les péniches, flanc contre flanc ou babord contre tribord, barges de transport chargés de sable, de contenaires ou la cale vide, ou encore résidences bobos, barrent tout le passage. Magali tente de lire le dernier Bialot.
Elle sort d’une réunion de rédaction de la revue « Les Papiers nickelés » qui a traîné en longueur ; comme pigiste elle n’était pas tenue d’y participer mais ce genre de causerie la sortait de son ordinateur et de son tête à tête avec sa thèse. Bingo ! Pour le coup, elle ne regrettait vraiment pas d’être venue. Le journal programmait un numéro sur l’immigration ; tout était calé sauf un reportage sur les expulsés maliens de Sarkozy. Angle d’attaque : « Ce qu’ils sont devenus ? ». Un volontaire ? UNE volontaire ! a-t-elle proposé, levant la main comme à l’école. Pas de concurrence, elle emportait le morceau. Une semaine à Bamako aux frais du canard. Décollage immédiat, ou presque.
Dans le wagon suspendue entre ciel plombé et fleuve grisâtre, cette grande fille androgyne, cheveux blancs -à moins de trente ans !- en brosse ultra-courte, attire les regards ; un voisin pas net veut d’ailleurs « devenir (son) ami » et le lui dit à l’oreille ; elle le fusille du regard, l’autre n’insiste pas. Le train repart, enfin. Elle négocie fissa le changement à Bercy et arrive, à cran, à Bastille.
Devant le restaurant, elle flashe sur la voiture officielle mal garée sur le bateau, face à l’entrée. Elle ne voit même que ça. C’est un véhicule d’ambassade, avec un petit drapeau à bandes verticales verte, jaune, rouge sur l’aile avant-droite de la limousine. Adolescente, elle s’amusait à apprendre par coeur les étendards de tous les pays-unissez-vous qui s’alignaient en ouverture de son dictionnaire mais c’était de l’histoire ancienne. A voir la tête du chauffeur qui s’en grille une sur le trottoir, elle penche pour l’Afrique. Mais il y a plus de cinquante pays en Afrique, elle n’est guère plus avancée. Sans savoir pourquoi, elle sent que cette voiture est là pour elle ; elle pressent l’embrouille. Dépassant son hésitation, elle entre dans le troquet avec l’enthousiasme d’un batelier de la Volga tirant sa barque.
Racine est installé près des cuisines, à la table habituelle. Enfin, c’était la table où ils avaient coutume de se retrouver, à midi, du temps où il était parisien. Son vieil amant intermittent, depuis peu, réside en Afrique où il rêve de monter un réseau de librairies ; l’entreprise n’est pas de tout repos mais il est du genre têtu et ne renonce pas. De passage à Paris pour chercher des appuis, il a tenu absolument à croiser son « ex ». Racine n’est évidemment pas son nom mais la contraction de Raphaël Cineux, libraire. Un quinqua rebondi, jovial et désespéré, ça dépend des jours. Aujourd’hui, il a plutôt sa face allègre. Il n’est pas seul, et ce n’était pas prévu ; en face de lui, un type élégant, trop, un noir, lui parle. Le type de la voiture, à tous les coups.
Racine l’aperçoit, la salue d’un petit geste impatient, le type se retourne.
« Non mais t’as vu l’heure... je te présente...
Un brin maniéré, le black se lève et dit d’une voix douce
« Monsieur Honoré.
Elle réplique tout en prenant place :
« Mais encore ?
« Monsieur Honoré, on va l’appeler comme ça !
Racine résume : il a téléphoné dans la matinée à « Monsieur Honoré », pour des histoires de librairie à Bamako et la conversation a bifurqué sur Tiécoura Traore, le docteur Tiécoura, un ami commun. Il s’est « donc » permis d’inviter le diplomate à partager leur déjeuner.
Tiécoura... Magali l’a croisé, et interviewé, il y a un an, à un salon du livre, à Arras. Le courant est bien passé entre eux. Un polyvalent, ce Tiecoura, cheminot malien mais aussi « docteur » - il est bardé de diplômes-, polyglotte avéré, altermondialiste par conviction et cinéaste par goût, paysan pour survivre et écolo par éthique... un homme curieux de tout. Quand ils s’étaient revus, à Paris, il n’y a pas six mois, il se passionnait alors pour l’élevage des abeilles... Magali se souvient d’interminables discussions sur « sa » ligne de chemin de fer Dakar-Bamako, où il avait travaillé et qui connaissait quelques déboires. Elle s’était promis, elle lui avait promis d’emprunter cette voie un jour.
Devant le silence de ses partenaires, elle relance :
« Il y a un blème avec Tiécoura ?
« Il est en prison.
« En prison ? Pourquoi ?
« Pour meurtre.
« Carrément !
« C’est sérieux, il est accusé d’avoir tué le PDG de Transfer.
« Transfer ?
« La société privée qui gère à présent le train Dakar-Bamako.
« Comment c’est arrivé ?
« Il aurait fait passer son patron sous un convoi.
« C’est absurde. A quand remonte cette histoire ?
« Lundi, enfin dans la nuit de dimanche à lundi. Tiécoura a été arrêté avant-hier, mercredi.
« Il est où ?
« Le patron ? A la morgue, j’imagine.
« Non, Tiécoura.
« A Kayes.
« C’est où ça ?
« C’est vrai que c’est la brousse pour vous...
Honoré prend la mouche, Magali calme le jeu :
« Désolée, je ne connais pas votre pays, c’est tout...
Kayes est la dernière ville en territoire malien sur la ligne Bamako- Dakar.
Surnommée « cocotte-minute », c’est la cité la plus chaude d’Afrique, avec Djibouti.
« Kayes a eu son heure de gloire durant la dernière guerre, intervient Racine : tout près de là, à Médine, au fort de Médine, la Banque de France y a expatrié et caché son or vers 1939-40.
« Beau casse en perspective.
« L’argent est rentré à Paris depuis longtemps.
« Beau sujet de roman, alors.
Racine sert une tournée de Brouilly. Le diplomate sourit à la jeune femme. Une bronca, venue du bar, agite soudain la salle. L’un des clients vient de tomber sur un articulet de France Soir, vantant les vertus du vin rouge pour combattre la crise cardiaque ; il lit le papier à haute voix. Des sarcasmes divers et variés accompagnent son exposé. L’orateur tient bon :
« … on savait que les polyphénols du vin avaient un effet vasodilatateur... »
Ça, on savait en effet, opine son voisin.
« … attendez... via la production de monoxyde d’azote par les cellules endothéliales. Or, maintenant on sait aussi... »
Il fait une pause, ménage ses effets. Miracle : les couperosés du comptoir font silence.
« … or donc, on sait aussi que cet effet vasodilatateur met en jeu un récepteur aux oestrogènes des cellules endothéliales. »
« Fastoche ! » laisse tomber un des piliers du zinc.
Yves, le patron, gabarit modeste mais forte voix, siffle la fin de la récré et fait taire la petite classe, avec des mouvements de menton vers la table de Magali ; il se donne des airs de sherpa couvant les ultimes négociations du G20.
A la table en question, le chargé de mission murmure :
« Je vous parle de Tiécoura sans très bien savoir ce qu’on peut faire pour lui, je ne suis évidemment pas porteur d’une démarche officielle. L’ambassadeur n’est pas au courant de ma présence ici. Simplement, on a été très proches, Tiécoura et moi, dans un autre temps et dans un autre Mali. Mon pays a changé, comme tout le monde, mais on a toujours gardé le contact. Il se trouve qu’il a pu, hier, m’envoyer ce mail ; c’est un appel à l’aide sans le dire, il est bien trop orgueilleux pour ça. Il se dit que plus on parlera de son affaire, mieux ce sera. Monsieur Racine m’a dit que vous le connaissiez...
« Un peu, en effet.
« Alors, voilà, je transmet l’info, comme on dit. Je crois que tout ce qui pourra être fait pour lui sera bienvenu, non ?
« Le hasard, qui arrange parfois bien les choses, on le sait, fait que mon journal m’envoie au Mali, imaginez ! Je peux en profiter pour voir notre ami ?
« Excellent, vous partez quand ?
Magali n’était pas fixée, son billet était « open ». Racine repartait lundi ; il devait reprendre là bas, dans la semaine, ses négociations pour son commerce de livres ; et mener à bonne fin une étude sur le sabar.
« Le quoi ?
« Je t’expliquerai. Tu pars avec moi ?
« Et le visa ?
« Je vous arrange ça ce week end, assure Honoré, le document vous attendra au comptoir de l’aéroport lundi midi.
Yves apporte d’office le plat du jour, une cassolette de langoustines, direct. La tablée s’accorde une pause.
« L’astuce, professe Racine, consiste à briser la carapace au niveau de la seconde articulation et alors là, miracle, non seulement la bestiole s’ouvre mais toute sa chair s’offre à toi... »
Chapitre 3
Bamako, lundi
« Quoi ? vous n’avez pas de vaccin contre la fièvre jaune ? »
L’ample douanier, à l’étroit dans sa chemisette bleu ciel, surjoue l’indignation. Les lumières blafardes des néons de l’aéroport international de Bamako donnent à la salle d’arrivée un air cru. Magali tombe des nues. Honoré ne lui a rien dit sur la fièvre, jaune ou pas ; Racine non plus. Le séjour malien commence bien.
« Je garde votre passeport, désolé ! Allez chercher vos bagages, on verra après ce qu’on peut faire. »
Après avoir récupéré son sac, elle retourne avec le libraire à la guérite du douanier bleu ; celui-ci les présente à un homme sans âge, entre ado et quinqua, en longue blouse blanche, genre apothicaire neurasthénique. L’infirmier les fait entrer dans un minuscule bureau où ils tiennent à peine ensemble, eux debout, face au praticien derrière sa tablette.
« Vous vous êtes fait piquer quand ? » dit-il d’un ton neutre.
Magali commence à argumenter, « Justement, monsieur le docteur, c’est bien le problème... », quand Racine saisit le regard de l’homme noir en blanc. Sourd au discours de la pigiste, ce dernier répète :
« Vous vous êtes fait piquer quand ? »
Et Racine, aussi sec :
« Avant-hier, avant-hier matin ! Elle s’est faite piquer avant-hier matin !
Magali sursaute, Racine la pousse du coude et l’autre sort déjà d’un tiroir un carnet de vaccination standard où il inscrit la date :
« Avant-hier, on était samedi, samedi 9 ?
« C’est cela même.
« Chez qui ?
« Le docteur Mesplède.
Le nom est aussitôt porté à côté de la date. Magali fait la moue mais déjà apparaît dans la main du toubib un tampon aux normes universelles qui vient frapper de légalité le document.
Le placide tamponneur lui tend le certificat :
« Ça fait vingt euros. »
Elle s’exécute puis ils s’extraient du bureau-armoire après une gymnastique compliquée because les sacs boursouflés ; ils récupèrent les passeports et, ainsi normalisés, sortent tout sourire de l’aéroport.
Une vague moite les enveloppe. La nuit est tombée. Un public, curieux et nombreux, est maintenu à distance, familles venues chercher les leurs, vendeurs à la sauvette, vrais mendiants et faux agents de change, flics et chauffeurs de taxis. Et puis des gamins, partout, des ribambelles de mômes, ados, minots, bambins ou presque bébés. Des gosses couleur ébène, des gniards demi noir, des moutards basanés, des moujingues café au lait, des mioches chocolat. Avant de plonger dans cette humanité insistante, le couple s’offre une pause.
Autour d’eux, chaque rencontre donne lieu à d’interminables salutations ; le cérémonial des salamaleks se passe toujours à peu près ainsi :
« Bonjour !
« Bonjour !
« Ça va ?
« Ça va, merci !
« La famille ?
« Ça va !
« La santé ?
« Ça va !
« Les enfants ?
« Ça va !
« L’école ?
« Ça va !
« Les parents ?
« Ça va !
« Le travail ?
« Ça va !
« La maison ?
« Ça va !
« Le grand père ?
« Ça va !
« Le cousin ?
« Ça va !
« Ça va ?
« Ça va !
Le jeu consiste à se répondre à la même cadence, c’est à dire très vite, dans une sorte de ping-pong de politesse, de joute courtoise, de rap de bienvenue, de chapelet de bonjours. Après une courte pause, ça peut rebondir, entre les mêmes, et toujours à un tempo de métronome. Racine se dit que, dans ce pays de polygames, les salutations peuvent être sans fin :
« Alors ça va ?
« Ça va !
« Ta femme ?
« Laquelle ?
« La première !
« Ça va !
« La deuxième ?
« Ça va !
« La troisième ?
« Ça va !
Il trouve ça épatant, il a presque envie d’y jouer avec Magali. Il pense aux salutations, pas à la polygamie. Puis ils entrent dans une foule aussi dense que sur un quai de métro, du côté de St Lazare, en début de journée, quand une voix les surprend :
« Magali ? Madame Magali Et Monsieur Racine ? »
Une femme en boubou et batik, d’un beau bleu nuit rutilant, quadra souriante, belle allure et fesses remarquables, s’adresse à eux. Elle se présente :
« Aminata Tabouré, dit Mimi ; je suis une amie de Tiécoura, je vous attendais. »
Ils sont partis si vite de Paris qu’ils ne disposent d’aucune indication vraiment précise sinon qu’il leur faut rejoindre Kayes pour y retrouver Tiécoura en prison ; il y a juste un train à prendre, ça ne doit pas être sorcier. N’empêche, Mimi tombe bien.
Magali et Racine se laissent faire. On passe au tutoiement. « Ça va ? » « Ça va ! » « La santé ? » « Ça va »... Leur hôtesse récupère sa voiture, une antique Peugeot 504 ; on y enfourne les sacs, le trio s’installe, tout en tenant à distance marchands et quémandeurs entreprenants.
Il y a plusieurs barrières à passer, plusieurs tickets à donner, des codes à connaître avant que le véhicule de Mimi sorte du parking et se glisse sur une quatre voies. Le long du chemin, entre l’aéroport et la ville, l’éclairage public est chiche, laissant à peine deviner une interminable succession de constructions inachevées, maisons basses en dur et cahutes trapues, bricolées en bois et en tôle, devant lesquelles des ombres prennent le thé. Autour de camping-gaz, des commerçants attendent un improbable chaland, des animaux, des chèvres broutent le tout venant, minuscules touffes d’herbe jaunie mais aussi ordures, cartons, sacs plastiques qu’elles mâchent sans entrain. Tout ce monde donne l’impression de vouloir rester sur place, d’attendre que ça se passe, dans une sorte de statu quo avant une nouvelle journée de galère.
Mimi, affutée, plaisante, prend des nouvelles du voyage.
« Il a failli s’arrêter à Paris, le voyage » s’amuse Magali. Ils ont en effet été témoins sur leur vol d’une tentative de rapatriement forcé d’un sans-papier par deux jeunes flics cyniques ; l’affaire a presque viré au pugilat, l’équipage s’est opposé à la manoeuvre, Racine et Magali itou. Les pandores ont menacé les récalcitrants non seulement de rester sur le tarmac mais de finir au poste ! Le ton est monté, le « clandestin » a profité de la dispute pour s’éclipser, provoquant une course poursuite bruyante dans les passerelles, couloirs et autres sas de l’aéroport. Peu après, le capitaine a fait savoir que l’avion avait déjà assez de retard, il n’était plus question d’attendre ; le vol est parti sans les flics et leur « invité ».
Mimi a été prévenue de leur venue par un mail d’Honoré. Elle n’a pas vraiment de nouvelles fraiches de Tiécoura, son dernier appel remonte à jeudi. Magali se présente. Racine précise qu’il connaît un peu Bamako où il ambitionne d’acheter une librairie.
Mimi est documentaliste au « Canard déchaîné ». Il lui arrive aussi de chanter dans un « maquis », c’est ainsi qu’on appelle les bars-restaurants-dancings. La boîte où elle se produit se nomme le « Bolche vita ». Elle fait ça pour son plaisir, pour « crouter » aussi.
« On y va ! sourit leur chauffeur, vous verrez, j’aime la musique cubaine, le blues mandingue. Vous connaissez le mandingue, j’espère ? Ali Farka Touré ? Non ? Amadou et Mariam, alors ? Non plus ? Ils sont pourtant fameux chez vous aussi ! Et Kar Kar ?... Hou la, il va falloir faire votre éducation, les amis ! »
Seule réaction de Racine :
« On joue du sabar chez vous ? Du leumbeul ?
« Oui je vois, monsieur se spécialise ; vous ne connaissez pas le mandingue mais vous vous intéressez au sabar ? Sourit Mimi.
« C’est quoi cette histoire de sabar, s’agace Magali ; ça fait plusieurs fois que tu prononces ce nom sur un ton de conspirateur.
Les deux autres rient, Magali patiente. Un long silence gêné. Puis Mimi explique : le sabar, ou le leumbeul, sont des figures érotiques sur une musique de tam-tam, une gestuelle très sensuelle.
« Ok, je comprends. C’est vrai que venant de Racine...
Ce dernier relance :
« Alors, on en joue, du sabar, au « Bolche vita » ?
« Si vous êtes gentil, peut être... Mais ce soir, ça m’étonnerait.
L’enchevêtrement d’autoroutes et de rocades signalent qu’on entre dans la périphérie de Bamako. Partout des travaux, des chantiers, des aménagements, des grues. Des immeubles modernes, verre et béton, s’affichent bientôt . Mimi en présente les différents promoteurs : « Les Lybiens », « les Saoudiens », « les Chinois ». Ils longent, sur les bas-côtés de la route, d’immenses fresques très réalisme-socialiste, représentant la marche d’un peuple vers un futur assuré et l’alliance indéfectible entre ouvriers et paysans, passent sans transition le pont du roi Fahd sur le Niger et arrivent dans le quartier du fleuve. « On y est ! » La rue du Blabla, où les voitures bouchonnent, est bordée de bars aux devantures décorées de guirlandes de lumières comme des sapins de Noël. Entre deux boutiques, ils passent une porte, empruntent un long corridor d’entrée où s’alignent des têtes de (vrais-faux) colons empaillés, un militaire, un missionnaire, un banquier ; ils débouchent sur la salle de restaurant, à ciel ouvert ; elle forme un amphithéâtre qui descend vers une piste de danse et une estrade pour l’orchestre. Le lieu est en train de se remplir.
« Installez vous, mangez, buvez, je dois travailler, un peu, et je reviens »
Au micro, elle dédicace aussitôt sa première chanson « à mes amis Magali et Racine, tout juste arrivés de France » et interprète « Commandante Che Guevara ! »
Séquence émotion. Et premier repas local. Du poisson, du capitaine fumé avec du riz à la sauce arachide. ils testent la bière locale, comparent la Flag, la Beaufort, la Castel, une belle blonde.
Plusieurs canettes plus tard, un gros type lunetté et souriant invite Magali à danser. Elle minaude un peu puis se laisse faire. Le gaillard glisse sur la piste avec la souplesse d’un vieux rat du Bolchoï et sa partenaire ronronne de plaisir en lui collant au train. Ça se frôle, se contourne, se touche, s’éloigne, s’effleure à nouveau, ça ondule, ça sourit, de vrais pros ! Un moment seule, la compagne du danseur, une longue noire élégante, tailleur sombre et strict, escarpins discrets, un petit côté secrétaire perverse, vient à son tour inviter Racine. Elle ne dit pas un mot, se contente de lui tendre les bras en souriant ; il tente de se défiler, fait le pitre, gesticule, bredouille des excuses mais l’autre reste plantée devant lui, prête à tenir le siège. Il capitule au moment où l’orchestre entame un blues interminable ; on a réduit les lumières au strict minimum. La fille, look d’intello, plutôt sobre, pas de bijoux ou presque, irradie un parfum camphré absolument déroutant. Elle continue de sourire, imperturbable. Racine pense que c’est à cause de sa maladresse mais la dame semble goguenarde de nature. Bizarrement, ce détachement lui plaît. Le slow s’éternise, le couple se tait, un rêve passe.
Au milieu de la nuit, Mimi réussit à s’éclipser ; elle entend conduire ses deux invités parisiens à l’hôtel, près de la gare, en traversant le centre ville. Les rues, étroites, sont bondées. Sur les avenues, la circulation est infernale.
Comme ces bancs de poisson ou ces nuées d’oiseau qui sortent en bandes, se dispersent pour se retrouver aussitôt, une noria de motos de marque chinoise s’agglutine à chaque carrefour avant de s’éparpiller quand le feu passe au vert. Parfois, le conducteur est seul, le plus souvent il a invité sa petite famille sur son deux roues. Très souvent aussi, il transporte des bidons, par grappes, des dizaines de jerrycans mystérieusement assemblés les uns aux autres et pouvant constituer une gigantesque corolle au sein de laquelle disparaissent presque l’homme et sa machine. A l’arrière d’un bus, des femmes voilées s’entassent alors que, sur le pare-choc du véhicule, un préservatif, gonflé comme un jambon de Bayonne, est accroché et virevolte, dans l’indifférence générale. Sur les trottoirs, la foule dégage une double sensation de sensualité et de rigueur, ou de rigueur sensuelle. Dans des échoppes minuscules, le coiffeur côtoie le forgeron, le restaurateur jouxte le fripier, le chaisier s’affaire près d’un marchand de riz. Des gens assis sur des sacs ou accroupis tentent encore de vendre un peu de tout, shampoing ou café, fruits ou ustensiles de cuisine, fausses chaussures de marque ou vraies bananes frites, cigarettes au détail ou moumoute pour volant de voiture. « De la médecine par terre, comme on l’appelle ! Fait remarquer Mimi, montrant des petits monticules de cachets et autres tas de médocs, plaquettes de pilules ou ampoules, tous périmés. Je vous déconseille d’y toucher ! » La nuit est bien entamée mais on dirait que la ville entière continue de commercer.
Mimi aide ses invités à changer de l’argent chez un marchand libanais. Apparemment l’oriental fait dans le sanitaire ; ses baignoires, bidets et autres carrelages occupent deux étages d’un grand immeuble en coin mais, dans son bureau, il joue aussi au banquier. C’est en quittant son magasin, gardé comme un château-fort, que Magali fait remarquer que leur voiture est suivie. Par une moto. Depuis le départ du maquis.
Chapitre 4
Bamako, lundi
« Des motos ? Mais il n’y a que ça, s’amuse Racine, repensant à un antique sketch de Fernand Reynaud. Magali laisse dire, insiste et désigne une « Jakarta ». Sur cette Vespa gris métallisé, deux passagers les regardent en effet avec insistance. Le conducteur est un jeune homme, chemise blanche ouverte sur un torse nu et turban indigo à la touareg.
« Ils sont repérables, les gus ! à croire qu’ils le font exprès. Et puis, bonjour le casque ?! S’étonne Racine.
− Z’aviez pas remarqué ? Tique Mimi, personne n’en porte ici ! Paraît que ça déforme la coiffure ?! C’est sérieux, c’est ce qu’on dit ?! Les filles n’en veulent absolument pas. Résultat : à chaque accident, les mômes tombent comme des mouches ! Faut dire que le code de la route, ici...
− Et les flics laissent faire ?
− Pire, ils en rajoutent parfois. L’autre jour, j’ai vu un policier mettre une contravention à un toubab parce que l’autre avait mis sa ceinture ! Sérieux ! Le toubab fait un scandale, le fric riposte : si vous mettez une ceinture, c’est que vous êtes pas sûr de votre conduite ! »
Face au musée national, ils s’arrêtent devant une statue de groupe. Le mémorial représente cinq soldats, noirs, solidaires, des combattants de la guerre 14/18. L’armée noire. « La réplique de ce monument existait à Reims » s’enthousiasme le libraire. « Les nazis l’ont détruite en 40. Supportaient pas. Avoir été battus par les poilus était déjà pénible pour eux mais des poilus noirs ?! Ça les démangeait trop ! Z’aiment pas trop la couleur, les fachos ?! »
Un groupe de minots s’approche d’eux, parle fort, chahute, sautille. Celui qui se donne des airs de chef est borgne, l’oeil gauche est mort, formant comme une coque blanc-ivoire. Magali croit l’avoir aperçu sur la moto de l’enturbanné, lequel en effet est seul à présent sur son engin.
« Pas au lit à cette heure ? Tente Racine, en père fouettard. Déjà à l’aéroport, y avait des mômes partout.
Selon Mimi, la ville abrite une armée de gamins à l’abandon :
– Sont sans abri. Ils squattent, bricolent, chapardent, survivent.
Racine demande à Mimi et Magali de se tenir sous la statue. Le temps de prendre une photo, il pose son sac à dos. Les mômes l’entourent. Un vendeur de montres passe par là. « Toubab, achète moi une montre... » dit le borgne. « T’habite Paris, toubab ? Amène moi avec toi là bas, s’il te plaît ! » ajoute-t-il. La « Jakarta » refait son apparition. Elle s’approche de l’attroupement, le frôle de manière provocatrice et s’éloigne en pétaradant. C’est comme un signal. Le groupe d’enfants se disloque, chacun part de son côté, court, disparaît. Le sac de Racine aussi. Avec ses papiers, le passeport, l’argent, la carte bleue, le billet retour, le portable et le dernier roman de Mondoloni. Le libraire réalise un peu tard, rugit et se met en chasse des mioches, suivi de Magali ; Mimi reste près de sa voiture.
Ils tombent vite sur la foule ; ils ont beau crier, demander qu’on s’écarte, ils se trouvent face à un mur. Il faut dire qu’entre les vendeurs à la sauvette, les échoppes et le public, les lieux sont vite congestionnés. Et puis les passants ne semblent guère motivés à courser les garnements. La poursuite est vaine. Les titis se sont évanouis, comme la moto, et le vendeur de montres.
« Bienvenue à Bamako ! Regrette Mimi qu’ils rejoignent bientôt. Au fait vous savez ce que ça veut dire, Bamako ? Le marigot du caïman... Ici, il ne faut pas laver le poisson là où on l’a pris.
« Traduction ?
« Bin, il faut être prudent.
« Merci du conseil !
La documentaliste conduit ses hôtes à « l’Hôtel du buffet de la gare ». Au cours du trajet, le trio se tait. La gare est un majestueux bâtiment en pierres de taille rouges. Au fronton est inscrit, en lettres d’or, Dakar-Niger. Mais l’immeuble est dans l’ombre, le palais est désert ; on dirait que la gare n’est pas, ou n’est plus, à sa place. Des groupes de villageois, d’enfants -encore, des familles dorment sur les trottoirs des alentours.
« Avant, on se bousculait ici, en permanence. De jour, de nuit, à longueur d’année, toute une foule de cheminots, de paysans venus en ville, de marchands, de voleurs aussi s’y côtoyait. La gare était le coeur de la ville.
– Avant ?
– Avant la privatisation, quand le trafic voyageur fonctionnait correctement. Ce que vous voyez n’est qu’un pauvre vestige de la splendeur passée !
L’hôtel jouxte la gare. Devant le portail stationne un jeune gardien ; il les invite à passer dans une vaste cour. A gauche, un restaurant, fermé à cette heure. A droite, un patio, qui a dû être une ancienne piste de danse ; des gens, des employés sans doute, dorment à la belle étoile, sur le sol ou les parterres. Au fond, éclairé, un immeuble d’un étage avec les chambres.
« On se bousculait aussi ici, ajoute Mimi qui poursuit sa présentation nostalgique ; c’est ici que Salif Keita – vous voyez qui c’est tout de même- ils opinent, penauds- a fait ses débuts de musicien, à 20 ans, dans un orchestre nommé « Rail band ». C’était en 1969 ! »
Le trio fait le point. Racine a tout perdu ; il comptait bien accompagner Magali à Kayes mais le voilà contraint de rester à Bamako et de passer à l’ambassade, pour signaler le vol, refaire des papiers provisoires ; ces démarches peuvent prendre quelques jours ; il est exclu qu’il prenne le train lundi. Trop court. Magali doit y aller seule. Mimi va faire en sorte que quelqu’un l’accompagne à la gare, demain, enfin tout à l’heure.
Les chambres de Magali et de Racine sont sobres ; ils se rendent visite, comparent, plaisantent. Les lits sont vastes, les meubles improbables, le sol carrelé est inégal ; la salle d’eau semble figée, comme si un événement s’était passé là, il y a longtemps, dans un temps entre les temps. L’ensemble est propre et désuet. Une lucarne, qui s’ouvre à peine, donne sur les voies et des luminaires orangées ; on entend, au loin, une loco à la manoeuvre, crissement des roues, choc des tampons, soupirs des voitures. Les chambres sont climatisées, il y fait frais mais la clim fait un boucan d’enfer ; un énorme moteur, dans le couloir, gros comme une turbine d’avion, alimente le courant d’air froid. C’est efficace mais cela fait un tel vacarme qu’on a l’impression de dormir dans le ventre d’un 747. Magali tente de faire avec, se bouche les pavillons avec du papier journal mouillé et mâché mais, vaincue finalement par le bruit, elle descend supplier le gardien d’arrêter la machine. Plus tard, elle va rêver qu’elle est dans le parc d’un hôpital, découvre dans un miroir qu’elle a le teint d’un vieux citron ; une rangée de poilus, noirs, en longues capotes militaires, crottées de boue, assis sur un banc, leur casque sur les genoux, la regardent et rient d’elle car elle a la fièvre jaune.
Chapitre 5
Bamako, mardi
Pour Magali, la nuit a été courte, entre le fracas des ventilateurs, l’attaque des moustiques et ses penchants insomniaques. Bref elle se lève à cinq heures du matin. Des filaments de jour se pointent à peine. Il fait déjà chaud. Dans la cour de l’hôtel, un vieil homme maigre, flottant dans un boubou fatigué, vient de finir sa prière et range son tapis. Ce fantôme, souriant et édenté, l’aborde avec un évident plaisir :
« Tiécoura, ça c’est un Monsieur ! »
Il sait manifestement qu’ils sont là, Racine et elle, pour tenter d’aider son ami, sinon pourquoi lui aurait-il dit cela ? Le vieux ajoute simplement :
« C’est bien ce que vous faites ! »
Magali ne fait pas de commentaire, elle sent que les informations ici circulent selon des voies originales et impénétrables. Sans doute Mimi...
L’ancien se présente :
« Diop dit Diop le fou ou Diop le malin ou Diop le fauché, tu choisis ! »
On est passé au tutoiement. Dans la foulée, il lui tape 500 francs CFA pour s’offrir des brochettes au marché en face de la gare. Magali préfère un petit déjeuner classique, café en poudre, brioches, beurre et confiture, au restaurant de l’hôtel qui ouvre juste ses portes. Une télé est déjà branchée dans la salle déserte, où palabre le chef d’Etat d’un pays voisin. La tête de l’officiel occupe l’écran pendant tout le repas. Béret de para, lunettes noires, chemise kaki, le personnage enfile les perles, accumule les « constitutionnellement, les « organiquement », les « substantiellement » ; il a tout l’air d’un petit tyran sec qui aime se gargariser de suffixes. La jeune femme retrouve peu après Diop dans la cour. Le jour s’est levé, les ombres qui dormaient là cette nuit ont disparu.
Diop a envie de bavarder. Elle se laisse faire. Il regarde la tenue chiffonnée de la jeune femme, chemise de toile froissée, pantalons à poches et à plis, puis ses propres vêtements :
« Tu sais, ici, si tu ne portes pas un grand et beau boubou, tu n’es pas considéré, c’est dommage, non ? »
Elle résiste à l’envie de lui répondre que le boubou ne fait pas le moine.
Il dit encore que « c’est sur les arbres touffus que se posent les oiseaux » mais que lui ne court pas après les riches, il se méfie des apparences et sait reconnaître les vrais amis. Bref, Magali a fait bonne impression à l’aïeul. Ce dernier fait partie des 600 cheminots licenciés, il dit « déflatés », du franglais, en 2003 par Transfer, le nouveau propriétaire privé ; il vit toujours près de la gare ; les trains sont sa seule famille. Chaque matin, à heure fixe, alors qu’il a été viré comme un malpropre et que les locaux peuvent rester déserts des jours entiers, faute de trafic voyageurs, il vient ouvrir la grille d’accès pour les passagers, balaye le grand hall, bichonne les trois guichets de caisse, en fait de minuscules ouvertures dans un immense mur carrelé, permettant juste de passer la main pour échanger argent et billet. Chaque soir, Diop ferme les portes qu’il a été parfois le seul de la journée à franchir.
Il raconte l’histoire du train. Sa construction a été une affaire de militaires et de gros sous mais la ligne apporta la vie aux villages, du travail aux artisans, des affaires aux commerçants, elle organisa le pays « comme une colonne vertébrale ». Les gens en étaient fiers ; et les cheminots constituèrent une élite, combattive : ils firent grève en 1947, « la première grande grève africaine, tu savais ça ? »
Mais le titre de gloire de Diop, son bâton de maréchal, son « opus magnum », c’est sa rencontre, à la gare, il était encore apprenti, avec le Che ! En personne. LE Che Guevara. En chair et en os. L’Argentin, et Cuba également, avaient de bons rapports avec le président malien de l’époque ; il était venu à Bamako, avait rencontré les cheminots, notamment ; ce déplacement avait fait fantasmer les voisins sénégalais ; ils imaginaient déjà la révolution s’exportant via le train bourré de guérilleros et ils menacèrent de fermer la ligne ; une sacrée visite, qui fit du binz mais les choses ne sont pas allées plus loin.
Vous vous appelez comment, au fait ?
« Magali Dutriez.
« Dutriez ? ça me dit rien ; je vais vous appeler Camara, d’accord ?
« ?!
« Camara, viens voir ! »
Il lui fait visiter la gare et ses dépendances ; le site occupe, dans le centre ville, un immense territoire, fait de bureaux, d’ateliers de construction, de réparation, d’entretien, de petites maisons cheminotes aussi. Des hectares de terrain à présent souvent désaffectés. Le lieu semble déserté, un vrai crève-coeur. Restent des annexes commerciales mais ce qui a dû être une vraie ville dans la ville, toute dédiée au train, est à l’abandon ; des bâtiments sont squattés par des familles misérables, des marchands de bois encombrent les voies avec des amas de troncs d’arbres ; des carcasses de wagons finissent de se déglinguer ici ou là... Diop fait un peu le pitre pour parler de « sa » ville mais on le sent meurtri.
« Camara, une amie de Tiécoura. Journaliste ! » : cette présentation, chaque fois, fonctionne comme un sésame auprès d’anciens, de cheminots qui passent par là, des syndicalistes en réunion, de quelques commerciaux. Les gens se confient, disent leur rage de voir le site ainsi saboté.
La matinée se passe en une longue déambulation nostalgique. Au retour, Diop presse le pas quand ils longent les toilettes de la gare. Le lieu est « hanté » dit-il simplement. Devant l’ étonnement de Magali, il bredouille quelques mots : suicide, toubab, il y a longtemps... Puis il se tait, pour de bon.
Chapitre 6
Bamako, mardi
Racine a passé la matinée à l’ambassade pour sa déclaration de vol des papiers, l’obtention de documents provisoires. A son réveil, Magali était déjà partie ; il ne compte pas la revoir de sitôt, son train pour Kayes est prévu à midi. Mimi le récupère à la mission française à l’heure du déjeuner. Cette hôtesse plantureuse trouble le libraire ; elle porte aujourd’hui un jeen et un tee-shirt à l’effigie de Bob Marley, encadrée par la devise de l’artiste « Non à la mentalité d’esclave ! ». Un manifeste ambulant et diablement rebondi qui invite Racine chez elle, dans le quartier Badialan, près du stade Konate, carré Badalabougou.
La traversée de Bamako est ralentie par des bouchons un peu partout. Quand il entend la conductrice lui dire : « on va bientôt arriver, c’est la deuxième carré à gauche et le premier goudron à droite », il est moyennement étonné ; il sait déjà que goudron veut dire rue goudronnée et carré un pâté de maisons.
« Il faudra qu ’un jour j’écrive l’histoire de mon carré, sourit Mimi. C’est un vrai village, le carré Badalabougou, tout le monde connaît tout le monde, tout le monde s’occupe du voisin, de ses histoires privées autant que professionnelles ». En se garant, elle désigne la maison voisine. La famille Coulibaly.
« Les Coulou comme ont dit. Tu me diras, la moitié du Mali s’appelle Coulibaly mais ici, on a droit à un Coulibaly spécial. Mamadou Coulibaly. Ce chef de famille est un modeste vendeur de coca sur les marchés du quartier mais il est très honorablement connu. 65 ans, 3 femmes, 25 enfants, c’est un assidu à la mosquée, qui est suffisamment apprécié pour être sollicité par les voisins en cas de conflits de famille, entre couples, entre parents/enfants, etc... Tu vois le genre ! Un petit notable, quoi ! Or notre Coulou à nous depuis un mois se cache. Pourquoi vas tu me dire ?
« Oui pourquoi ?
« Parce qu’il est rongé par la honte, figure-toi ; il n’ose plus sortir de chez lui. Dans la journée en tout cas. On raconte que la nuit, parfois, on peut le voir errer, ombre furtive et malheureuse. Car tu dois savoir que notre Coulou, donc, était aussi réputé comme chasseur. Il lui arrivait très régulièrement de quitter, seul, la maison, l’après midi, un fusil à l’épaule, toujours dans sa gaine, pour chasser. Car on peut chasser autour de Bamako, c’est vrai, sans s’éloigner trop de la ville. Et il ne revenait jamais bredouille. A croire que les animaux de la forêt environnante venait à la rencontre de ses coups. Il prétendait connaître des incantations magiques qui attiraient les bêtes sauvages, même de très loin. Il avait aussi l’habitude de dépiauter sur place ce qu’il attrapait, sans doute dans un abri connu de lui. Bref, il ramenait régulièrement des canards plumés, des lièvres ou de petits chevreuils vidés. Ses retours de la chasse donnaient toujours lieu à une petite cérémonie dans ce carré, tout le monde félicitait l’heureux homme et lui, le coeur sur la main, n’hésitait pas à partager le gibier avec l’un ou l’autre de ses voisins. »
Mimi s’arrête au stand du marchand de fruits ; il y a des régimes de bananes aux couleurs variées ; finalement elle opte pour des mangues et semble faire trainer en longueur son histoire, par pur plaisir.
« Sa gloire était bien établie, donc, jusqu’à ce jour, l’affaire remonte à moins d’un mois, où l’on vit revenir notre brillant chasseur solidement encadré par deux jeunes et immenses bergers. L’un d’eux l’avait surpris en train de « préparer » un mouton, pauvre bête solitaire qu’il avait tout simplement subtilisée au troupeau, égorgée et dépouillée. Pris de panique, Coulou avoua tout. Ses parties de « chasse » n’étaient qu’une comédie ; il se contentait de traîner autour des fermes proches, il capturait ce qu’il pouvait (poules, canards, cochons de lait, moutons), tout ce qui trainait un peu à l’écart, il les vidait et jouait ensuite la grande scène du chasseur chanceux. Le quartier avait été dupé. Les bergers, eux, ne s’en étaient pas laissés compter. Sur le chemin, ils avaient malmené leur voleur qui, soit dit en passant, ne savait absolument pas se servir de son fusil ; ce n’était qu’un objet purement décoratif qu’il exhibait pourtant fièrement, mais sans jamais le sortir de son fourreau. Drôle d’histoire, non ?
« Et comment elle a fini ?
« Grâce à l’intervention de ses amis, Coulou a évité de justesse la prison mais, en guise de premier dédommagement, les bergers ont obtenu un chèque de son fils aîné ; ils ont promis de revenir, sans doute accompagnés cette fois de fermiers des environs qui ont aussi à se plaindre d’étranges disparitions... Alors, tu vois, depuis cette histoire, notre Coulou se cache au plus profond de sa chambre. Et ses proches, accablés, longent les murs.
Mimi part d’un rire énorme, Racine lui s’étonne :
« Il y a un truc que je comprends pas : comment tous ses amis ont pu être trompés si facilement par ces forfanteries ? Et puis, peut-on vraiment ne pas reconnaître du gibier par exemple ? Le lièvre, c’est pas du lapin, non ?
Elle retrouve aussitôt son sérieux.
« Tu as raison, tu as complètement raison. Que répondre ? Pourquoi on a rien vu, moi y compris même si je suis moins souvent dans le quartier, avec mon travail ? On a rien vu par ignorance, par complaisance, par indifférence ? Je sais pas. En tout cas, depuis quelques jours, on essaie, à quelques uns, de convaincre Coulou de retrouver ses voisins, de se rendre à nouveau à la mosquée, de se montrer quoi, de sortir de son isolement. Mais pour l’instant, ça sert à rien, il nous répond à peine... Je te raconte tout ça mais ça doit rester entre nous, les Coulou vivent mal cette histoire et s’ils apprenaient que je l’ai racontée à un toubab...
Dans la cour, une ribambelle d’enfants leur font fête.
Ils gagnent la demeure de Mimi, murs bleu nuit, sol carrelé de tommettes rouge ; les meubles, rares, sont recouverts de housse, des instruments de musique traînent autour d’une impressionnante chaîne Hi-Fi ; elle propose sans transition le menu :
« Un poulet yassa, ça va ?
« Ça va.
L’hôtesse met Racine à contribution : moutarde, persil, ail, citron, à lui la marinade. Pendant que le poulet mijote, Mimi lui demande, goguenarde, ce qu’il sait du sabar. Racine, très solennel soudain, prétend qu’il rédige un article sur l’érotisme chez les musulmans, au Mali notamment.
« Il fut un temps où on parlait de tout ça sans problème, assure-t-elle, selon le précepte « la haya¹ fi-ddin » (« pas de honte en religion »). Il y avait même des « cours publics de sexualité » dans les mosquées. Il en était aussi question dans des manuels sur l¹acte amoureux, les traités de science, de droit, de médecine... »
Racine n’entend pas être en reste et cite Avicenne, auteur de L¹Épître du désir, qui encourageait à soigner par l¹amour ; inspiré, il aligne des textes libertins, le « Jardin amoureux » du Damascène Ibn Qayyim al-Jawziyya, le « Jardin parfumé » du Tunisien Nafzaoui, les recettes amoureuses de l¹Égyptien Tifachi ou les anecdotes d¹Abou Nawas.
« Tu sais que Nawas préférait les garçons ? Oui, tu le sais ? L’homme est un continent, la femme est la mer, moi j’aime mieux la terre ferme, disait-il »
« Peut-être, mais il chantait l’amour, non ? Et j’ai pas fini mon topo ; n’oublions pas les contes des Mille et Une Nuits. T’as pas vu la version de Pasolini ?Avec ce héros qui n’en finit plus de courir après sa « Zoumouroud »...
« C’est du passé, Racine ! Les Mille et une Nuits, même Pasolini et son Zoumouroud, du passé, t’entends ?! Aujourd’hui, si tu parles de positions, de recettes, d’amulettes pour jouir, mais on te regarde de travers, je t’assure ! Le sexe n’est pas très à la mode en ce moment. La tendance, maintenant, ce serait plutôt d’expurger ! Vive la pudibonderie et la fatwa. Et l’hypocrisie surtout ! Parce que le sexe est là mais on regarde ailleurs... »
« Je peux te dire qu’il y a pire que le Mali en matière de pruderie, heureusement pour vous, s’amuse le libraire. Il m’arrive lire votre presse : des histoires chaudes, des échos de cocus, de coucheries et compagnie, des histoires de jaloux, j’en vois partout. Tous les jours. Et ça me rassure...
Il montre un numéro récent du journal « L’essor » où un grincheux brocarde l’infidélité des femmes au Mali.
« Parce que, bien sûr, seules les femmes sont infidèles, râle Mimi.
« Reconnais, camarade malienne, que côté séduction, vous savez y faire. Tiens, parle moi du wusulan !
« Camarade Racine, on ne parle pas du wusulan, on le sent. On verra ça au dessert, ok ? Si t’es sage...
Comme promis, après le repas, Mimi propose une petite démonstration de la puissance du wusulan, de l’encens, dont « les effluves déclenchent le désir chez l’homme » comme on dit.
Elle aligne un petit attirail de coffrets, de boîtes, de paniers, de boulettes d’oliban et de résines, un encensoir (« wusulan bêlé », dit-elle, professorale). Et entame sa conférence :
« Il y a wusulan et wusulan, mon cher ; si tu veux parfumer la maison, tu prends du guéni ou du gowé, des boules macérées dans du parfum ; si le sol est humide, l’odeur restera plus longtemps.
Racine hume, apprécie.
« Si tu veux parfumer tes vêtements, tu prends du magnokisêni ou sarkhatan ; tu poses tes affaires dans un panier en osier au dessus de l’encensoir...
Elle se livre à une nouvelle démonstration, les narines de Racine s’agitent comme deux petites ailes affolées, comme si elles tétanisaient.
« Sais tu ce que disait mon homonyme ?
« Le vrai Racine ?
« Exact. Il disait, dans Esther :
Puissent jusques au ciel vos soupirs innocents
Monter comme l’odeur d’un agréable encens. »
Long silence. Racine rêvasse. Mimi conclut :
« Si maintenant l’objectif est de séduire un homme...
« Par exemple, admet le libraire.
« Là, chacun a ses méthodes, ses mélanges, ses dosages ; moi par exemple j’aime recouvrir les braises de mon encensoir de cendres tamisées, ni trop, tu vas l’asphyxier, ni trop peu, il ne remarquerait rien ; une dose juste.
Racine se perd dans les fumerolles de Mimi, il s’égare entre toutes ces fragrances ; il vole, plane, voyage ; le vertige le prend. Cette mise en bouche le laisse plus que songeur. Toutes ces effluves le désarment, l’envoutent, le voilà charmé, au sens propre. Mais la réalité se rappelle à lui ; la rue, tout à coup, l’intrigue. Il lui faut un peu de temps pour échapper aux arômes de sa magicienne et comprendre que la ruelle, jusque là à peu près vide, est en train de connaître une tension inhabituelle. Par la porte grande ouverte de la cour, un grondement ininterrompu arrive à ses oreilles. Après l’ouïe, la vue. Des cortèges de manifestants en effet ne cessent de passer. Assez volontiers barbus. Mimi traverse la courette et interroge un des passants qui lui confie qu’un rassemblement islamique est prévu au stade voisin. Un meeting de protestation contre le nouveau code de la famille. Le sujet faisait la Une de la presse depuis quelques jours. Les manifestants, des hommes, se montrent très remontés contre cette nouvelle législation à en croire leurs banderoles. Ils y maudissent ce texte qui serait une insulte au Coran ; l’une d’elles clame : « La civilisation occidentale est un péché » ; une autre dit « Non à ce code qui divise les Maliens ». Mimi peste :
« Colère de machos ! Le nouveau code prévoit le mariage des filles à 18 ans alors que la coutume permet de les épouser dès leur 13 ans ! Tu piges ?
Racine n’a pas besoin de dessin et s’étonne de cette illustration subite, in vivo, des propos qu’ils viennent de tenir pendant le déjeuner. Un défilé de Tartuffe, se dit-il. Puis, brusquement, le voilà qui sursaute, se lève d’un bond et se précipite vers la ruelle ; il vient de repérer, sur les abords de la manifestation, le jeune borgne de la veille.
Chapitre 7
Bamako, mardi soir
Le train a une demi-journée de retard, un détail. Le départ était prévu à midi, il est près de vingt et une heures. Magali pense prévenir Racine puis elle se souvient qu’il n’a plus son portable. Et elle n’a pas noté celui de Mimi. La nuit est tombée ; les voyageurs commencent à peine à s’installer. Les horaires sont inscrits à la craie sur de petites ardoises à l’entrée de la gare ; la méthode, flexible, s’adapte mieux à la souplesse du timing et à l’improvisation ambiante.
A la mi-journée, Diop a accompagné « Camara » jusqu’au train pour Kayes. Commença une interminable attente. D’heure en heure, le moment du départ était repoussé. Son cornac finalement s’éclipsa, il avait à faire dans « sa » gare : « On ne peut pas courir et se gratter les pieds en même temps » s’excusa-t-il. Elle s’était aperçue, tout au long de la matinée, que le vieil homme adorait placer dans la conversation des proverbes, dont les messages n’étaient d’ailleurs pas toujours évidents, du genre : « Celui qui te conseille d’acheter un cheval ventru ne t’aidera pas à le nourrir » ou encore « L’homme sage jette son bâton s’il veut que son chien vienne à son appel ».
Avant de filer, Diop la présenta aux gens du convoi, si bien qu’elle finit par connaître tous les employés des différents wagons et eut tout loisir d’inspecter les voitures. Elle était un peu déçue : elle s’était laissée dire que c’était le Mistral qui faisait la ligne Dakar-Bamako. Le Mistral ?! L’ancien PLM, Paris-Lyon-Marseille, avec sa loco au blason rouge sur le ventre, une CC 6500 sans doute, et ses voitures aux portières automatiques, aux stores électriques, son couloir latéral donnant sur un alignement de fenêtres, ses compartiments de huit places en carré, ses sièges rebondis-boursouflés couleur vert sombre, parfois éventrés mais toujours surmontés, entre le filet et le porte-bagage, des fameuses photos noir et blanc, dans leur cadre de fer, des châteaux de la Loire ou du Mont St Michel ; des clichés d’Azay le Rideau, de Chenonceau ou de Chambord en pleine savane, ça devait valoir le déplacement ! Magali se demandait ce qu’un paysan peul allant vendre ses arachides au marché voisin avait bien pu penser de ces « maisons » françaises ? Elle avait fréquenté dans sa jeunesse ce train mythique pour descendre sur la Côte d’Azur et quand il lui arrivait de visionner de vieux films, comme « La mariée était en noir » de Truffaut, où Jeanne Moreau traversait furtivement son vieux Mistral, elle s’offrait un arrêt sur image. Mais même ici, le PLM avait fait son temps. Les voitures à présent viennent d’Inde, trapues, fonctionnelles, « modernes » ; le compartiment offre deux rangées de sièges, en skaï bleu-nuit, avec un couloir central, une cinquantaine de places au total, une batterie de ventilateurs au plafond ; on a heureusement retiré les barreaux des fenêtres ; la loco, elle, est argentine ; à l’évidence, c’est du matériel d’occasion qui entame ici une deuxième vie.
Vers 21h, donc, le départ semble s’annoncer. Dans le wagon prennent place des couples, des familles retournant au village, des bana-bana, commerçantes avec des grappes d’arrosoirs ou des sacs d’agrumes ; l’une tient un coq par une ficelle à la patte ; la plupart des passagers sont en boubou ; les femmes portent des batik savamment entortillés autour de la tête. Les vêtements sont dans des couleurs pétantes, jaune citron, vert vif, bleu nuit, violet ardent.
Vers l’entrée du wagon, un petit mouvement de foule marque la venue d’un notable. Arrive un quinqua, chauve, le teint mat, petites lunettes rondes, un visage à la Gandhi, habillé à l’européenne, un costume fripé couleur sable. Sa place se trouve à quelques rangées de celle de Magali. Avant de s’installer, il vient cérémonieusement la saluer :
« Madame Magali Dutriez, je présume ? »
Cette dernière se dit que décidément tout le monde la connait à Bamako. Elle ne sait pas si elle doit s’en féliciter ou s’en inquiéter.
« Madame Magali, j’ai entendu parler de vous. Je savais que vous étiez arrivée au pays, soyez la bienvenue ! Mes « oreilles » m’ont assuré qu’on serait dans la même voiture, elle ne se sont pas trompées... Commissaire Papa Séga, celui que les journalistes, vous savez comment ils sont, surnomment l’épervier du mangrove ! Appelez moi papa, ça ira !
Magali songe in petto à cette vieille blague idiote du missionnaire débarquant sur une plage d’Afrique, justement. Salué par un enfant qui l’appelait le monsieur-en-robe, il dit : Appelle moi « Mon père ». Et le gamin de répondre : C’est maman qui va être contente, elle pensait que tu ne reviendrais jamais !
Indifférent à la rêverie de la jeune femme, le commissaire présente son aide :
« Issiaka Dembelé, le meilleur élément de ma brigade des recherches ! »
L’élément en question est l’exacte réplique de son patron, un ghandi-bis, le mimétisme des carriéristes sans doute, sauf qu’il est en boubou et autant le chef semble jovial et emphatique, autant lui se montre distant, discret ; il regarde Magali de travers, lui tend à contre-coeur la main puis retire précipitamment sa pogne comme s’il venait de se brûler au contact de la toubab.
« On remonte à Kayes, ajoute « papa », pour interroger une nouvelle fois le docteur Tiécoura ; il est mal barré, votre ami Tiécoura, car c’est votre ami, n’est-ce pas ?
− C’est mon ami en effet et il est innocent.
− Vous jouez au billard, madame Magali ? Balance le flic du tac au tac
« Pas vraiment, non.
« C’est dommage ; vous sauriez qu’aux trois bandes, pour marquer le point, il faut parfois en faire des détours...
Papa laisse passer un silence afin que la jeune femme digère la sentence ; puis, rond mais décidé, il poursuit :
« Vous pensez peut-être qu’en Afrique, on ne sait pas mener une enquête ?
« Pas du tout ! Pourquoi me dites vous cela ?
« J’ai mon idée. Voyez vous, ici, pour enquêter, c’est pas comme à Paris !
« Sans doute.
« Ma technique, madame Magali, elle est là.
L’homme se saisit à pleine main le nez qu’il avait assez menu :
« Vous avez compris, ici, il faut du pif et rien que du pif ! »
La voiture est presque remplie ; le policier, dans le couloir, gêne le passage mais cela n’a pas l’air de le déranger beaucoup.
« Vous croyez, comme on est en Afrique, qu’on travaille avec des méthodes de barbares ?
« Non, vraiment... commence-t-elle.
« Vous vous trompez, la coupe le flic tout en regardant son adjoint ; vous savez, moi, un suspect, je le ménage. Par exemple, je ne lui tape jamais sur les mains, jamais ; il peut m’arriver de lui frictionner la tête, oui, le tronc, peut-être, les jambes, pourquoi pas, mais les mains, JAMAIS. Et vous savez pourquoi je ne touche jamais aux mains ?
« Vous allez me le dire, je le sens !
« Parce que je respecte les doigts de l’homme ! »
Et il s’esclaffe, imité par son aide de camp. Le duo s’éloigne et finit par s’assoir, toujours secoué par des saccades de rires .
Magali ne sait que penser du pékin. Butor ? Retors ?
Par la fenêtre, elle voit en queue de train une vingtaine d’hommes, installés de part et d’autre du wagon de fret, qui poussent à la main la dernière voiture pour l’accrocher au convoi ; un projecteur inonde la scène d’une lumière très crue, les hommes et la machine s’y découpent comme des ombres chinoises.
Vers 22h, le train part, enfin, sort peu à peu de la ville, longe une série de terrains de football éclairés où se livrent des matchs acharnés. Magali contemple les dribbles, petits ponts, grands ponts, tacles et autre tirs au but quand elle entend :
« Vous permettez ? »
Une jeune femme, en jeen et tee shirt à la gloire d’Obama, un ordinateur portable sous le bras, désigne à côté d’elle la seule place restée libre.
« Je vous en prie...
La nouvelle venue doit avoir à peu près son âge. Dans un commun mouvement, elles se regardent, toutes deux intriguées.
« On se connaît ? Dit l’historienne.
L’autre hésite, sourit. C’est là que Magali réagit :
« Le « Bolche vita » ? Hier soir, non ?
« C’est à dire...
« C’est pas vous qui avez réussi à faire danser mon ami ?
« Le toubab aux pieds de plomb ? Mais oui... ça alors !
« Félicitations ! Moi je n’ai jamais pu...
« Il a encore quelques efforts à faire mais j’ai connu pire. En fait, il bouge pas mal mais il se laisse pas assez aller..
Elles s’amusent. Magali relance :
« Otez moi d’un doute : je parie que vous savez qui je suis !
« Là je vous trouve prétentieuse !
« Vous ne connaissez pas mon nom, vraiment ?
« Ou mégalo !
« Excusez moi, je dois vous paraître idiote, en effet, mais j’ai eu l’impression aujourd’hui que tous les gens, tous les Maliens que je rencontrais en ville connaissaient mon identité ; pour le premier jour de mon premier séjour dans ce pays, c’était plutôt troublant, vous savez.
« Hé bien, je vous rassure, je ne sais pas qui vous êtes !
Amusé, Magali se présente. La fille, elle, s’appelle Fernande Bandiaga.
Chapitre 8
Bamako, mardi soir
Traversant la chaussée occupée par une foule enfiévrée, Racine se précipite sur l’adolescent. Il lui saisit le bras et le tire violemment hors de la procession. Pris au dépourvu, le garçon est cette fois facile à attraper. L’altercation passe quasiment inaperçue dans le capharnaüm ambiant. Simplement, une fillette qui semble accompagner le jeune borgne refuse de le laisser partir seul et le suit, docile.
Le garçon résiste, grogne, proteste mais Racine est survolté. Sa poigne doit faire mal à l’enfant. « Mon sac ? Où est mon sac ? » Arrivé dans la cour, la porte refermée sur la rue, le mendiant s’attend à être frappé mais il reste digne, limite méprisant. Mimi le houspille, en bambara, en peul, en songhaï. Il garde le silence, sa petite compagne itou. Où est le sac ? Le jeune reste muet. Une bonne heure, adultes et enfants s’affrontent ainsi, en vain. Le libraire crie, le garçon est coi. Racine change de registre, la joue copain. Rien. Il finit par trouver l’argument qui fait céder le garçon :
« Tu me réponds et je te trouve une Jakarta ! »
Ça lui est venu comme ça, d’un coup. Mimi est sidérée. Lui même se dit que ce n’est pas très moral et c’est sans doute cher payer mais il n’a pas le temps de finasser. Sa proposition, son marchandage plutôt, fait mouche, le gosse semblerait prêt à tout pour une Vespa.
« Vraiment ?
Allélouia, il parle. Et il est piqué au vif.
« Vraiment !
« Je te crois pas.
« Sur la tête de ta mère !
« M’a abandonné, ma mère !
« De ton père !?
« Jamais vu.
« De Mimi ?
Le gosse sourit, un peu. Mimi aussi. Et la fillette également.
Le jeune voleur se présente : il s’appelle Macky le lynx ( Racine n’ose lui demander s’il a UN oeil de lynx) ; la fille, à qui pourtant personne ne demandait rien, qu’on avait presque oublier, enchaîne et ajoute : « Moi, c’est Bic rouge ». Ils habitent, ils squattent plus exactement, avec d’autres enfants, le premier étage d’une maison inachevée près des Halles. Au rez-de-chaussée traîne toujours une fille fofolle dont tous les hommes du coin abusent.
« ?!
Mimi confirme :
« On dit ici que faire l’amour avec une folle porte bonheur, absolument ; ça te garantit la chance dans tes entreprises, ça assure ta prospérité...
Les enfants survivent en pratiquant des petits boulots ; de temps en temps, ils travaillent pour un faux marabout qui s’appelle Oumar.
« Oumar comment ?
« Oumar Keita.
« C’est le type à la Jakarta ? au turban bleu ?
Exact. L’homme est un féticheur. Il vend sur les marchés de la poudre de perlimpinpin, des amulettes, des bagues, autant d’objets de pacotille censés porter chance, soigner du diabète, vaincre la stérilité.
« Et ça marche ?
« Ses gris-gris ?
« Non, son commerce ?
Le bonhomme est un bon vendeur. Sur tous les marchés de la région, on peut le voir, micro à la main, un boa indolent autour du coup, faire l’article, prononcer des incantations mystérieuses, puis piocher ses bricoles dans un grand sac avec des airs de conspirateur qui troublent le client.
« Ça part comme des petits pains...
Les gens achètent. Pour garder le mari. Pour chasser le mauvais sort. Pour gagner à la loterie. Le type contrôle une colonie d’enfants et exploite cette cour des miracles avec de faux estropiés et de vrais mendiants ; il les oblige à placer ses talismans ; il exhibe aussi sur la place publique des jumeaux, des albinos comme des êtres rares. « L’opéra de quat’sous » à la mode Bamako.
Le charlatan circule beaucoup mais chaque nuit, il rentre dans la maison inachevée dont il occupe la terrasse.
« Cette nuit, on pourrait lui mettre la main dessus, le plus souvent, il est seul, estime « Oeil-de-lynx ».
Mimi connaît la rue du squat ; avec Racine, ils décident d’opérer une descente cette nuit. Les enfants peu à peu baissent la garde, ils se confient. Restée discrète, « Bic rouge » explique qu’elle a gagné son nom à l’école ; de toute sa classe, elle avait en effet la copie la plus surchargée d’annotations et son prof corrigeait au stylo rouge. Mais si elle a fui l’établissement, ce n’était pas à cause des fautes ; elle avait peur en fait de se faire lutiner.
« Lutiner ?
« Comme les copines !
« Pourquoi ?
« Fallait y passer si on voulait de la promotion scolaire.
« Mais tes parents ?
« Quels parents ?
Macky le lynx, lui, avait été enlevé à sa famille, volé pour être vendu. Il y a des années de cela, alors qu’il habitait un village de l’Est malien. Il avait finalement réussi à échapper aux pillards mais il n’avait jamais retrouvé les siens. Et depuis il galérait.
Tous deux aujourd’hui « travaillent » pour le marabout mais ils offrent aussi leurs services au tout venant. Ils ne sont pas vraiment délinquants, toujours limite. Il leur arrive de jouer au « privé », version lilliputienne. Des cocus, ou des inquiets, ils sont nombreux en ville, leur confient par exemple la surveillance de leur femme pendant leur absence. S’agit de les prendre en filature et de raconter ensuite au jaloux.
« Surveiller leur femme ?
« Vraiment !
L’avant-veille encore, ils espionnaient la femme d’un mari soupçonneux. Marchand de bois, il avait fait mine de partir en province mais s’était terré en fait dans un maquis de la capitale. Les enfants gardaient un oeil sur l’épouse ; ils ont vite repéré la venue d’un jeune homme pressé qui était bien sûr l’amant. Ils ont prévenu le cornu, un simple coup de téléphone. L’autre est revenu illico. Affolés, les amants se sont enfermés dans leur chambre ; le propriétaire, surexcité, est passé par le toit, qui n’était qu’une mince cloison et il l’a éventrée consciencieusement ! Ce cinéma ! Tout le quartier en a profité.
« On n’a pas encore été payés pour cette surveillance. Le mari était trop énervé ! Ajoute Bic-rouge.
On rit, on bavarde, on se restaure. « Oeil-de-lynx » demande si sa Jakarta pouvait être de couleur noir, il préfèrerait.
« On verra » tempère le libraire.
A deux heures du matin, ils se rendent en voiture dans la rue du squat, pas très loin du quartier des ambassades et pourtant à des années-lumière des avenues cossues. Une rue sans nom et sans éclairage. Mimi se gare assez loin de la maison inachevée pour ne pas alerter ses habitants. Ils stationnent devant une ancienne école, que Racine, seul à posséder une torche, inspecte par pure manie : le lieu attend d’être rénové, c’est ce qu’annonce un grand panneau fatigué en façade, mais les donateurs doivent se faire désirer, l’édifice semble à l’abandon. On devine un instant une enfilade de salles vides donnant sur la rue, avec quelques chaises renversées le long des murs, des armoires vitrées avec de vieux livres, des manuels. Sur les battants tirés de ce qui semble être la plus grande salle, un animal est attaché à un piquet. C’est un bouc. Régulièrement, soit pour marquer son agacement, soit pour jouer de ses cornes, la bête donne un violent coup de tête dans la porte ; le choc fait un bruit formidable, amplifié par l’écho de cette immense pièce déserte. C’est un vrai coup de tonnerre mais cette tempête est si régulière que tout le quartier semble vivre avec, comme une horloge monstrueuse.
Le squat se trouve un peu plus loin, il est complètement dans le noir. Le marabout a établi son quartier général dans une tente au second étage, en fait une simple dalle entourée d’armatures de fer dressées de loin en loin. Le quatuor s’apprête à grimper les marches qui ne sont pas équipées de rampes et donnent sur le vide quand un bruit étrange leur parvient du rez de chaussée. Les visiteurs comprennent vite que quelqu’un est en train de soumettre la fofolle à ses caprices libidineux ; ils vont passer leur chemin quand les soupirs du violeur retiennent puis pétrifient les enfants ; ils jureraient avoir reconnu la voix du marabout.
Avec moult mimiques, ils en informent Mimi et Racine. Tous, lentement, s’approchent de la « chambre » où le couple copule ; les couinements qui s’en échappent sont de plus en plus sonores et les enfants à présent sont assurés qu’il s’agit bien du gourou. Ils pénètrent tous les quatre en même temps dans la salle, Racine de sa torche envoie un pinceau de lumière en plein sur la bête à deux dos, « en califourchon » ; la flaque lumineuse surprend deux visages ahuris, la face hideuse du dominant et la tête de gorgone de la violée tournées dans un même mouvement d’effroi vers les intrus. Au même moment, sans doute estomaquée par la laideur du spectacle, « Bic rouge » se met à hurler, un cri strident, grinçant, à mi chemin entre un rire hystérique et une vocifération de terreur. Ce face à face ne doit durer que quelques secondes mais, pour tous les participants, il semble s’éterniser.
La violence de cette scène, surtout pour le couple, entraîne aussitôt une conséquence imprévue : Massaran, dite « la mass », la fofolle, est tellement saisie, elle a si peur qu’elle réalise une très sévère contraction vaginale, emprisonnant du même coup le sexe de son partenaire ; la verge de ce dernier est coincée, pressurée dans un étau. Prisonnier l’un de l’autre, le duo semble condamné à l’accouplement éternel. Le marabout a beau se démener, il ne peut échapper au piège ; il hurle, « la mass » rugit, la scène tourne au cauchemar. Racine fait sortir les enfants, moins par pudeur car ils ont déjà eu abondamment l’occasion de contempler les ébats de leur voisine mais pour éviter que le féticheur ne les reconnaisse. Les enfants rejoignent le squat ; on entend vite, à l’étage, un remue ménage et c’est un interminable défilé d’orphelins qui dégringolent la volée de marches et viennent reluquer le tyran à terre puis s’éparpillent dans la nuit en éclatant de rires.
« Vaginisme aigüe, diagnostique, très professionnel, Racine. Resserrement réflexe des muscles du plancher pelvien, ajoute-t-il en examinant la forme remuante à ses pieds.
On dirait un mandarin en pleine conférence, livrant son commentaire blasé à un public d’internes narquois ou ébaubis.
« Mon sac ! Finit-il par demander au marabout scotché. L’autre a trop le sens du rapport de forces pour mégoter, il avoue aussitôt où se trouve la cache, dans l’immeuble même. Racine récupère son bien. Il laisserait volontiers le charlatan dans sa drôle de geôle mais Mimi veut libérer la jeune femme.
« On laisse pas « la mass » ici. Elle vient avec nous.
« Comment tu veux faire ? On serait obligé de prendre l’autre avec, comme un paquet cadeau ?!
« On les sépare.
« Solution ?
« Un toubib, une piqure. Et c’est bon.
« Un toubib, à cette heure ?
« Mon ex. Il me doit ça.
Elle téléphone, réveille le médecin. Effectivement, il accepte de venir.
« Après, on fait quoi de « la mass » ?
« Je sais pas mais on la sort d’ici ; on devrait trouver un moyen d’assurer sa prise en charge .
Un petit bruit les tire de leur échange : affaissé sur la fille, résigné, mortifié, c’est le marabout qui pleure.
Chapitre 9
Sur la ligne Bamako-Keyes
( nuit de mardi à mercredi)
Le train est parti pour de bon. Il a déjà fait halte dans deux petites gares. Aucun éclairage des quais n’est assuré. L’obscurité est totale. On entend des éclats de voix, des torches tremblotent ici ou là, mais tout est précipité, confus. Des visages apparaissent, encadrés par la lumière des fenêtres des wagons, puis s’effacent ; on devine plus qu’on ne voit une foule à chaque arrêt, passagers, vendeurs de fruits ou de boissons et aussi, en retrait, une masse de curieux, silencieuse ; il est très tard mais le passage du train fait événement, les riverains ne veulent pas rater le spectacle. On est sans doute venu de loin pour l’occasion, pour voir, pour vendre une babiole, pour acheter aussi peut-être.
Quelques voyageurs descendent, beaucoup montent, des femmes en majorité, certaines avec leur bébé alors que tous les sièges sont pris depuis le départ. Les billets ont dû être vendus deux fois ; et puis les gens, ne sachant pas quand passera le prochain train, acceptent de s’entasser dans le couloir et dans les entrées, entre sacs de riz et seaux d’arachide, volailles et fagots de bâtonnets de cure-dent, du tamarinier ou du cola ; ceux qui ont pu se coucher dans la travée centrale doivent se relever ; ça râle un peu puis ça bavarde et ça plaisante.
« C’est jolie, Fernande, et c’est rare ! » sourit Magali.
« Vous trouvez ? C’est mon père qui a voulu, moi j’aime pas trop ; il était projectionniste dans un cinéma de Bamako ; il voulait même qu’on me prénomme Fernandel.
« Vraiment ?
« Je vous jure ; en hommage à un comique blanc des années cinquante.
« Oui je vois ; en tout cas, vous êtes plus jolie que lui !
« Merci ! Heureusement, ma mère a résisté ; alors ils ont fait affaire sur Fernande. Remarquez, il y a pire, j’ai une un amie qui se prénomme dictature.
« Sans blague !
« Pas du tout. En hommage à la dictature du prolétariat, assurait son père. Fallait le vouloir, non ?
« En effet ! Moi, Fernande, ça me fait plutôt penser à Brassens, un poète français.
« Il a écrit quelque chose sur elle ?
« Un joli texte, oui, vous ne connaissez pas ?
« Non, vous pouvez me le réciter ?
Magali hésite, s’excuse :
« Une histoire de mecs, attention ! Ne le prenez pas mal. Je me souviens juste du refrain.
Elle chantonne doucement :
« Quand je pense à Fernande
je bande, je bande... »
La jeune malienne pouffe. Magali est rassurée.
Par moments, le train ne doit guère dépasser le trente à l’heure ; la journaliste avait été prévenue, n’empêche, ça fait drôle. Elle a compris que les lumières du wagon vont rester allumées toute la nuit. Les gens autour d’eux parlent assez fort, rient volontiers. Les fenêtres des voitures projettent le long de la voie des écrans lumineux qui arrachent furtivement à l’obscurité des pans de savane. Elle regarde vaguement ces bas-côtés, espérant y croiser les yeux de braise de fauves en chasse, ou en rut, mais ne défile qu’un interminable fouillis végétal.
Fernande est enseignante – stagiaire à l’école centrale d’administration, elle termine une étude sur la société Tranfer qui...
« qui gère la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako », place Magali.
« Vous êtes au courant ? »
Elle se rend à Kayes pour son mémoire ; elle devait y rencontrer le patron du groupe, François Graffin. Le pdg est mort mais elle a maintenu son voyage, elle espère pouvoir grappiller des informations au siège de la société. Magali fait l’ingénue :
« Il paraît qu’on a déjà arrêté le coupable ?!
« Le docteur Tiécoura, oui, je sais. Mais c’est un peu étonnant. Le bonhomme est un militant, un teigneux de la lutte des classes...
« Comme le papa de « dictature » ?
« Je ne sais pas, si vous voulez, mais de là en faire un tueur...
« Le policier là-bas, pourtant – elle désigne leur voisin- , monsieur l’épervier de je ne sais plus quoi... , y croit dur comme fer, lui.
« Papa Sega, oui, je l’ai reconnu, en effet. Sega, vous savez, il a le sens du vent, c’est tout.
« Mais encore ?
« Il a la réputation d’être un bon flic mais il n’aime pas les surprises. L’air du temps pense que c’est Tiécoura ? Embarquons Tiécoura ! C’est pas le genre à trop afficher des idées personnelles ; il dit ce qu’on dit, point. Vous connaissez sa devise ?
« ?!
« Flicus unus, flicus nullus !
« C’est du bas latin, ça ; et ça veut dire ?
« Qu’un flic seul avec ses théories, ça vaut pas tripette ! Au fait, on dit toujours « tripette » chez vous ?
« On dit !
« Bref il suit le courant, l’épervier, ou plutôt le vent ! Il se laisse porter !
« Conclusion ?
« Si le courant s’inverse, il s’adaptera !
Magali repense au commissaire et à son histoire de billard.
Sa voisine a l’air d’en connaître un rayon sous ses airs de novice. Elle n’ose pas lui demander d’où elle tient tout ça. Il faut savoir garder des sujets de conversation pour plus tard. Fernande continue :
« Graffin avait beaucoup d’ennemis ici ; il venait du nord de la France, de Béthunes ou de Hazebrouck, une ville de Flandres. Vous savez comment on le surnommait ?
« ??
« Le flamand rosse !
« Pas mal.
Le type avait racheté en 2003, pour pas grand chose, le Dakar-Bamako.
« Comme le reste du monde, le Mali est passé au libéralisme. Les nôtres aussi ont voulu faire du fric, vite, avec tout et n’importe quoi, sur les conseils du FMI et d’autres banques du même acabit. On a privatisé peu à peu tous les biens publics. Ce fut le cas de cette ligne. »
Obama, sur le tee-shirt, semble s’être replié entre les deux seins haut perchés de Fernande ; cette contraction lui allonge simultanément le crane et le menton. La stagiaire le remarque, tente de redonner au président une tête un peu plus digne mais le résultat n’est pas convaincant.
« Le Flamand, lors de l’achat, a promis de se soucier des passagers et des riverains ; en fait il s’en fout ; il veut faire du fret, du fret et rien que du fret ; la voie sert surtout aux trains de marchandise, au transport de minerais. Ça, ça rapporte. Et pour ça, il n’a pas besoin de beaucoup de cheminots. Les voyageurs ? ils peuvent aller se rhabiller. Résultat : il ferme des gares, licencie le personnel, balaye toute expertise. Un vrai sabotage. Il s’est mis beaucoup de monde à dos.
Nouvel arrêt et toujours l’obscurité dehors puis l’apparition, le surgissement de jeunes villageoises aux fenêtres, pour proposer de l’eau, des gâteaux, des brochettes, du poisson séché, des fruits, des cigarettes, des canettes. Dès que le mouvement du train cesse, l’air redevient tiède. Fernande est lancée :
« Les passagers, les riverains ne sont pas contents ; il y a moins de gares, moins de trains, tout l’arrière pays s’asphyxie ; le rail était souvent le seul moyen de bouger. Le Flamand a contrarié aussi les autorités ; celles ci ont toujours déclaré que la privatisation ne changerait rien pour les gens ; elles mesurent que c’est un fiasco et prétendent n’y être pour rien ; elles accusent volontiers « Transfer » de tous les maux ; dans la concession qui lui a été accordée, disent les ministres, la société devait entretenir le trafic passager. Faux ! dit l’autre. En fait personne n’a jamais vu ce texte. Dans mon mémoire, je l’appelle d’ailleurs « l’immaculée concession »
Magali apprécie, ajoute :
« On pourrait dire aussi : « Rail noir et chèque en blanc »
Selon Fernande, même dans son milieu, le Flamand était détesté. Il avait bâti un empire avec des méthodes de tueur. La société de Graffin truste les moyens de transport dans toute l’Afrique de l’ouest : le train du Congo-Kinshasa ? C’est lui. Le port de Lomé, au Togo ? Lui encore. Les bateaux d’Abidjan ? Lui toujours. Chaque fois, il emporte – il emportait- le morceau avec un cocktail de pistons, de menaces, de magouilles. Il y a quelques semaines, il a même réussi à avoir la peau de son concurrent de toujours, un ex associé devenu son principal rival dans la région, Gauthier Durand-Drouhin. Ce dernier, longtemps bien en cour dans toutes les Présidences du coin, est devenu du jour au lendemain le pelé, le galeux, l’infréquentable. Frappé de plusieurs mandats d’arrêt, il s’est réfugié en Espagne. Il y a ouvert un blog où il raconte en long et en large les turpitudes du défunt patron de « Transfer », ses pratiques auprès des ministres, ses chantages, ses menaces de mort, avec photocopies à l’appui, dont celles de factures scabreuses.
« Si j ’étais « l’épervier », je regarderais de ce côté là plutôt que vers Tiécoura » conclut la jeune femme.
Le train vient de s’arrêter, après plusieurs secousses, comme agité par la danse de St Guy, ou comme s’il était soudain monté sur des roues carrées. Ça ne ressemble pas vraiment à une halte ordinaire ; une rumeur court la voiture : on serait en panne. Fernande ne semble guère étonnée :
« Vous voyez, je vous le disais, c’est une honte ; on ne sait jamais quand les trains partent ; quand ils partent, ils doivent céder la priorité au fret ou alors ils tombent en panne ; c’est le cas une fois sur deux ; et encore, ça pourrait être pire, il y a trois semaines il a déraillé, on a parlé d’une demi douzaine de morts, des jeunes gens restés debout entre deux voitures... Je vous le dis, depuis que le train est privatisé, c’est le bordel. »
Un employé se faufile non sans mal dans l’allée centrale, l’air hyper affairé. Il confirme que la loco est HS et la panne sérieuse. Fernande peste, prend à partie, en bambara, le cheminot qui n’en peut mais. Puis elle regarde Magali :
« Je vous ennuie avec mes histoires ?
« Pas du tout, pourquoi vous dites ça ?
« Vous vous endormez...
Magali se vexe :
« Excusez, j’ai eu une petite nuit, je tangue un peu mais c’est rien. »
La fenêtre grande ouverte donne sur les ténèbres et le silence. A quelques mètres du train, pourtant, des lucioles semblent alignées sur une vingtaine de mètres. Magali s’amuse à les compter … et s’endort. A son réveil, le jour se lève ; le train n’a pas bougé, il est toujours à l’arrêt, au beau milieu d’un village de cases rondes en banco, briques crues d’argile mélangé à de la paille et du sable, et au toit de chaume. Chaque maisonnette donne sur une cour bordée par une palissade de branchages. Ce qu’elle a pris cette nuit pour une rangée d’insectes lumineux sont les bouts rougeoyants de cigarettes ; de jeunes villageois sont assis le long de la voie, sur un banc étroit et interminable et fument en silence. Toute la population mâle du coin est là. Sereine et contemplative, elle attend, regarde le train qui regarde les autochtones.
Entre les deux passe et repasse un vieux mendiant à demi nu, les cheveux longs, le corps maigre, court, poussiéreux, marmonnant pour lui même. Il s’est harnaché de fer, rouillé, oxydé, colliers de clous dans les cheveux, têtes de marteau autour du cou, pièces de métal sur les bras, un fer à repasser accroché à la taille, une chaîne de vélo fixée aux jambes. Tout cela doit peser son poids. L’homme pourtant déambule sans montrer d’efforts particuliers. Que veut-il dire avec sa mise en scène ? Qu’il porte une cuirasse ? Qu’il mime une sculpture ? Qu’il vénère le dieu Fer ? Qu’il exhibe sa richesse ? Ou qu’il est sous les fers ? Le plus étonnant, c’est que cette apparition ne semble intéresser personne. Le seul visiteur de marque, ce matin là, c’est le train.
De nombreux passagers sont descendus. « L’épervier » est en pleine discussion avec des hommes imposants en boubou coloré ou en sahariennes couleur tabac, devant un marchand qui fait griller des pièces de mouton. Fernande côtoie des villageoises qui improvisent un feu pour préparer du thé. Magali la rejoint. Sans transition, la jeune malienne poursuit la discussion de la nuit :
« Notez, c’est peut être aussi une histoire de coeur.
– De cul ?
– Oui, de fesses. François Graffin était un libidineux de première. Du moins il avait cette réputation. Il y avait toujours derrière lui une batterie de poules de luxe. Longtemps il s’entoura de nigérianes, ce sont des expertes, vous savez ? »
Magali n’a pas d’opinion sur la question.
« Mais ces derniers mois, il s’était mitonné une garde rapprochée malienne, alors que jusqu’ici la prostitution n’était pas trop dans nos moeurs. Il y a eu quelques marabouts pour s’émouvoir publiquement de cette débauche, l’un d’eux est même allé jusqu’à menacer le Flamand de mort ; je crois qu’il a eu des problèmes avec la gendarmerie.
– Graffin ?
– Non, le marabout. Vous ne m’écoutez pas ? Ou vous n’êtes pas vraiment réveillé ?
L’homme de fer continue de tourner autour du train ; il se plante devant chaque toubab, il doit y en avoir une demi-douzaine sur tout le convoi ; il ne quémande pas vraiment, il se montre, c’est tout ; son air farouche dissuade Magali de le déranger ; elle aurait pourtant bien aimé savoir ce que voulait dire son attirail. Est-il un homme de fer ? A-t-il une santé de fer ? Une poigne de fer ? S’impose-t-il une discipline de fer ?
« Reste les barbus ?
« Quels barbus ?
« Z’êtes pas au courant de l’actualité ?
Dans le nord du pays, les islamistes ont monté une filiale d’Al Quaeda, Al Quaeda du Maghreb (AQMI) ; ils doivent être entre deux et trois cent mais ils savent faire parler d’eux. Les cadres sont Algériens, ils viennent de la guérilla du FIS et se sont réfugiés dans la zone du Sahel, les troupes sont de plus en plus africaines. Aujourd’hui, ils se recyclent dans la prise d’otages occidentales, un business qui marche bien. S’ils ne sont pas nombreux, ils sont très mobiles, avec 4x4 dernier cri, moyens de communication sophistiqués et armes en pagaille. Ils sillonnent l’interminable désert, de la Mauritanie au Niger, où ils sont quasi introuvables.
« Quel rapport ?
« Je ne sais pas. Ils ont pu vouloir kidnapper Graffin et la chose aurait mal tourné ? Ou peut être lui faire payer un « impôt révolutionnaire » ? Avec sa mort, ils montreraient aux « gros » qu’ils entendent taxer qu’il ne faut pas rigoler avec eux ?
En somme, pour Fernande, Graffin n’avait que des ennemis mais une presse « officielle » a tout de suite négligé toutes ces pistes et désigné Tiécoura comme le coupable idéal. Viré de Transfer il y a quelques années déjà, il avait gardé dans l’opinion une bonne cote ; un temps isolé des salariés, il a retrouvé leur confiance avec la dégradation de la situation de la firme ; les luttes ont repris, les syndicats ont refait appel à lui ; il a mené un face à face sévère avec Graffin. Aussitôt connue la mort du patron, une rumeur lui a donc fait porter le chapeau. La ficelle est grosse.
Il faut deux bonnes heures encore avant de voir arriver la nouvelle loco, une argentine elle aussi, qui ne porte aucune espèce d’immatriculation ; comme la machine défaillante, elle n’est pas de la première fraîcheur ; pendant les opérations de jonction, à deux reprises et sans raison, la foule des passagers, qui palabre sur la place du village, panique et se précipite à l’assaut des wagons. Fausses alertes. Ces gens, apparemment impavides, redoutent de louper le train devenu une denrée rare. Finalement, le voyage reprend. Immobile, la rangée de garçons fumeurs regarde partir le convoi. Le train traverse un paysage discontinue de hautes herbes couleur jaune paille, comme autant de crinières plantées ici ou là, ébouriffées, puis une plaine à baobabs, tronc massif et courtes branches, aux formes fantasques, déchiquetées. Ces silhouettes évoquent l’effroi ou la colère, font penser à un feu d’artifice ou à un parapluie, à une sorcière ou à un manège. La plupart, pense Magali, ont l’air de géants aux cheveux en pétard.
Chapitre 10
Kayes, mercredi
« La ville a eu droit à la visite du Président, ça se voit, regarde un peu comme ils ont ripoliné les bâtiments officiels » dit Fernande. La gare de Kayes a été repeinte en rouge et blanc, deux larges bandes horizontales tout le long de l’interminable façade. Une semaine plutôt, le chef de l’Etat et son entourage étaient de passage dans la région, les municipaux avaient bien fait les choses.
L’arrivée du train à Kayes se fait presque en fanfare ; plus de vingt heures de trajet et un retard maison mais le machiniste actionne pourtant dès les faubourgs sa sirène. Comme pour une entrée triomphale ; ou une victoire sur le sort, une de plus. Au bord des voies, les gens s’arrêtent pour observer le convoi, certains saluent de la main, des gamins dansent ; le coq dans le couloir de la voiture en rajoute, cocoriquant avec de grands mouvements d’ailes tout en tirant sur sa ficelle ; il y a de la fierté et de la joie dans l’air.
La descente du train donne lieu à un joyeux bordel, tout le monde est pressé de bouger alors que surgit de partout un nombre sidérant de colis. A la sortie de la gare, juste de l’autre côté de la rue, une rangée d’échoppes en demi-cercle abrite les mêmes boutiques minuscules qu’à Bamako, les mêmes « Nescafé », ces minuscules bars où on vous prépare un café vite fait.
« Il fallait voir avant, c’était dix fois plus vivant » : la stagiaire reprend son couplet nostalgique. Avant, toujours avant. Il y a décidément un avant et un après privatisation. Pour elle, l’effondrement du trafic passagers a signé aussi la mort de tout un petit monde qui dépendait du train.
Derrière ces étals s’ouvre une vaste place, nue, où tout est ocre, le sol, la poussière et les trois bâtiments de l’ère coloniale qui délimitent l’esplanade. Un peu partout volettent des petits sacs de plastique noire, que des enfants récupèrent et brûlent en tas. L’odeur de la fumée est aigre, tenace. Aux pieds de grands arbres, quelques familles reposent sur un tapis qui semble être leur seul bien. De fenêtres ouvertes de maisons avoisinantes se déverse un même bruit d’émissions de télévision. Au milieu de la place, une rangée d’arbres résiste à la désertification ambiante ; elle protège un jardin avec un petit bar, « La paillotte » ; quelques fauteuils, aux lanières effilochées, et des tables basses entourent une estrade, adossée à une fresque représentant des danseurs ; le lieu est public mais quasi désert. Les gens l’évitent ; seule une poignée de cadres, noirs et blancs, y sirotent une bière. Des nuées d’oiseaux aux longues ailes bleu clair, la tête noire avec des yeux cernés de rouge, une queue courte et violacée, piaillent en plongeant d’un arbre à un autre ; sur le sol mal dallé, des lézards multicolores dressent une tête inquiète.
Un des trois immeubles fait hôtel-restaurant ; ce bâtiment cubique en pierre de taille, de deux étages, est décoré d’arcades dans un style mauresque. Il a une drôle d’allure, un côté vestige à l’abandon. Magali a l’impression d’en être la seule cliente ; elle a été prévenue que l’hôtel est parfois visité. La nuit. On entendrait dans les couloirs des voix suaves qui murmurent « c’est l’amour qui passe » mais cela ne la concerne guère. En principe. Sa chambre est vaste, haute de plafond, gentiment déglinguée.
La nuit tombe vite. Fernande est partie, elle a de la famille à Kayes. Magali dîne, seule. Dans la salle du restaurant, déserte également, elle retrouve un décor familier : une télé est branchée sur une chaîne française. Interrompant un long reportage sur des défilés de mode, un « flash » d’information montre Nicolas Sarkozy en train de bouger. La visite à Tiécoura est prévue pour le lendemain matin. Repas : méchoui, mangues, bière. Au mur un tableau naïf, une femme portant sur sa tête un empilement de quatre casseroles, de taille décroissante ; une légende dit « La femme est une source de possibilité : par elle on peut tout avoir, par elle on peut tout perdre ». La journaliste ne se sent pas d’attaque pour un tour en ville et va rejoindre sa chambre quand elle entend, au fond d’un couloir du rez de chaussée, dans la pénombre, un bruit connu, un claquement sec qui ne trompe pas ; une raie de lumière, très tenue, sous une porte invite à aller y voir. C’est une salle de billard, classique, vaste table de feutre vert, lampe basse, ratelier. L’épervier s’y entraîne, seul. Tout à son jeu, il regarde à peine l’arrivante et penché sur le tapis, assure un coup d’une impeccable maîtrise où la boule blanche valse, virevolte, zigzague autour d’une rouge avant de frapper, comme aimantée, une autre blanche. Une trajectoire parfaite, comme un dessin abstrait.
Sorti de son apnée, il se redresse sans effort, découvre la visiteuse, lui sourit, tout en frottant son procédé de craie bleue :
« Madame Dutriez ! Vous jouez ?
Sans attendre sa réponse, il replonge, tire une autre boule puis demande :
« Dites moi, chère journaliste, qu’est ce que vous avez fait à mon Issiaka ?!
« Pardon ?
« Issiaka, oui, Issiaka Dembelé, mon collaborateur. Je vous l’ai présenté dans le train, hier soir. Vous l’avez déjà oublié ?
Elle se souvient maintenant du regard de fouine de ce dernier, de l’espèce de dégoût que le flic avait manifesté quand elle lui serra la main.
« Lui en tout cas se souvient de vous, je vous l’assure !
« Ah bon ?
« Oui, il prétend que vous êtes un voleur de sexe !
« De quoi ? De quoi ?
« Vous seriez un voleur de sexe, parfaitement, vous ne connaissez pas cette pratique ?
Magali se garde de plaisanter, sentant confusément que l’affaire n’est pas forcément drôle. Le commissaire en tout cas n’a pas l’air de blaguer.
« Voleur de sexe, madame Dutriez, c’est quelqu’un qui vous fait disparaître votre sexe, rien qu’en vous serrant la main
« ?!
« Faut pas rire avec ça, vous savez. D’habitude, c’est une histoire d’hommes mais bon, c’est tombé sur vous. Je ne sais pas s’il faut vous en féliciter. Ici, les gens prennent la chose très au sérieux. Figurez vous qu’il y a même un voleur comme ça qui s’est fait lyncher récemment, vous savez ?
Silence
« Lynché, absolument ! Certains voleurs vous rendent le sexe contre une grosse somme, mais d’autres partent avec.
« Mais c’est quoi, ce délire ?
« Ecoutez. Moi, personnellement, je ne vous crois pas coupable. Voyez vous, nous nous sommes serrés la main hier, au même moment, et depuis, je l’ai vérifié à plusieurs reprises, mes parties génitales sont bien en place. Mais Issiaka lui, il dit le contraire. Et c’est un obstiné, Issiaka !
« Il n’a plus de couilles ?
« Moi, ce qu’il m’a dit, c’est qu’il ne pouvait plus bander !
Magali se sent démunie ; l’autre lui raconte avec gravité une histoire totalement abracadabrantesque :
« Ne vous en faites pas trop, chère madame, je vais calmer mon Issiaka mais vous voilà prévenue, ne serrez pas trop de mains, vous risquez d’aggraver votre cas !
Il se remet à jouer et, sans transition, commente :
« Vous ne connaissez pas le billard à trois bandes, m’avez vous dit, c’est ça ? Le bon vieux billard à la française. Rien à voir avec le folklore américain. Ici, c’est du cérébral, de la géométrie appliquée, un exercice pascalien, oserais-je dire. J’ai été champion de l’Afrique de l’Ouest, jadis, dans cette discipline. J’ai perdu la main mais quand je peux, je m’entraîne. »
Il explique que c’est en France qu’il a découvert ce jeu. Etudiant à St Etienne, le soir, il retrouvait des accros, un certain Lulu notamment, qui l’a initié, au club de la rue Malraux.
« Vous connaissez Lulu ?
Elle ne connait pas. Il est déçu. Décidément ce soir c’est sa fête.
« Ici il n’y a pas trop de billard, alors quand j’ai la chance de tomber sur une table comme celle-ci, j’en profite !
« Petite démonstration ! » dit-il. Il consulte les bristols qu’il a fixés au mur, où figure le schéma de ses coups. « Un trois bandes. » Il aligne, sur la longueur du tapis, deux boules, une blanche puis une rouge, assez près de lui, à sa droite et place plus loin une autre blanche, à gauche ; il s’incline, positionne sa queue, s’applique, fait durer le plaisir puis frappe la blanche la plus proche ; elle heurte la bande voisine, à droite, y rebondit vers la rouge puis revient, un peu plus haut cette fois, vers la même bande avant de traverser la largeur du tapis, rebondir sur la bande gauche et percuter sèchement l’autre boule. Un coup, trois bandes, le point, ça semble simple.
« L’astuce, c’est qu’il faut taper la première blanche au dessous du centre, avec un maxi effet à droite, OK ? AU DESSOUS DU CENTRE ! »
Magali veut bien. Le flic redispose les billes à l’identique, lui propose de jouer. A trois reprises, elle réalise des coups foireux, trop à droite ou trop à gauche ou trop fort...
« Règle numéro un, dit-il : la vitesse du coup de queue nuit à la mesure. »
Elle s’interdit d’interpréter. Le flic lui demande si elle aime Kayes. A part la gare et la place de l’hôtel, elle n’a pas vu grand chose. « Papa » est originaire de cette ville, il se dit un sarakolé -le nom des gens du cru- pur sucre, un peuple qui bouge beaucoup, « Il y en a pas mal dans vos banlieues. On raconte aussi que le premier Américain arrivé sur la lune est tombé sur un sarakolé !
Papa semble content de sa blague. Avant de se quitter, il livre à la jeune femme un dernier conseil :
« Vérifier vos chaussures, demain, avant de les enfiler !
« Mais encore !
« Les scorpions, ma chère, les scorpions. Ils adorent les pompes !
Chapitre 11
Bamako, mercredi (soir)
La nuit a été courte, on peut même dire qu’il n’y a pas eu de nuit du tout pour Racine et Mimi. La virée pour retrouver le sac – intact, rien ne manquait à l’appel – a pris du temps ; puis il a fallu attendre le toubib venu séparer le couple maudit. Une piqure et c’était bon, le duo se désenboitait. Le marabout s’est aussitôt éclipsé, humilié à mort. Mimi a pris sous son aile « la mass ». Résultat ? Ils sont rentrés à cinq au carré. Là, les deux enfants se sont effondrés sur un canapé. Il a fallu laver et soigner la fofolle, lui trouver un hébergement chez les « Coulou », un sommier sous la pergola ; dans la matinée, un voisin la conduirait à une clinique, pas question de la garder à la maison ni de la laisser livrée à elle même en ville.
L’aube est là. Mimi file au boulot, Racine traîne, somnole, s’endort ; le spectacle scabreux de cette nuit, curieusement, l’a mis en train ; il fait des rêveries égrillardes ; dans le rôle de Hérode, il regarde danser Mimi-Salomé qui se dénude progressivement, écartant l’une après l’autre les traînées d’encens qui l’habillent ; dévêtue, elle triomphe et lui demande la tête du marabout.
Réveillés en fin de matinée, les deux enfants tardent à repartir ; ils n’envisagent évidemment pas de retourner dans la maison inachevée, trainaillent, stationnent devant la porte, attendent on ne sait quoi. Mimi ? La Vespa ?
Indécis, tous trois passent l’après-midi à bavarder ; Racine leur parle de Paris, celui des lumières et celui des sans-papiers ; les jeunes gens le mettent au courant des derniers « faits divers » de Bamako. « Oeil de lynx » part dans un long exposé sur la multiplication des « chinois », des bars gérés par des asiatiques et faisant plus ou moins hôtels de passe mais qui seraient en fait tenus en sous-main, assure-t-il, par des propriétaires maliens aussi riches que discrets. « Bic rouge » raconte une histoire de malédiction : il n’y a pas une semaine, dans un carré voisin, une mère déjà âgée aurait maudit son fils aîné. Témoin de la scène, la jeune fille rejoue la scène avec émotion et répète l’incantation avec des trémolos dans la voix : « J’aurais du avorter que de te mettre au monde. Je regrette énormément mon acte. Si tu es un fils légitime de ton père, que les premières pluies ne te trouvent en vie ! » Or le lendemain, l’homme gardait le lit, le surlendemain, il était mort... Racine encaisse, le trio se tait. Ces histoires qui ne tiennent pas debout le troublent, il ne comprend pas pourquoi. Il essaie encore d’apprendre quelques proverbes bien sentis, du genre « Si un mouton fait le guet devant la tanière d’un lion, méfie toi du mouton ! »
En début de soirée, les enfants l’accompagnent jusqu’à la rédaction du « Canard déchaîné » puis disparaissent mais ils devraient vite se remanifester, c’est évident. Le garçon tient trop à sa Vespa et Bic tient au garçon... Malgré sa nuit blanche, Mimi rayonne. Elle raconte sa journée. Le travail, la numérisation, la routine, les bonnes surprises. La conversation en arrive à la mort du Flamand. Documentaliste, elle a récemment vu passer, et l’a consultée en douce, une copie du rapport d’expertise du médecin légiste ; le papier était arrivé, officiellement ou par des voies détournées, elle l’ignorait, à la rédaction en chef qui n’avait pas voulu y faire écho dans le journal :
« Graffin, tu sais comment on l’a retrouvé ?
« En miettes, j’imagine.
« A peu près. Le corps a été pulvérisé mais la tête... En fait le bonhomme a été décapité et sa tête est restée sur le ballast. Il y avait un trou sur la voie, une sorte de nid de poule suffisant pour qu’elle s’y niche ; un détail curieux ou macabre, et c’est sans doute pour cela que le journaliste n’a pas voulu l’utiliser, car il aurait grillé ses sources : cette tête portait un chapeau genre chéchia, tu connais ?
Lui, savant :
« Chechia : Mot arabe qui vient de chèche ; c’était d’abord une écharpe servant de turban puis c’est devenu une coiffure cylindrique ou tronçonnique, en drap. »
« Exact, bravo. Et puis ? T’as pas tout dit...
« Je pourrais ajouter que c’était le genre de bibi qui était porté aussi par certains corps des troupes françaises d’Afrique. »
« Parfait, je vois que tu suis... Et puis encore ? A quoi ça te fait penser, allez... , insiste Mimi, qui joue au psychanalyste.
« ?!
« Tu ne vois pas ? Une pub ! Une pub célèbre !
Racine est perplexe. Mimi s’exclame :
« Banania, bon dieu, Banania ! Y a bon Banania ! Tu as oublié ce nègre rigolard, les yeux plissés, la bouche ouverte sur une dentition éclatante, avec son superbe chapo rouge ? Il a une cuillère dans la main droite, une gamelle dans l’autre main et il fait la promotion pour une boisson au chocolat. C’est l’archétype du noir infantile, grand gosse un peu simplet ; une pub de merde, raciste et perverse !
Mimi connaît son sujet. Et l’énervement la rend prolixe. C’était un dessin d’un certain de Andreis.
« Quelle année ? Je suis sûr que tu sais pas de quelle année date cette image ? et dans quel contexte elle a été faite ?
« Si tu le dis...
« 1915. On est en pleine guerre. Le noir en question d’ailleurs est un soldat, un poilu, un de ceux qu’on appelait les tirailleurs sénégalais, les T.S. Quand tu regardes bien l’affiche, le type est assis dans un pré mais ce pourrait très bien être une tranchée et son fusil est à ses pieds. Car Banania était devenu l’alimentation de base des bidasses. En tout cas la marque faisait comme si. On verra même fleurir une autre affiche publicitaire où on pouvait lire : « Une des causes de la victoire, Banania ! »
A présent, Mimi est tout à fait en colère. Racine s’étonne :
« Je ne vois pas le rapport ? Graffin et Banania ?
« Tu ne vois pas de rapport parce qu’il n’y en a pas, c’était juste pour parler du chapeau .
Racine s’étonne qu’une image puisse agacer à ce point son amie mais se garde de relancer le sujet. Ils vont dîner dans un maquis près de l’appartement de la documentaliste, « Chez Wawa », brochettes de boeuf accompagnées d’aloko, frites de bananes plantain et bière Castel. Difficile de faire plus simple mais le troquet propose, en dessert, un orchestre de blues mandingue. Mimi commente doucement les morceaux ; pédagogue, elle présente aussi les instruments, la kora ( harpe-luth), le balafon (xylophone), le n’gomi ( petite guitare-luth à 3-4 cordes), le karignan (percussions en métal frottées). Les mélodies sont douces, sensuelles. Le joueur de kora subjugue Racine, des harmonies subtiles, des notes claires, un jeu qui incite à la méditation. Mimi s’invite soudain au micro, part dans une balade lente, épurée ; sa voix est ample, chaude. L’assistance apprécie.
« De quoi parlais tu ? Lui demande le libraire, quand elle retrouve leur table.
C’était un air de Ali Farka Touré sur les enfants-soldats :
« Le recrutement en Afrique / Car ce sont des enfants / Qu’on amène au service militaire / Pour aller faire la guerre... »
Elle ajoute qu’il est souvent question aussi dans ce genre de chansons de famine et d’épidémies, de bravoure des paysans, d’amour et de jalousie...
Là, il se perd un peu dans ses yeux, sa bouche, sa gorge. Elle lui prend la main, le ramène sur terre.
« Ceci dit, camarade Racine, je ne suis pas que mélancolie ! prévient-elle, de retour à la maison. Et pour le prouver, elle offre sans transition à son libraire préféré un cours particulier de sebar. Sur un solo de tam-tam qui passe en boucle sur son portable, une diablerie syncopée, elle se dresse, ondule, se trémousse, se tortille et appelle son partenaire à partager son agitation ; pataud, il se meut avec une grâce de pachyderme alors qu’elle virevolte, gigote, frétille de la croupe, oscille du postérieur, tangue du fessier ; imperceptiblement elle se déshabille et finit nue, à quatre pattes sur le sofa, les reins cambrés en levrette, et toujours dans le rythme. Racine se raidit à en avoir mal et s’invite dans sa danseuse. Elle reprend alors lentement sa danse, très lentement. Aspiré par ce corps doux et chaud, il se sent peu à peu envahi par une chaleur inconnue, une transe interne, une irradiation centrifuge ; il sombre et lévite en même temps ; il ne sait plus où il en est. Preuve de son désarroi : il se met à jurer en russe, langue qu’il n’avait pourtant plus utilisée depuis des années. Jamais, par la suite, il ne trouvera les mots justes pour dire ces ruades, ces embardées, ce corps à corps, cet état de sidération, longtemps il cherchera la phrase adéquate pour en rendre compte. Sur le moment, des images lui viennent en vrac : la pointe du Raz un jour de forte tempête ; la Soufrière en soudaine activité ; Caravadossi entamant l¹air « les étoiles brillaient » à la fin de la Tosca de Puccini ; la descente de flics au début du film « Brazil » ; une finale olympique de bobsleigh ; l¹effondrement des twins towers ; c’est un peu tout cela en même temps. Et encore...
A croire que jusqu’alors il avait baisé et à présent il ferait l’amour. Il pense immédiatement à Magali et efface aussitôt cette idée impie de son logiciel, tout en se perdant au fin fond de sa callipyge de Bamako.
Chapitre 12
Kayes
Jeudi
Sur le chemin du commissariat, Magali a rendez vous à l’AME, l’Association malienne des expulsés, avec un certain Siabou Diaberra. Ce reportage est tout de même l’objet officiel de son périple africain. Siabou, tee-shirt blanc, pantalon kaki, basquettes, trentenaire aux allures de jeune homme, a été expulsé de France il y a à peine deux semaines. L’homme est désorienté. Huit ans, il a vécu, travaillé en France, huit ans pendant lesquelles il n’a cessé de se méfier de la police. « Quand j’avais pas de quoi me payer un ticket de métro, je restais chez moi. » Huit ans où il a enchaîné les petits boulots, dans la restauration ou le bâtiment, petits côté salaires, mais le travail lui était épuisant. Et un jour, marre, basta, ça suffit, plus jamais ça : il participe à la grève des salariés sans papiers. Il défile, occupe, collecte, obtient enfin une attestation, sa carte de gréviste, son seul papier officiel en quelque sorte. Pendant quatre mois, il revendique. Mais il continue de se méfier de la rue jusqu’au jour où, c’est la faute à pas de chance, contrôle de routine dans le métro. Station Château-Rouge. Il sort sa carte de gréviste, les flics l’embarquent illico. Direction Centre de rétention de Vincennes puis consulat du Mali où des collabos locaux, sur la seule foi de sa carte militante, signe son retour à la case départ. Il faut six policiers pour s’occuper de lui, quatre en civil, deux en uniforme. Six flics pour un gréviste, ça doit être équilibré. Embarqué de force dans un avion, jambes et bras scotchés au siège, poignets menottés, il est traité comme un fauve, ligoté comme une chose. Livré comme un colis dans cette ville qu’il connaît mal, Kayes. Il est loin des siens, qu’il n’a guère envie de retrouver dans de telles circonstances. L’humiliation totale. Dix jours après l’incident, les marques des attaches aux bras sont toujours visibles. Et dans sa tête, c’est pire encore. Siabou n’en est toujours pas revenu. Et il ne pense qu’à une chose : comment repartir en France ? Comment remonter dans le Nord ?
L’homme accepte de poser pour Magali ; sur la photo, il a un sourire amer mais l’allure est décidée ; son ombre s’étend, immense, sur la chaussée ocre et déserte ; derrière lui, des gens désoeuvrés devant un magasin vide semblent lui signifier qu’ici non plus, il n’y a pas de place pour lui.
L’homme est pudique, ses mots sont comptés mais il a su faire passer sa colère. L’entretien est lourd pour la journaliste aussi. Magali aurait dû se ménager une pause mais elle quitte un peu vite son rendez-vous pour se rendre au commissariat, tout proche où elle pourra enfin voir Tiécoura Traoré en cette fin de matinée. Dans l’entrée, elle croit reconnaître le commissaire Habib et son adjoint Sosso, mais elle ne le jurerait pas . La visite de la pigiste était annoncée et elle retrouve sans encombre Tiécoura dans un petit bureau qu’on leur a réservé. Le « docteur » se montre à peine étonné de sa présence. On se salue, les gestes sont sobres, pleins de pudeur. On se croirait à une rencontre de jansénistes. La pigiste lui raconte son périple, depuis le déjeuner, il y a trois ou quatre jours à peine, avec Racine et Honoré dans un bistro parisien, autour de langoustines, jusqu’à son interview tout à l’heure du jeune expulsé... Tiécoura la joue austère ; comme Siabou d’ailleurs, il n’est pas du genre à exprimer son émotion ; elle le sent las. Il en vient aux faits ; l’accusation contre lui part d’une menace, proférée dans un débat de cheminots qu’il présidait, il y a des mois déjà. Quelqu’un, dans l’assistance, avait alors accusé le Pdg, François Graffin, d’avoir dressé personnellement la liste des 600 « déflatés » de 2003 et il l’avait menacé de mort.
« C’était un mouvement de colère, rien de plus ; le genre de phrase qu’on peut sortir dix fois par jour ; surtout dans un meeting ! Un journal a pourtant utilisé cette histoire et cité mon nom ; ce qui m’a valu d’être arrêté.
– Sur cette seule base ?
– Exact ; on n’a même pas tenu compte de mon alibi : la nuit en question, où le patron est passé sous le train, je dormais dans mon « kolkhoze » avec mon employé.
– Et celui-ci n’a rien dit ?
– Si, il a voulu témoigner mais la police ne l’a pas enregistré. Tu me diras, ici, on est correct avec moi, j’ai une geôle où je suis seul, la cantine est potable et j’ai des livres en pagaille, une vraie petite bibliothèque, mais bon, j’aimerais mieux faire tout ça dehors si je pouvais. Magali, ini tché, merci ; je sais que tu vas me sortir d’ici !
La confiance du prisonnier l’honore, elle se garde bien de lui répondre qu’elle n’a aucune idée sur la façon de le tirer de ce guêpier. La jeune femme quitte le siège de la police et se rend au quartier général des cheminots, le club des anciens. Tiecoura lui a donné l’adresse de l’association : rue Modibo Keita. Le bâtiment est mitoyen d’un dispensaire et la cour s’adosse à des jardins qu’arrosent en permanence une armada de paysannes. Mais il est aussi en bord de route ; le trafic incessant lève une poussière qui recouvre tout, arbres, plantes, bancs, tables, tasses de thé... ainsi que le monument qui trône au milieu d’un petit fouillis végétal ; une statue intitulée « Hommage aux victimes de la concession du chemin de fer Dakar-Niger » représente une jeune fille, en boubou bleu, enceinte, à genoux sur un bloc couleur rouge, suppliante. A ses pieds, l’artiste a installé tout ce que le train transporte ordinairement, un panier d’agrumes, un tas de charbon de bois, un sac de riz, un tambourin, une lance prolongée par une étoile et une demi-lune. Devant cet ensemble, et faisant partie du monument, se trouvent encore deux bouts de rails et deux roues. Une femme-Sisyphe, le dos cassé, balaie la cour ; elle tente de repousser le voile blanchâtre qui masque le lieu, donne à toute chose un teint blafard. En vain. Des volutes poudreuses n’en finissent pas de retomber paresseusement et le tapis de cendres se reconstitue, sans cesse.
Les amis de Tiécoura comptent beaucoup, eux aussi, sur Magali. Les anciens sont réunis, fébriles, autour d’une table basse. Ils ont retrouvé l’auteur des menaces.
« Les menaces ?
« Les menaces de mort contre le Pdg !
« C’est qui ?
« Dansokho !
Le Dansokho en question est présent, penaud, assis au milieu des siens. Pas vraiment une tête d’assassin ni même d’imprécateur. Cheveux blancs, visage très fin, corps menu flottant dans un boubou assez majestueux, il est dans ses petites babouches. Il a peur, le reconnaît.
« Vous imaginez ? Vous menacez de mort un nabab comme Graffin, un toubab nabab. Parce que j’étais sûr qu’il était au courant des licenciements, qu’ils les avait voulus, préparés. Il avait lui même désigné chaque nom, j’étais donc très en colère. Normal. Mais voilà le toubab qui disparaît ! Je le menace et pfuittt, il disparaît. Et dans quelles conditions ?! C’est un peu comme si j’avais des pouvoirs magiques, non ? Bref j’ai eu la frousse et je me suis fait oublier. Mais je ne pensais pas que la police s’attaquerait à Tiecoura. Pas question qu’il paie pour moi ! Alors maintenant, je suis prêt à me dénoncer...
Magali le remercie de sa démarche et le rassure. Son geste ne servirait à rien, les flics ne l’écouteraient même pas. Ce qu’il faut, c’est trouver l’assassin. Les gens de l’association mettent à la disposition de la journaliste une vieille Méhari ; à côté des 4x4 des coopérants et des bobos locaux, l’engin fait un peu préhistoire mais il est utile ; elle s’initie à sa conduite en retournant au commissariat où elle espère voir « papa » ; elle y croise Issiaka, complètement abattu, le regard mauvais. La jeune femme prend sur elle, lui dit que le commissaire l’a mise au courant, qu’elle est désolée, elle ignorait qu’elle pouvait lui nuire ainsi. L’autre, blême, confirme qu’il n’a plus d’érection depuis le voyage en train, se lamente. Un vieil homme, qui est en train de déposer une main courante dans le hall, entend leur conversation, s’approche d’elle :
« Vous êtes vraiment voleur de sexe ?
On sent que l’ancien se passionne. Va-t-il s’en prendre à Magali comme à une sorcière ? Ou la féliciter pour ses dons ? Solliciter son « aide » pour ses propres affaires, si l’on peut dire ? Lui demander conseil ?
« Papa », arrivé opportunément, calme le jeu, renvoie Issiaka dans ses pénates et le déposeur de plainte à ses écrits. Il invite Magali dans son bureau. Elle lui parle de sa visite à Tiecoura, de Dansokho qui est tout disposé à se dénoncer pour ses menaces « verbales ».
« Franchement, la piste d’un règlement de compte syndical, ça ne tient pas, non ? Ces gens sont des militants, pas des tueurs !
« Ma chère, vous ne m’apprenez rien ! Rien de nouveau !
« Mais l’alibi de Tiecoura ! Il est en béton ; son employé était avec lui la nuit du crime. A la ferme.
« Papa » boude. A peine s’il concède, placide :
« On va vérifier »
Il se tait, regarde Magali, et, soudain agressif, il l’attaque :
« On vous a filé l’enquête, c’est ça ?
« Pardon ?
« Oui, oui, vous avez bien entendu, Paris vous a filé l’enquête.
– L’enquête ?
– Sur la mort du Flamand ?
« C’est quoi encore, cette histoire ?
L’étonnement de Magali n’est pas feint, « Papa » le note, il hésite, se calme aussi vite qu’il s’est crispé :
« C’est moi qui suis en charge de cette enquête, vous comprenez ? C’est moi qui enquête sur la mort de Graffin, moi... mais bon, c’est vrai, je patine. Bien sûr, on a coffré Tiécoura mais ça ne trompe personne ou presque ; il fallait bien faire quelque chose. L’est pas malheureux, là où il est ; on va le sortir, plus tard ; quand j’aurai une piste, une bonne, une vraie. Pour l’instant, je suis dans le jaja. J’ai fouiné dans plusieurs directions mais ça ne donne rien. Les supérieurs commencent à me harceler. Alors, quand j’ai appris que vous veniez, j’ai tout de suite pensé que l’ambassade voulait me doubler avec un privé de la métropole.
« Vous m’étonnez beaucoup, monsieur Papa ! Je croyais le Mali indépendant, non ? C’est l’ambassade française qui déciderait de tout ?
« Non, non, bien sûr...
« Ensuite, je ne suis pas « privé » comme vous dites, je suis thésarde, et un peu journaliste-pigiste. C’est tout. Enfin, franchement, vous m’avez bien regardée ? Vous croyez que j’ai l’air de quelqu’un qui bosse pour le Quai d’Orsay ? »
« Vous savez, ils ont pas tous des têtes de noeuds ou d’énarques, loin de là. Mais bon, allez-y, moquez vous, traitez moi de parano !
« Bin oui, vous êtes un peu parano, mais ça se soigne.
« Je vous en prie.
Mais Papa n’insiste pas ; Magali réplique :
« Alors, pour Tiécoura ?
« Quoi Tiécoura ?
« Vous le libérez quand ?
« Je vous l’ai dit, il est bien en tôle. Pour quelques jours. C’est pas très confortable mais pour l’instant, croyez moi, il est plus tranquille là que dehors. Et puis je lui ai confié deux rayons de ma bibliothèque, alors...
Chapitre 13
Bamako, jeudi
Chez un petit garagiste du quartier, Racine trouve, à l’aube, une Vespa d’occasion. A vrai dire, c’est moins le véhicule que le mécanicien qui attire d’abord l’attention du libraire. Celui-ci porte sans complexe un tee-shirt avec l’image tout sourire de Ben Laden. Il croise le regard de Racine sur son maillot, s’étonne de son étonnement. Puis on parle affaires. Le scooter est de couleur noire, comme demandé, état convenable, prix raisonnable. La transmission du véhicule à « Oeil de lynx », réapparu dans le quartier avec sa complice comme par enchantement, se passe peu après, non sans une certaine solennité. Le gamin doutait-il de la parole du toubab ? Toujours est-il qu’il en a la larme à son oeil unique. Avec « Bic rouge » à ses côtés, les enfants partent pour la grande aventure : se laisser happer par le courant urbain, sillonner sans fin -et sans casque, ça va de soi- les rues de Bamako...
Quand il retrouve Mimi, celle-ci est plongée dans une revue de presse rapide. Dans la capitale, les gazettes sont nombreuses, les sujets parfois limite mais le traitement toujours vivant. Ce matin, plusieurs canards parlent d’une histoire de porno-gogo. Il paraît en effet que dans les bars chinois, les filles qui amènent leurs clients dans les chambres annexes sont d’accord pour laisser filmer leurs ébats, les clients naturellement n’en savent rien. On trouverait des brassées de DVD sur les marchés où on peut assister aux galipettes du tout-Bamako... Mimi rit, trouve que c’est « Bien fait ! » pour les machos honteux, hypocrites comme pas deux, qui la jouent père-fouettard à la mosquée le matin et courent la gueuse l’après midi. Racine rougit, tousse, s’absorbe dans la contemplation du bout de ses chaussures... Mimi tilte :
« T’es pas d’accord ?
« Si, si, c’est pas ça...
« C’est pas quoi ? Me dis pas que...
« ….
« Tu es déjà allé aux putes ? Ici ? Dans les bars chinois ?
« Une... heu... une fois ! Juste une fois ! Pour voir !
« Pour voir ! C’est ça, pour voir, pour enquêter, peut-être ?! Ici, à Bamako ? Quand ?
« Bin, je te connaissais pas encore !
« Il me connaissait pas encore ?! Je rêve ? Mais vous êtes donc tous des boucs, vous les mâles, non ?
« Mimi...
« Y a plus de Mimi ! Tu veux que je te dise, vous n’êtes que des bites sur pieds ! On attache un pagne à un poteau électrique et vous allez vous le taper, le poteau, c’est ça ? Non ?
« Mimi...
« Quoi, Mimi ! Non, j’exagère pas ! Cochon, t’es un cochon, Racine. Comme les autres. Les mâles !
« Mais il y a longtemps...
« C’est ça, oui, il y a longtemps ?! Ça fait quoi, deux semaines, un mois ?! ça fait longtemps pour toi ? Mais, petit père, t’es peut être un héros de film, maintenant, ici ? On doit peut-être voir quelque part tes petites fesses trembloter en gros plan ! T’es fier ?
Elle rit cette fois.
« A mon avis, sur une séquence comme ça, les voyeurs, ils doivent tous faire un arrêt sur image pour bien profiter du décor !
Il repique une crise de toux. Elle le contemple, soudain attendrie :
« Bon, je veux pas la mort du pêcheur ; si je tombe sur « ton » film, Racine, promis, j’achète toute la série. Mais tu me reprends tout le lot, promis ?
« Promis !
Ils se retrouvent au journal de Mimi ; son petit bureau sans fenêtre est plutôt bordélique. Sur une large étagère est à peu près rangée la collection complète du journal, depuis le premier numéro ainsi que des dossiers divers, mis en boîte par année. On lui a demandé de numériser tous les sommaires ainsi que l’intitulé des principaux dossiers. Elle remonte dans le temps, le plus gros est déjà fait, elle en est au début des années 80.
Pendant qu’elle reprend son labeur, Racine ne peut s’empêcher de farfouiller dans les journaux, de regarder les illustrations, de consulter les classeurs ; il s’agit essentiellement de faits divers. Des crimes de sang, des vols, des bisbilles entre bergers et cultivateurs ; énormément d’histoires de tromperies et autres marivaudages. Des courses poursuites, des petites vengeances. Une grande variété de turpitudes. Un titre l’intrigue ; il lui en fait part :
« Tiens, j’ai trouvé une autre histoire de chapeau
– De chapeau ?
– Hier, tu me parlais de chapeau rouge.
Il lui désigne un dossier intitulé « C’est qui, sous la chéchia ? » ; la chemise en question est dans le classeur de l’année 1978. Avril 1978, précise le document. L’info raconte en substance qu’un toubab a été retrouvé, suicidé, dans les toilettes de la gare de Bamako. Un suicide un peu limite, semble dire sans le dire le journaliste, vu qu’il est mort d’une balle dans la nuque, « Ce qui est assez rare ou demande une détermination un peu perverse ». Surprise : le bonhomme, enfin le cadavre, portait un chéchia ; on ne l’a pas encore identifié, il pourrait s’agir d’un retraité français, un septuagénaire. Signé : Mohamed Tabouré.
« Mon oncle ! réagit fièrement Mimi. Mohamed Tabouré, c’est mon oncle. Je parle du journaliste, pas du suicidé ! C’est lui qui m’a fait entrer au journal, d’ailleurs. L’histoire dont tu parles remonte à la nuit des temps... mais ça me revient un peu. Sur le moment, j’étais trop petite, ça fait plus de trente ans, t’imagines ? Mais je me souviens assez bien que le tonton avait pris cette affaire très à coeur. Et qu’il nous en reparlera souvent. C’était, je crois, le premier papier qu’il signait de son nom ; il avait envie de comprendre le pourquoi du comment mais il a tout de suite été mis sur la touche. Par la redac’chef. Et ça, il ne l’a jamais digéré ; il y revenait régulièrement. A chaque réunion de famille, on avait droit au couplet sur « le blanc des WC ». Et pourquoi on l’avait pas laissé enquêter ? Et pourquoi l’autre se trouvait là ? Et pourquoi tout le monde a écrasé ? Et pourquoi, pourquoi... Je me souviens qu’à table, alors, chacun y allait de sa version. Comment s’appelait déjà ce type ? Le mort. C’était, disait-on, une huile de la communauté française, un diplomate ou un magistrat ou quelque chose comme ça, j’ai oublié.
« Le blanc des WC » ?! cela aurait pu faire un titre de polar, se dit Racine qui parcourt machinalement le dossier.
« Drôle d’histoire... poursuit Mimi. Non seulement tonton n’a pas pu enquêter mais longtemps on lui a reproché son seul article sur l’affaire, où il évoque simplement ses doutes à propos de la balle dans la nuque ; il sortait de son rôle, qu’on lui a dit ; le fait est qu’on n’a jamais pu prouver le crime, ni l’inverse, on n’a jamais trouvé un mobile non plus et encore moins un coupable.
Le libraire tombe sur une dépêche AFP indiquant que l’ambassade française avait alors fait des pieds et des mains pour que le journal écrase. Une note manuscrite, non signée, à la même date, avril 1978, épinglée à l’article, disait que pour une fois, les autorités locales étaient d’accord avec les recommandations de prudence de l’ambassade. Bref, personne n’avait voulu faire de bruit ; une sorte d’union sacrée du colon et du colonisé s’était créée pour que ça se tasse, pour qu’on classe. Comme si « on » avait peur que ça tourne à l’aigre, à l’incident diplomatique.
Mimi se rapproprie complètement cette histoire :
« Tonton n’avait pas vraiment de pistes, il savait que plusieurs interprétations étaient dans l’air ; les uns prétendaient que le vieux devait faire partie de ces blancs errant sur le continent, atteints d’on ne sait quelle maladie de langueur, de nostalgie mortifère... Ou de syndrome de Stendhal, disait-on aussi, tu sais, ces gens victimes d’un dépaysement radical et totalement perdus dans le monde nouveau qu’ils traversent. D’autres...
Elle hésite, Racine la relance :
« D’autres ont lancé une vilaine rumeur, le pépé aurait eu des fréquentations douteuses ; d’ailleurs il suffisait de voir où on l’avait trouvé. Des WC ! Il aurait aimé les garçons, on l’aurait vu roder du côté des toilettes, il aurait eu ce qu’il méritait. Enfin, tu vois le genre...
Racine est perplexe. Cette histoire de chapeau rouge le turlupine, l’asticote, le dérange. Sans très bien savoir pourquoi.
Chapitre 14
Kayes, vendredi
Au volant de la Méhari et en compagnie de Fernande, pimpante, qui l’a rejointe, Magali débarque au QG de « Transfer ». L’immeuble a l’air transplanté, comme une installation d’extraterrestre qui s’inviterait dans le paysage, un élément du parvis de la Défense déplacé en plein pays mandingue, une excroissance arrogante où un personnel en uniforme manage sur un mode stressé.
« La mondialisation... dit Fernande, désignant l’édifice.
Elles sont plutôt mal reçues par les agents de sécurité. Fernande rappelle qu’elle a sollicité un rendez-vous avec François Graffin pour sa recherche ; la fille de la réception lui fait remarquer, vaguement narquoise, que François Graffin n’est plus vraiment en mesure d’assurer le moindre rendez-vous et que, de toute façon, elle n’avait pas été informée de cette demande. Fernande insiste pour rencontrer au moins le secrétariat du défunt.
« Les services ont déjà vu les flics, tout ce qui devait être dit a été dit ; la maison a autre chose à faire aujourd’hui que de recevoir des touristes, répond sèchement l’employée.
Magali repart à l’attaque. « Je viens de Paris... C’est important... Image de marque de la société... ». L’hôtesse finit par sonner dans quelques bureaux, sans la moindre conviction ; on l’entend vaguement papoter dans son micro et elle confirme, les yeux, le nez et la bouche également pincés, que personne, décidément, ne peut les recevoir, ajoutant que la direction « provisoire » n’a pas la tête à ça. Magali regarde Fernande. La formule est jolie : « La direction n’a pas la tête à ça ». Face à la standardiste outrée, les voilà toutes deux parties dans un fou-rire gêné quand un homme, resté un peu en retrait dans l’entrée, s’approche d’elles ; il porte la veste de toile bleu ciel au sigle de Transfer ; elles s’attendent à ce que le gars les invite à dégager mais il les aborde courtoisement, timidement même et leur propose de sortir sur la terrasse pour parler. Aux pieds de la tour, il montre d’un mouvement de menton les gens de l’accueil-sécurité :
« Pas la peine qu’on nous entende ! Je me présente : Michel, dit Mambo, chauffeur de car. Sur la ligne Bamako/Kayes. Vous êtes des amies de François Graffin ?
Magali, prudente, hésite à serrer la main que l’autre lui tend, elle le salue à la mode hindoue, les mains jointes contre la poitrine. Mambo, intrigué, l’imite maladroitement. Fernande, elle, hèle un taxi en maraude et s’éclipse ; un autre rendez-vous urgent.
Mambo, une semaine plus tôt, venant de la capitale et se rendant à Kayes, a fait une pause au routier « L’Harmattan » ; il y a vu François Graffin
– Quand ?
– Dimanche, pas celui-ci, l’autre d’avant ; dimanche dans la soirée.
Magali tilte et suggère de prendre un verre dans un maquis qui s’appelle « L’indépendance », près du parking . Quatre poteaux soutenant une plaque de tôle ondulée en guise de toit, trois tables, cinq bancs et une mamie en tablier fleuri au milieu du rade, près d’une bassine en plastique pleine de cannettes et de pains de glace. Ils éclusent une première bière en silence. On boit la première, on déguste la deuxième : qui donc déjà disait cela ?
– Vous savez que Graffin est mort, sans doute dimanche dernier d’ailleurs. Peu de temps donc après votre rencontre. Peut-être même êtes vous un des derniers à l’avoir croisé vivant ?
– J’ai appris tout ça aujourd’hui.
– Aujourd’hui seulement ?
– Je rentre du village, histoire de famille, épuisante ; vous avez de la famille, vous ?
– C’est pas trop mon truc.
– Bref, j’étais avec les miens, coupé de tout. Déjà que je suis pas un maniaque de l’info en temps ordinaire mais quand je retourne au village, faut pas m’agacer avec la radio, la télé, internet et tout le toutim. Moi je fais tout fermer ; ça fait râler mais tant pis... Bref, je passe sur les détails domestiques et c’est de retour en ville, ce matin, que j’apprends la catastrophe. On avait retrouvé Graffin sur un pont, enfin des restes du bonhomme...
– Justement, ce pont, il est loin du restaurant dont vous parlez ?
– Le pont ? S’il est loin de L’Harmattan ? une dizaine de kilomètres, à peine.
Nouvelle bière, nouveau silence.
– Comment s’est passée votre rencontre ?
– Quelle rencontre ?
– Chez le routier, avec le PDG.
– Rencontre, rencontre, c’est un grand mot ; y a pas eu vraiment de rencontre ; on était en fait au même endroit sans se voir réellement.
– Vous m’expliquez ?
– De toute façon, vous savez, Graffin et moi, on vivait pas dans le même monde, on pouvait donc pas vraiment se parler. Il s’est simplement passé ceci : le dimanche soir dont je parle, donc, le « patron » est arrivé avec son chauffeur dans le troquet où je faisais ma pause syndicale en quelque sorte. J’ai l’habitude, dans le sens Bamako-Kayes, d’y faire une halte ; le bistrotier est un pote et j’ai un pourcentage sur les consommations des clients que je lui emmène.
– Ça, ça vous regarde !
– Vous avez raison. Bref le patron, Graffin, il était là mais pas avec son chauffeur habituel, en tout cas pas avec celui que je connais moi, Boubakar ; son chauffeur, ce soir-là, c’était un autre, un vieux, que je n’avais jamais vu.
– Vous êtes sûr que c’était Graffin ?
– Graffin ? Sûr de sûr que c’était lui. Je l’ai tout de suite reconnu ; le PDG, c’est le genre de personne qu’on remarque partout, alors dans ce genre d’endroit, vous pensez s’il était visible ! Non, vraiment, pas moyen de se tromper. Vous le connaissiez, vous ?
– Je l’ai vu en photo, vaguement.
– Il avait une tête comme personne d’autre, longue, étroite, les cheveux ras, les yeux qui tombent, des rides partout ; et puis, n’oubliez pas qu’il est aussi patron de la société de cars où je travaille.
Le Flamand ne connaissait évidemment pas Mambo, membre ordinaire de sa piétaille d’employés, mais ce dernier l’avait plusieurs fois aperçu, en vrai ou à la télé. Ce soir-là, Graffin et son voiturier étaient attablés, le chauffeur mangeait, le patron buvait, du thé sans doute.
« Un moment une femme les a abordés ; je l’ai à peine aperçue ; ça n’a pas duré bien longtemps ; je n’ai pas compris ce qu’elle leur voulait au juste ; j’étais trop loin d’eux, et puis c’étaient pas mes oignons... Une marchande ? Une prostituée ? Une paysanne qui faisait du stop ? La discussion soudain a semblé vive entre le chauffeur et la dame ; on aurait dit deux chats en colère, les poils hérissés, les griffes dehors, les dents aussi.
– Aussi quoi ?
– Aussi dehors !
– Et puis quoi ?
– Et puis rien, la femme s’est tirée, les deux hommes sont repartis.
« Seuls ?
« Oui, seuls.
– Et vous n’avez parlé de cette « rencontre » à personne ?
− A personne. Sur le moment, je n’avais aucune raison d’en parler. Arrivé à Kayes, dans la nuit de dimanche à lundi, je précise bien : le dimanche de la semaine dernière, ok ?
− Ok.
− En pleine nuit, donc, j’ai rangé mon véhicule et, en moto, comme d’habitude, j’ai rejoint ma famille, oui je sais, la famille et vous... je suis donc parti tout de suite, j’habite un village du Sahel, du côté de la Mauritanie pour vous situer en gros. Un coin un peu chaud en ce moment, d’ailleurs. Pas seulement à cause du climat. C’est là que des touristes ont été kidnappés par Al Qaeda et compagnie, vous en avez entendu parler ?
− Un Français notamment ?
− Un Français, des Espagnols, des italiens... Enfin bref, je rentre chez moi, j’avais des congés en retard, je prends mon repos. J’oublie L’Harmattan, le patron et tout ça. Et ce matin, je reviens au travail pour apprendre par les collègues ce qui s’est passé pour Graffin. Vous ne me croyez pas ?
− Vous n’étiez au courant de rien ?
− De rien. Je vous répète, chez moi, c’est vraiment la brousse et je mets un point d’honneur pour qu’on coupe tout contact avec l’extérieur quand je suis là ! Je sais, c’est idiot, mais c’est comme ça que je vois les congés, moi. J’ai bien un portable mais lui aussi est resté fermé toute la semaine.
– Et alors ?
– Alors, depuis ce matin, je raconte mon histoire aux uns et aux autres, aux collègues, à des gens de la direction mais tout le monde a l’air de s’en foutre ; on me dit que c’est pas la peine, que le coupable a été arrêté, que le dossier est bouclé ; je suis un peu déçu ; les gens ne se sont même pas intéressés à la photo.
– La photo ? Quelle photo ?
– Celle ci.
Mambo manipule quelques touches de son portable qu’il tend à Magali. Sur l’écran apparaît une salle de restaurant. Un boui boui plus exactement. Au premier plan, un couple de touristes européens, des quinquas hilares, font un V de victoire, comme si leur pays venait de remporter la coupe du monde ; derrière eux, un peu plus loin, on distingue, assis, de face, un homme de haute taille ( « Graffin » dit Mambo en le montrant du doigt) et, de dos, un homme et une femme qui discutent, ou se disputent ; lui doit être le chauffeur, la femme porte un boubou jaune pétant.
– J’avais un groupe de touristes canadiens dans mon car, explique Mambo ; c’est pas très fréquent mais ça arrive ; j’en ai toujours un ou deux par semaine, des touristes, pas des canadiens, du genre de ceux qu’ont pas peur de se mêler à l’autochtone et de voyager à la dure avec l’indigène. Remarquez, avec tous ces enlèvements récents, on n’en a de moins en moins, des touristes... Ce que je comprends. Bref, je fais donc ma pause à « L’Harmattan » et mes touristes, ceux que vous voyez là, sur la photo, veulent un souvenir de l’intérieur du routier ; mais ils n’ont pas leur appareil sous la main, il est au fin fond de leur valise qui elle est au fin fond du car. Résultat ? je propose mon portable, ils pourront toujours récupérer après la photo sur leur engin, que je leur dis. Ça se fait, des transferts, non ?
Magali, qui ne veut pas avoir l’air d’être restée au poste à galène, acquiesce vaguement, tout en scrutant toujours le cadre de la photo.
« Mais une fois à Kayes, faut dire qu’il faisait nuit, je l’ai déjà dit, et que tout le monde était fatigué, les Canadiens filent à leur hôtel en oubliant de me demander la photo ; au bled, je ne pense plus à cette image non plus, je ne pense même plus au portable, c’est vous dire. C’est de retour en ville, ce matin, en apprenant ce qui était arrivé à Graffin...
« Et Boubakar ?
« Quoi Boubakar ? Le chauffeur de Graffin ?
« Oui, vous le connaissez Boubakar ? Qu’est ce qu’il dit de tout ça ? Pourquoi il était pas là ? Il se fait remplacer auprès de son patron, cette nuit là justement ? Pourquoi ? Par qui ? Le patron est zigouillé ! C’est un témoin de première main, Boubakar, non ?
« Je l’ai un peu cherché ce matin, mais il est invisible. Et puis, silence radio. Il répond pas au téléphone, il fait le mort, à mon avis. Remarquez, moi, à sa place...
« Vous savez où il est ? Où il habite ?
« Il doit être chez sa fille. Probablement.
« A Kayes ?
« A côté.
« Si je vous véhicule, vous me guidez ? J’aimerais bien lui parler.
Mambo n’a rien d’autre à faire, la ligne de car est interrompue. Pour cause de deuil. Il accepte.
Sur le chemin, Magali pense passer par l’hôtel, histoire de récupérer des notes. Devant l’entrée se tient un petit rassemblement ; au centre, elle voit Issiaka qui pérore. Au dernier moment, elle laisse tomber, contourne le jardin, retombe sur la gare et prend la direction de Médine que lui indique Mambo. Elle lui parle de cette histoire de voleur de sexe, lui fait part de sa stupeur. La putain de rumeur continue manifestement de se propager. Ces gens autour d’Issiaka, devant son hôtel, c’est pas normal ! Elle tente de plaisanter. Mambo, énigmatique, dit :
« Celui qui a un pou dans son pantalon se gratte et le cherche chez lui.
« Traduction ?
« A chacun ses affaires.
« Merci de votre soutien, dit-elle contrariée.
Il semble ne pas entendre. Mais la gêne entre eux ne dure pas.
« Direction fort de Médine, donc, commente l’homme. La fille de Boubakar y a trouvé un petit job, elle aide l’équipe de restauration du bâtiment ; c’est pas très loin mais la route est mauvaise ; on en a pour une heure. »
Durant le trajet, Mambo lui apprend que le fort a abrité les réserves en or de la Banque de France durant la seconde guerre. Magali croit se souvenir qu’Honoré, le diplomate, lui en avait déjà glissé un mot à Paris. Il y a un siècle. Elle fabule, imagine un casse puis un film sur le casse. Casting idéal : l’équipe de « Taxi pour Tobrouk », Ventura, Birod, Aznavour... Ils n’auraient pas été trop dépaysés, de Tobrouk à Kayes, on dirait que c’est un peu la même dune qui se répète... Magali se demande soudain si elle n’a pas des goûts de vieux... A propos de vieux, d’ailleurs, elle pense à ce vétuste marin breton qui, au coin d’un bar de Penmarc’h, l’hiver dernier, répétait à longueur de journée : « Mais qu’est ce qu’on a fait des milliards ? » On l’écoutait sans l’entendre. Tout le monde pensait qu’il parlait des subprimes ? Ou des cadeaux de Sarkozy aux banques. Ou simplement qu’il avait perdu la boule ? Erreur. Elle avait eu la curiosité de l’interroger et finit par découvrir que l’ancêtre faisait partie du commando de marine qui avait assuré l’expatriation des caves de la Banque de France. L’exfiltration des lingots, plus exactement, pour fuir l’avancée des nazis, durant l’été 40. Peut-être même était-il venu jusqu’à Médine ?! Là, son itinéraire paraissait assez flou. Bateau + train ? Ou bateau + chameaux ? En tout cas, le gaillard semblait avoir zappé tout ce qui avait fait sa vie depuis ce raid. Comme s’il n’était jamais vraiment revenu de son expédition.
Au bord du fleuve Sénégal, au milieu de rien, le fort est une large bâtisse d’un étage, faite de grosses pierres ocres. Sur la terrasse se dresse un mur crénelé, comme au sommet d’un château-fort. Une grande porte centrale, flanquée de part et d’autre de larges fenêtres. Toute la façade est striée de meurtrières, vides heureusement. L’ensemble forme un poste d’observation idéal sur le cours d’eau.
La fille de Boubakar, Oumou, est seule sous une vaste tente militaire, qui flanque un mur de la bâtisse, occupée à du rangement ; le reste de l’équipe est rentré à Kayes. On se présente, on papote. Oumou prépare le thé, une interminable manipulation où elle transvase le breuvage d’un verre à un autre, recommence l’opération plusieurs fois. Le thé est délicieux, âpre, presque liquoreux. Mambo l’interroge sur le chantier, la famille, le père. Il a disparu, dit-elle. Mambo insiste, réussit à la convaincre que Magali n’est pas un flic. Au troisième verre, Oumou reconnaît à demi-mots que le géniteur se cache, le long du fleuve ; il rentre le soir, jamais à la même heure, pour manger ce qu’elle lui prépare, puis il se sauve à nouveau. La jeune femme en fait est furieuse contre son géniteur :
« Il terrorisé par ce qui est arrivé à son patron, terrorisé et honteux aussi ; lui qui avait une réputation d’employé modèle ! Il n’osera plus jamais se manifester à Transfer. Après vingt ans de carrière, un abandon de poste pour aboutir à ça. Il va en mourir de trouille. Et d’humiliation. Quel idiot ! »
Les premiers jours où il est venu se planquer près du fort, il ne voulait rien dire. Maintenant, elle sait le fin mot de l ’histoire. Il s’est fait acheter, ce n’était pas son genre pourtant.
« Mon père était un type intègre, austère, il pouvait vivre avec trois dattes et de l’eau fraiche... »
Mais il a craqué. Pour de l’argent ! Du fric qu’il n’a pas encore touché d’ailleurs. 1000 euros. Un vrai coup de folie. Un type qui lui a demandé de pouvoir le remplacer 24 heures !? « Vous imaginez ça, vous ? » S’il connaît le nom de son corrupteur ? Non. Jamais vu. Et la voiture ? Disparue, mais ça devrait pas être trop dur à retrouver, une Mercedes 300 bleu métallisé, immatriculé TRANS 2000, ça court pas les oueds. Maintenant, elle a très bien pu être ripolinée et recasée au marché noir. En tout cas, c’est le circuit classique ici. Ça circule vite ce genre de choses dans toute l’Afrique occidentale.
« Voilà, j’ai tout dit, alors s’il vous plaît, laissez mon père tranquille et sauvez vous. Sinon il ne viendra jamais manger, je le connais comme si je l’avais fait. Quel idiot, vraiment ! »
« On n’a quant même pas tué le Flamand pour une voiture, même une grosse voiture ! On va pas me dire que c’est une histoire de « coupeur de routes » s’indigne Magali durant le retour, à moitié convaincue.
Chapitre 15
Bamako, vendredi
Racine continue de faire des rêves étranges. Cette nuit, ses visions étaient moins stimulantes que la danse des sept voiles mais passablement inquiétantes ; il était perdu dans une ville où tous les habitants, les noirs comme les blancs, les jeunes et les vieux, hommes et femmes, tous portaient des chapeaux rouges, tous roulaient des yeux immenses et se saluaient les uns les autres en répétant « Y a bon ! Y a bon ! » Cette histoire d’archives consultées dans le bureau de Mimi va lui miner le sommeil.
Il profite d’ « Oeil de lynx » et de sa Vespa pour se faire conduire à l’ambassade. Le garçon trace sa route au milieu de la cohue matinale. Tout Bamako s’est donné rendez-vous sur le bitume, limousines aux vitres teintées et forçats tirant d’imposantes charrettes à bras, jeunes élégantes en boubou et scooter et paysans houspillant des cordées d’ânes, taxis démantibulés et essaims de vélos. Une expédition.
A la mission française, Racine croise le consul. Il l’informe de ses dernières aventures, le sac retrouvé avec ses papiers, les démarches de renouvellement désormais inutiles ; puis il passe à la bibliothèque du site pour regarder la presse. Section archives, rayons micro-films. Il a une idée bien précise puisqu’il demande la bobine d’avril 1978, consultable sur une table de visionnage assez rudimentaire. Elle est disponible mais le résultat est décevant ; la presse malienne, en dehors de l’encadré du tonton dans « Le canard déchaîné », déjà repéré, ne pipe mot de l’incident. Dans les quotidiens français, très peu d’informations sur le Mali, ce mois-là, et aucune qui fasse état de la disparition de compatriote. Il change d’orientation et dépouille les rubriques nécrologiques. Là encore il fait chou blanc. Prêt à laisser tomber, il survole sans conviction le carnet des petites annonces du Figaro, rubrique deuils. Là, il tombe sur un encadré à la date du 22 avril : la famille Danian, épouse, enfants et petits enfants réunis, fait part du rappel à Dieu de Michel Danian, général (honoraire), à Bamako (Mali), la date exacte de la mort n’est pas précisée. L’annonce fait encore état d’une « cérémonie religieuse (qui) sera célébrée en l’église St Sulpice, Paris, le 6 mai. Un registre de signatures tiendra lieu de condoléances. Pas de plaques. »
C’est maigre comme information mais Racine n’a guère le choix. Et puis ça peut coller avec le personnage du « suicidé ». Un Français, un notable, mort à Bamako, en avril 1978, ça ne devait pas courir les institut médicaux-légaux ; il s’agirait donc d’un militaire, un général à la retraite. Racine a l’impression d’avoir bien travaillé. Dans la foulée, il regarde une sorte de « main courante », une série de registres en fait où, depuis l’indépendance, chaque semaine, l’ambassade enregistre les principaux faits de la communauté française au Mali, assemblées, fêtes, projection de films, visites marquantes. Comme il s’y attendait un peu, il n’y est pas question d’officier disparu à cette date. Rien, motus, même en interne. Il fallait vraiment que le sujet dérange. Tout a été fait pour écraser. Il demande l’avis du bibliothécaire, jeune homme précieux et affable ; celui-ci laisse entendre que certains silences sont diplomatiques. C’est à dire ? Qu’on se tait pour ne pas en rajouter, c’est fréquent. Ensuite, il fait remarquer qu’en 1978, lui-même n’était pas né... Et il n’y a plus personne de cette époque en place à l’ambassade pour témoigner.
« Sauf Ben... Mais alors là, Ben...
L’employé ne termine pas sa phrase, fait un vague geste du bras, laissant deviner que le Ben en question n’est pas vraiment sa tasse de thé.
« Et Ben, je le trouve où ?
« En sortant, à droite...
Racine prend note, remercie et teste encore l’histoire du chapeau rouge. « Si je vous dis chechia.... ». Le fonctionnaire tombe des nues puis affiche le sourire de celui qui se dit qu’on se fout de sa poire.
Ben garde la porte du garage de l’ambassade, ou plutôt on lui laisse croire qu’il la garde. Ben est là depuis toujours, semble-t-il, cerbère bénévole et cérémonieux, mendiant classieux, clodo mondain. Long, mince, une casquette de chauffeur, un marcel immaculé, un pantalon au pli impeccable. Il répond, très protocolaire, aux questions de Racine. Oui, il aime son travail. Oui, était là en 1978. Oui, il s’occupait déjà du garage. Oui il connaissait tout le monde à l’époque. Même un certain Michel Danian ? Là, Ben soudain se métamorphose. Le guindé, le maniéré, le révérencieux Ben pique une colère carabinée, pousse des jurons genre « Astafourlaye ! » ou « Soubahanall » ou encore « Ah kabako ! » Racine n’y comprend rien mais il devine que le message est plutôt furibard. Ben tourne brutalement les talons et disparaît. Il part, gesticulant, il fuit plus exactement. La scène doit sembler si saugrenue à l’agent de sécurité, à la porte de l’ambassade, qu’il vient demander à Racine ce qu’il a bien pu demander au vieil homme. Car enfin, c’est la première fois depuis... toujours que Ben déserte ainsi son poste.
Chapitre 16
Kayes
Vendredi / Samedi
De retour de Médine, Magali obtient de Mambo qu’il lui laisse, 24 heures, son portable ; elle veut faire une sortie papier de la photo ; il accepte. S’approchant de l’hôtel, elle redoute de tomber sur Issiaka, sa « victime », mais l’attroupement mené par l’adjoint du commissaire a disparu. Elle tente de joindre Fernande ; la jeune femme est en réunion mais promet de lui rendre visite dans la soirée.
Magali se fait servir à dîner au « jardin ». Surprise ! Papa occupe une table voisine ; elle l’informe de ses recherches mais évite de parler de Boubakar et de sa fille, lui montre le portable avec la photo. Papa apprécie et c’est peu dire. Le cliché pris à l’intérieur de L’Harmattan le captive. Sa contemplation l’absorbe un long moment. Il lui demande de pouvoir garder l’appareil, elle le lui laisse jusqu’au lendemain. Le commissaire est le seul à disposer dans le coin d’une imprimante et lui a promis une épreuve.
Le flic est en veine de confidence.
« A charge de revanche, je vais vous dire quelque chose... »
Il sourit, se fait désirer puis déclare tout à trac :
« Je ne sais pas qui a tué Graffin mais je crois savoir pourquoi on l’a tué... C’est déjà ça.
« ?!
Selon lui, l’Afrique de l’Ouest est en proie au trafic de drogue :
« De la cocaïne, mademoiselle, de la cocaïne partout ! Une invasion ! Toute la côte est envahie par les sud-américains, les Colombiens notamment ; pour eux, notre région est devenue une étape vers l’Europe.
Il dégage la nappe, y dessine, à grands traits, une sorte de croupe, y griffonne des noms de pays, Sénégal, Guinée, Guinée Bissau, Côte d’ivoire...
« Il leur suffit, aux Latinos, de passer l’océan, d’accoster ici avec des complicités locales ; ensuite ils tracent un couloir, un corridor de drogue, et d’armes aussi, où ils écoulent des tonnes de marchandises, qui représentent des milliards de chiffre d’affaires. La région, notre pays y compris, est une plaque tournante depuis longtemps. Mais elle devenue chaotique. La Cote d’ivoire est divisée, la Guinee Bissau est en déshérence ; Casamance pourrit la vie du Sénégal ; la Guinée, n’en parlons pas... Les mafieux s’adaptent mais ils n’aiment pas trop le désordre, c’est jamais bon pour le bizness.
Magali ne voit pas bien où le flic veut en venir.
« Pour eux, la ligne Bamako-Dakar, ça peut les intéresser, vous comprenez ? C’est un axe stable, régulier, au bout duquel il y a Dakar. Et Dakar, c’est déjà l’antichambre de Paris. Alors, on assiste à une pression des Colombiens pour prendre pied sur cet axe… L’autre jour, encore, on a découvert un wagon marchandise plein de containers bourrés de poudre. Vous l’avez peut-être lu dans la presse ?
Il fait une pause, demande l’addition, propose de régler le repas de Magali ; elle refuse, évidemment.
« Vous voyez où je veux en venir ?! La ligne Bamako-Dakar, c’est Graffin ; les Colombiens veulent utiliser la ligne, passez moi l’expression...
« ?!
« Oui, la ligne, la coke... Bon, bref. Les Colombiens font pression sur Graffin ; Graffin, pour des raisons qui lui sont propres, refuse ; alors les Colombiens le tuent. CQFD.
Magali apprécie la logique de la démonstration mais trouve que ce lapin soudain sorti du chapeau est trop beau. Le flic sourit, malicieux :
« Vous verrez bientôt que j’ai raison...
Ils se quittent, plus amis que jamais, sur la promesse du pandore d’imprimer la photo et de rendre vite le portable.
« Je vais montrer le cliché à un confrère, il connaît mieux le dossier que moi. »
Papa s’éclipse, Fernande arrive.
« Vous auriez pu vous croiser ! Note Magali.
Les deux jeunes femmes vont prendre un verre dans une boîte proche, « le Casino ». L’enseigne lumineuse de l’établissement, de fins néons d’un rouge vif, représente un couple qui danse, l’homme en smoking, la femme en robe longue, un attirail pas vraiment adapté à l’endroit ou au climat mais bien conforme aux standards des dominants. L’animateur de la soirée bonimente au micro, il jacasse sans fin, empiète sur la musique, sa tchatche est transmise sur hauts parleurs, tout le quartier en profite. « Saga Afrika, attention les secousses » joue à deux reprises l’orchestre, sans doute en hommage à Magali. Les filles dansent, boivent, se font draguer, ne retiennent personne.
« Avec ma réputation, je ne vais pas garder beaucoup de clients... se moque Magali.
« Ta réputation ?
« Suis voleur de sexe, je t’avais pas dit ?
« Un jour, tu vas tomber sur un os.
Deux heures du matin. Fernande demande à son amie de pouvoir partager sa « cambuse », c’est le mot qu’elle utilise, elle ne se sent pas le courage de retourner chez elle.
« En tout bien, tout honneur, sourit-elle.
« T’es vraiment pas mon genre !
Elles embarquent une bouteille de cognac à demi entamée à la barbe du serveur, pouffent de leur malignité. Personne à la réception, le hall est désert. Une volée de marches conduit à l’étage et à la chambre. Le corridor est sombre. Eméchée, Magali ne trouve pas l’interrupteur puis renonce à éclairer ; de la fenêtre, en effet, une timide lumière, d’un rose sale, celle de l’enseigne du « Casino », tamisée par de lourds rideaux, barbouille la pièce et chasse suffisamment la pénombre pour se repérer. Les filles se déshabillent sans se regarder, sans parler soudain, fixant le carré de lumière comme un écran, apparemment intimidées ou troublées par cette atmosphère imprévue de lupanar. Une douche ? Pas de douche. Elles s’allongent. Personne ne touche au cognac.
Longtemps on entend en sourdine, entre deux blues mélancoliques, le bavardage de l’animateur du club ; le type est infatigable.
« Tu dors ? » demande Magali ; pas de réponse. Le lit est grand ; on peut s’y croire loin l’une de l’autre. Mais quand Magali pivote, elle se retrouve nez à nez avec Fernande, les yeux dans les yeux - ceux de sa partenaire captent l’éclat rosâtre de la pièce, donnant à son regard une intensité douloureuse ; leurs bouches sont bord à bord.
Magali rit, puis très vite se tait.
Qui donc lui a parlé de ces visiteuses qui hanteraient les couloirs de cet hôtel en murmurant : « C’est l’amour qui passe... » ?
Fernande pose ses doigts sur le sein menu de la journaliste ; il est juste à la taille de sa paume. Un bon signe ? Magali tremble un peu, puis sa main à son tour caresse le cou de la malienne, longe l’épaule, effleure la poitrine, descend le long de la hanche, explore le fessier, refait lentement le périple dans l’autre sens, épouse ses sinuosités, escalade les dunes, glisse vers les ravines, puis s’attarde sur le satin de l’entre-jambes et plonge enfin dans la fente, fouit les entrailles. Les gestes se précipitent, les peaux se rapprochent, les bouches se collent, les langues fusionnent, les dents s’affrontent, les doigts tricotent, les souffles s’accélèrent, les corps s’emboitent, se sentent, le désir de l’une grandit avec le contentement de l’autre.
Plus tard, Magali aura l’étrange impression d’avoir jusque là baisé, alors qu’aujourd’hui elle a fait l’amour mais elle se gardera bien de le dire à Racine.
Epuisées, ravies, silencieuses, et n’en finissant plus de se contempler, les jeunes femmes s’endorment, enlacées, toujours bercées par l’écho du babillage de l’infatigable baratineur du « Casino ».
Au petit jour, elles sont réveillées par l’accueil.
« Un appel urgent pour Mme Magali » dit le réceptionniste. Elle prend le combiné. Une voix européenne, chantante, un fort accent méditerranéen, qui se présente :
« Battisti, Antonio Battisti.
« Enchanté. On se connaît ?
« Je suis le représentant régional de l’ONUDC.
« C’est à dire ?
« L’ONUDC : le bureau des Nations unies contre les drogues et le crime.
Magali fait la moue. L’ONU au réveil ? En quel honneur ? Fernande, qui a pris les écouteurs, la chahute, lui fait comprendre avec force gestes de ne pas lui parler de son talent de voleur de sexe. Magali hausse les épaules.
« Papa m’a fait passer votre portable hier soir.
« Les choses vont vite.
« Façon de parler. La photo est intéressante. Je crois avoir reconnu la personne sur le cliché.
« Celui qui fait face à Graffin ?
Il répond par une autre question :
« Vous pouvez venir me voir ?
Rendez-vous est pris une heure plus tard, chez lui, qui est aussi son bureau.
Fernande s’étire, se change, réapparaît dans un tailleur moutarde de secrétaire sexy. Magali la trouve rayonnante. La malienne doit se rendre à l’antenne locale de son école d’administration. Un employé apporte le plateau du petit déjeuner. Elles se le partagent. Restée seule, Magali jette un oeil aux informations télévisées. Une journaliste, élégante, vive, parle d’un nouvel enlèvement d’humanitaire dans le Nord, un Français de 78 ans ; on raconte qu’il aurait été kidnappé par des touaregs qui l’auraient ensuite revendu à des intégristes islamistes d’une des mouvances d’Al Qaeda au Maghreb. Magali zappe.
Un peu plus tard, elle retrouve sa Méhari. Ça bouchonne dur en ville. A un carrefour, en pleine chaussée, une vache est étalée, les quatre pattes en croix, elle a fait le grand écart. Un jeune paysan la tire par le licol, la frappe, la bête est épuisée, ce couple gêne la circulation, mais il n’y a personne pour venir en aide à l’animal ; tout le monde klaxonne et contourne l’obstacle.
Chapitre 17
Bamako
Samedi matin
Ça crie, ça piaille, ça rit, ça s’égosille sous les piles du pont du roi Fahd où Mimi et Racine retrouvent les enfants en train de barboter dans le fleuve Niger. Difficile de se croire dans le centre ville entre ce double alignement de gigantesques pilonnes qui portent, tout là haut, le plateau -voute de la route. On s’imagine plutôt dans une sorte de cathédrale où les voix des gamins, suraigües, se font écho ; les mômes improvisent des bouées avec tout ce qui flotte, ils ont des bouts de polystyrène au bout des doigts ou des pieds, jusque dans les narines. De toute façon, ça ne sert à rien, ils ont pied.
Le couple se sent soudainement investi de devoirs parentaux. Pour Racine, c’est très étrange comme sensation ; c’est même la première fois qu’il l’éprouve et s’en trouve fort ému.
Mimi rumine la récente découverte que son libraire a faite à l’ambassade. Danian, Danian, le général Danian, le général des WC... Elle connaît ce nom ; elle a déjà entendu parler de ce type. Mais où ? A la télé ? Dans la presse ? Sur internet ? Danian...
Le déclic se fait au moment où « Oeil de lynx », juste sorti de l’eau, la peau luisante et perlée de gouttes, leur demande de louer un DVD. Cinéma ! Danian = cinéma. Le nom de Danian apparaît dans une critique d’un film d’Ousmane Sembene que Mimi a archivée il n’y a pas très longtemps. Un film de...1988 qui raconte une histoire plus vieille encore, façon de parler. Elle prend Racine à témoin. Il s’épanouit, le libraire adore qu’on lui raconte des histoires. Il va être gâté.
On est à la fin de la guerre, en novembre 1944. Paris est libéré depuis trois mois, des prisonniers de guerre français commencent à rentrer chez eux, avec les honneurs et un pécule.
« C’est le cas aussi des troupes coloniales, les Africains notamment, longtemps appelés indistinctement T.S., tirailleurs sénégalais, on en a déjà parlé, à propos de la pub Banania... Tous n’étaient pas originaires du Sénégal, bien sûr, il y avait là des Maliens, des Nigériens, des Ivoiriens... Mais les colons – et l’administration- n’allaient pas s’em.. à faire le distinguo ; pour eux, c’étaient tous des noirs, ils devaient tous s’appeler Bamboula et tous venir... de Dakar. Pourquoi compliquer quand on peut simplifier ? L’imaginaire colonial faisait dans le facile. »
Les « Sénégalais » en question, qui avaient déjà été mis aux avants-postes pour faire peur aux Allemands en 14/18, avaient été ressortis en 39/40. Les combats, la prison. Quand ils ont eu la malchance de tomber entre les pattes des nazis, surtout s’ils leur ont résisté, ils ont été tout simplement massacrés. Pas de quartier pour ces sous-hommes. Ce fut le cas, en juin 40, du 25e Régiment de Tirailleurs sénégalais, à Chasselay, près de Lyon. Ces « Français » avaient eu le toupet de tenir leur position, de vendre chèrement leur peau. Ceux qui s’étaient rendus, une soixantaine de survivants, se retrouvèrent en face de la division SS « Tête de mort ». Fusillés sur le champ... Et oubliés par les manuels d’Histoire.
Racine s’arrête dans la première boutique venue et offre une tournée générale de glaces. Puis il ajoute son grain de sel, complétant le topo de Mimi :
« A la Libération, je sais qu’un fort contingent de T.S. rentre en Afrique. Et s’ils reviennent, figure-toi, c’est pas seulement pour remerciement de services rendus. J’ai appris, il n’y a pas longtemps, que cela répondait aussi à une demande des Américains. Les Yankees ont beau avoir incorporé des Blacks dans leur armée, ils restent viscéralement racistes. Et ils font pression sur les responsables des troupes françaises, les FFI de de Gaulle, pour que ceux-ci ne casent -si j’ose dire – pas trop de noirs dans leurs troupes ?!
Oeil de lynx qui écoute, intrigué, s’indigne de ce qu’il vient d’entendre mais Mimi lui brûle la politesse :
« OK. Novembre 44, donc : un plein bateau de militaires africains, sortant d’années de galère, débarque au Sénégal. On parque ces soldats au camp de Thiaroye. Un camp, encore un, certes pas de rétention mais bon... »
Ces gens, un bon millier, sont donc originaires de toute l’Afrique de l’ouest ; il y a parmi eux pas mal de Maliens. Ils ont souffert, d’un long exil, des prisons, des brimades et en même temps ils ont un moral de vainqueurs, ils ont la fierté d’avoir tout traversé, d’avoir survécu et aussi d’avoir participé, à leur manière, à la Victoire qui est en train de s’écrire. Mais leur retour au pays se passe mal ; ils retrouvent une société coloniale qui a préféré jouer la carte vichyste avant d’opter mollement et tardivement pour de Gaulle. Et les blancs au pouvoir voient d’un drôle d’oeil ces colonisés trop sûrs d’eux. C’est pas du tout dans la norme ! Des esclaves qui se la pètent, ça fait désordre ! Ce sentiment traverse également l’encadrement militaire ; la hiérarchie se méfie de ces soldats-là. Bref, les nouveaux venus ne sont pas vraiment les bienvenus dans leur pays !
« D’ailleurs, sourit tristement Mimi, pour bien leur faire comprendre que la fête est finie, ils sont désarmés, ils doivent même rendre l’uniforme pour endosser une tenue des colonies, un costume grossier de toile blanche et une chechia.
« Le chapeau rouge ?!
« La chechia ! Exact.
On les encaserne, donc, en tardant à les libérer pour de bon ; ça commence à grogner dans les rangs ; on leur refuse la même pension que celle attribuée aux militaires de la métropole ; enfin, et c’est sans doute ce qui va mettre le feu au poudre, le change de leur solde, de francs en monnaie locale, se fait à la moitié de sa valeur. Ils se sentent volés, déclassés, rétrogradés. La colère, la frustration sont telles que, le 30 novembre, ils se révoltent et retiennent, quelques heures, en otage, à Thiaroye, le plus haut gradé...
« Le général Danian ?!
« Tout juste.
Ce dernier pète de trouille, il promet tout, la reconnaissance des mérites de ces militaires, leur rapide libération, l’argent auquel ils ont droit, un taux de change convenable, tout, il promet tout. Naïfs, les soldats le croient. Un chef, un général, ça peut pas mentir. Ils le libèrent. La colère a duré quelques heures, il n’y a pas de casse. Aussitôt sorti du camp, Danian appelle la troupe cantonnée à Saint Louis, dans le Nord du Sénégal et la fait descendre sur Dakar. Celle-ci arrive dare-dare par le train. Car il y avait une ligne à l’époque, St-Louis-Dakar. Et à 3 heures du matin, le 1er décembre, cette troupe prend d’assaut le camp. Il est pilonné à l’arme lourde, avec l’appui des chars, alors que les occupants sont désarmés. C’est un massacre. Un véritable massacre. Il y a plusieurs dizaines de morts d’un seul côté, celui des porteurs de chéchias, de nombreux blessés aussi ; bien des hommes sont jetés en prison où ils resteront pendant des années.
« Et tu crois... ?
– Quoi ?
– Que le général de 1944 et le retraité de 1978...
– Oui ?
– Ce serait un seul et même homme ?
Le couple est tout excité par ce rapprochement.
Ils regardent les enfants qui les précèdent, se confiant à eux dans un total abandon ; les mômes les conduisent vers une pizzeria en face de la poste centrale. Ces quatre-là ont alors l’air d’une famille presque modèle. Simplement, les adultes passent la commande puis abandonnent, à table, leur progéniture et retournent au bureau du journal, à deux pas.
Mimi recherche le dossier de presse du film. 1988, il a dû être numérisé. Elle fait défiler les fichiers, retrouve sans peine le document en question, le parcourt et hurle, littéralement :
« Whaouuuu ?! Tu devineras jamais qui dirigeait la troupe venue de St Louis ?
« ?!
« Le capitaine Graffin.
Chapitre 18
Kayes
Samedi, 12h
Battisti se livre à un exercice difficile ; il caresse de sa main gauche l’oreille gauche de sa chatte tigrée Zoé, ronronnant sur ses cuisses, tout en tapotant, de la droite, en peaufinant plus exactement pour la énième fois, sa note de synthèse sur le clavier de son ordinateur. Il ne tape que d’un doigt, l’index ; ça fait des décennies qu’il pratique mais il n’a jamais été foutu d’utiliser le reste de la main ; ça fait partie de quelques unes de ses limites. En règle générale, d’ailleurs, il ne faut trop pas lui demander de choses pratiques, il est handicapé grave de ce côté. Le genre à mourir de faim près d’une boîte de conserve car infoutu de l’ouvrir... Sa chatte Zoé l’a accompagné dans tous ses déplacements ces dernières années, elle a connu le Liban, les Antilles et maintenant l’Afrique ; c’est un petit animal un brin maniaque, qui ne mange que des crevettes – et encore il ne faut pas la regarder sinon elle boude- et ne boit que de l’eau du robinet, à la condition que coule un mince filet de liquide froid.
Battisti joue à lui replier l’oreille, d’ordinaire dressée comme un bonnet de nuit ; du coup ça lui fait un drôle de petit chapeau, blanc-rose, hérissé d’une touffe de poils raides. Elle se laisse faire. Battisti joue mais sans y trouver de plaisir ; car ce matin, il est inquiet. Il croyait avoir tout vu mais là, cette histoire d’avion en plein désert, franchement, ça le laisse sur le cul. C’est du « coke en stock » au carré, cette affaire ! Pour l’heure, il n’y a pas grand monde au courant. Quelques officiels maliens, sa propre hiérarchie, et c’est tout. Mais les médias finiront bien par le savoir, c’est trop gros pour écraser ça.
Battisti rentre du Sahel. Plus aride, c’est pas possible. C’est sable sur sable et plat de chez plat, 40° quand ça va bien mais beaucoup plus d’ordinaire. Bref, le coin perdu par excellence. Un four. Encore heureux qu’il ne se soit pas tapé une tempête de sable ?! Son chauffeur lui racontait qu’il y a un mois de ça, en pleine tempête, il s’était arrêté près d’un village, pour un petit besoin urgent. Il avait du faire un pas de côté, un pas de trop, résultat, au retour, pas moyen de retrouver la bagnole, ni les maisons. Il va marcher quatorze heures, sans rien voir, avant de retomber sur sa fourgonnette, et le hameau ! Quatorze heures de déambulations aveugles ! C’est dans ce paysage lunaire que Battisti est tombé sur la carcasse du Boeing 727. L’appareil était couché sur le flanc gauche ; le cockpit était à peu près intact mais toute la partie centrale était éventrée, explosée, ravagée, incendiée, des bidons dans le coin signaient le forfait. Lorsqu’il était arrivé sur les lieux, trois bédoins étaient déjà en train de se disputer les restes, comme des vautours, et tentaient de découper les ailes. En vain. Des forgerons, qu’ils disaient être ; ils voulaient récupérer le métal. On pouvait les comprendre, se disait Battisti, un Boeing 727, c’est pas un deltaplane. Un triréacteur de 50 mètres de long, 30 mètres d’envergure, on peut en couper des plaques là-dedans, il y a de quoi faire des toitures pour tout un bidonville ou des palissades ou encore des montagnes de poignards, de peignes, de casseroles et autres tôles et ustensiles... Un vrai cadeau du ciel.
Il a tout de même renvoyé ces prédateurs chez eux, non sans avoir fait soigner le plus jeune qui s’était salement blessé en s’attaquant à la carlingue ; puis il avait inspecté la ruine. Les références sur le moteur indiquaient que l’appareil était immatriculé en Amérique du Sud. Il a trouvé aussi dans les parages un carnet à demi calciné ; les indications étaient en espagnol. On avait parlé d’un appareil en difficulté, qui aurait atterri là en urgence et se serait planté au décollage ; il est vrai qu’il n’y avait pas de piste, le sol était tout juste bon pour des camionnettes.
La version de Battisti est tout autre. Il a mené sa petite enquête, vu les gens du coin ; on peut toujours dire que le désert est désert mais quand on cherche un peu, excepté pendant les tempêtes de sable..., il y a toujours du monde. Pas des foules mais des gens ; il suffit parfois de passer la dune pour tomber sur un berger, sur un gardien de chameaux, un humanitaire, un touriste, un margoulin ou un intégriste.
Battisti s’est rendu à la tour de contrôle de Gao, qui d’ordinaire n’est pas surchargé de boulot ; les contrôleurs n’avaient pas vu le Boeing, le lieu du crash échappait à leur écran radar, mais une semaine avant l’incident, ils avaient contacté, par radio, un coucou dont le pilote prétendit avoir perdu son chemin avant de disparaître. Ce zèbre en fait devait être là en repérage ; d’où venait-il ? Mystère. Mais il disposait certainement de correspondants au sol qui ont nettoyé vite fait un semblant de piste. On y a aménagée en effet un bout de terrain, hâtivement aplani, les plus gros cailloux repoussés aux marges. De toute façon, Battisti en était convaincu, le Boeing n’était programmé que pour un seul aller. Genre Colombie – Mali. De le jungle au désert. Il ne servait qu’une fois et il était prévu de le cramer à l’arrivée ! C’est dire si l’équipe qui supervise l’affaire n’est pas regardante en matière de frais généraux.
Les choses ont pu se passer ainsi : l’avion arrive, de jour ou de nuit, peu importe finalement. Il est rempli à ras bord de cocaïne. Il peut en contenir jusqu’à dix tonnes. La livraison est prévu en plein désert malien. Pourquoi là ? Parce que, incroyable mais vrai, la région est devenue l’arrière-boutique du grand marché européen tout proche. Dans ce coin abandonné des dieux, il manque peut-être de vraies pistes mais, avantage de l’inconvénient, l’endroit échappe de ce fait à toute espèce de contrôle aérien. Cohabitent dans ce désert des tribus qui se vendent au plus offrant, des trafiquants qui ont des moyens logistiques et des fanatiques religieux qui jouent les agents de sécurité contre récompense. L’avion s’offre un atterrissage bâclé, le temps pour les Colombiens de livrer leur magot ; une dizaine de pick-up attendent dans le pourtour, des voitures puissantes, avec téléphone sattelitaire. Chacun embarque vite fait sa tonne de blanche et disparaît. Objectif : la Méditerranée. Via l’Est, le Niger puis la Lybie de préférence car le côté marocain est trop contrôlé. Le personnel de bord met le feu à l’engin pour le rendre « illisible » et disparaît à son tour. Ni vu, ni connu. En quelques heures tout était réglé.
Antonio Battisti est sidéré ; il croyait avoir tout vu ; mais les trafics dont il avait été le témoin jusque là, ce n’était que de l’artisanat, de la gnognotte, du gagne petit. Les autres sont passés à l’exploitation industrielle, au Grand Marché Mondialisé, aux technologies de pointe et lui, diplomate de deuxième ordre, au fond de son vieux bureau, accompagné par des fonctionnaires non motivés et quelques militaires sous-équipés, il prétend arrêter avec un lance-pierre ce tsunami ! C’est barrage contre le Pacifique. Le trafic vient de connaître une formidable intensification, se dit-il, il signe avec cette carcasse d’avion une déclaration de guerre. Et lui sait déjà qu’il a perdu le combat.
Antonio Battisti est vraiment secoué, au point de ne pas remarquer que Zoé, sa chatte, vient de se redresser, de s’étirer et de le quitter. A sa manière, c’est une vraie chatte de garde ou d’alarme ; d’ordinaire le félin bouge quand il sent que la porte de l’appartement s’ouvre, il en profite alors pour sortir et visiter les environs ; il ne va jamais très loin, bien trop casanier pour prendre le moindre risque.
Le délégué de l’ONUDC ressent un méchant coup de blues quand il termine de pianoter sa note. Il ne s’est jamais fait beaucoup d’illusions sur ses moyens d’agir mais là, c’est trop. Comme si, dans une course, il venait de se faire méchamment dépasser, distancer, ridiculiser. Comme s’il était toujours dans ses starting-blocks quand les autres passent déjà la ligne d’arrivée. Au même moment, une sorte de doigt métallique lui touche la nuque, appuie fermement, l’obligeant à baisser la tête, encore et encore, jusqu’à heurter du front l’écran de son portable ; on le maintient dans cette position, le nez au milieu du clavier et il comprend que quelqu’un est en train de lire au dessus de son épaule son rapport. Il tente de se redresser, le coup part ; comme il a bougé, la balle lui traverse la gorge, éclabousse de sang le clavier. Battisti pousse un râle, une acre inspiration comme quelqu’un qui étouffe, cherche de l’air quand une nouvelle balle lui traverse le crâne et se fiche dans l’écran. Noir.
Chapitre 19
Bamako, Samedi, 12h
« Graffin, comme le PDG ? De la même famille ? Ce serait incroyable.
Racine est époustouflé. Il relit pour la deuxième fois tout le dossier du « Canard déchaîné » sur le film de Sembène. Il est tellement tourneboulé qu’il ne prête même pas attention aux petits balancements de Mimi qui ne semblerait pas opposée à une nouvelle leçon de Sebar ; elle n’insiste pas.
Dans les archives du journal, il est souvent question d’un « conseiller » technique malien, par ailleurs simple chauffeur de taxi, mais qui connaissait toute l’histoire de Thiaroye de A à Z. Cet homme, un certain Emile Benyahya, dans chacun des entretiens qu’il a donné au journaliste, fait preuve d’un savoir étonnant, méticuleux. Un puits de science, note le rédacteur, remarquant au passage que ce témoin, plutôt d’un naturel taiseux, s’épanouit lorsqu’on le branche sur l’histoire du camp.
« Là, habité d’une étrange ferveur, il ne s’arrête plus ; il sait tout sur tout, tous les noms des soldats, la composition du contingent de St Louis, l’état de la caserne de Thiaroye, la place des baraquements, etc ; à croire qu’il a vécu l’événement ».
En fait, au fil des différents témoignages que livre ce conseiller, on peut grossièrement reconstituer sa propre biographie et celle de son père. Emile Benyahia est le fils d’un cheminot qui travaillait à Bamako avant guerre. Ce dernier est réquisitionné en 1939, part pour la France dont il ne revient que cinq ans plus tard, retenu au camp de Thiaroye. Gravement blessé pendant la reprise en main du site, il est condamné à la prison dont il sortira, au bout de cinq ans, cassé, amer, sans droit ; il est mort en 1978 ou 1979. Emile, son fils, était en quelque sorte voué au culte du père ; il était d’une susceptibilité folle dès qu’on faisait mention de son géniteur.
« Exact, réagit Mimi, qui se souvient alors d’anecdotes circulant au journal à son propos. Il avait un jour cassé la gueule d’un correspondant de presse étranger pour un simple, et mauvais, jeu de mots. L’autre, entendant son nom, l’avait interpelé ainsi :« Y a bon, Benyahia ! » Tu vois le clin d’oeil ?
« Difficile de ne pas le voir.
« Pour expliquer sa réaction, il dira que les colons se foutaient volontiers de son père, et de son patronyme, exactement de la même façon. Le simple fait d’évoquer cette « plaisanterie » rendait le fils littéralement fou furieux ; je crois d’ailleurs que l’équipe de tournage a dû se séparer de lui. Trop tendu, trop explosif, ingérable.
Mimi et Racine bavardent, ergotent, s’aventurent dans des hypothèses de plus en plus déroutantes :
« Et si...
« Si quoi ?
« Si Emile Benyahia ruminait sa vengeance, habité par une rage
« meurtrière ?
« Contre ?
« Contre ceux qui ont fait du mal à son père.
« Et puis ?
« Et puis, un jour, il les croise...
Silence. Peu peu, ils construisent un scénario qui tient la route.
« Tu sais comment je vois les choses ? Dit Mimi. Je me dis qu’Emile n’a pas été chassé du plateau, il a dû se mettre de lui même sur la touche. Car cette expérience était trop dure pour lui, il n’arrivait plus à tenir sa langue, il en disait trop et ça le mettait en danger. Du genre : quelqu’un demande pendant le tournage ce qu’est devenu Danian et lui qui répond : « Il ne fera plus de mal à personne ! »
« C’est possible, renchérit Racine. On peut aussi imaginer qu’au moment de la « blague » sur « Y a bon, Benyahia ! », il dise quelque chose comme : un jour, un toubab m’a fait le coup et ça ne lui a pas porté chance... Tu vois un peu la réaction de l’équipe, quand elle entend des propos comme ça. Bonjour l’ambiance...
Ils opinent, se regardent, sourient, complices ; ils sont à présent complètement immergés dans l’histoire, elle est devenue la leur.
« Problème, interroge Mimi : comment il peut, lui le jeunot, rencontrer le vieux militaire ?
« A l’aéroport ! Réplique instantanément Racine. Pour moi, c’est à l’aéroport. Il est chauffeur de taxi, tu sais ; et un taxi, normalement, passe pas mal de temps dans un aéroport. Je vois Emile, en 1978, ruminer sa rancune, à l’aéroport justement quand un type, un toubab, s’installe dans son taxi ; le type, le blanc, le vieux voit son nom sur son badge, lui fait aussitôt le coup de la blague « Y a bon Benhyahia ». Le chauffeur s’enflamme et, à son tour, découvre le patronyme de son passager, sur un bagage par exemple. Une étiquette : Danian Michel. Il se maîtrise ; l’autre veut aller à l’ambassade ; ils papotent, de la pluie, du beau temps. « C’est la première fois que vous venez à Bamako ? Pensez donc, je connais cette ville comme ma poche, et ceci, et cela. » Le chauffeur comprend vite que son client et le massacreur de 1944 sont bien le même homme. Il le conduit non pas à l’ambassade mais à la gare, réussit à le faire descendre, sous je ne sais quel prétexte. Il a du lui annoncer une surprise, une chose rare ? Emile est armé, depuis longtemps. Le pistolet de son père, un Luger P-08, calibre 9 mm parabellum, seule prise de guerre de l’ancien, ne quitte jamais sa boîte à gants. Au WC, il le menace puis lui impose le port du chapeau rouge et le bute ; ou l’inverse, il le bute puis lui met le chapeau rouge.
Ils s’étonnent tous deux de leur découverte. Mimi prolonge :
« Ensuite, il se met au vert ; il s’attend à une grosse affaire, à un scandale retentissant ; or personne ne bouge, rien dans la presse ou quasiment rien ; il en est presque déçu, et un peu soulagé tout de même car cela lui assure l’impunité. Il reprend finalement son travail, personne ne le soupçonne, bien sûr. Et surtout, personne ne veut vraiment enquêter sur l’affaire Danian ni réveiller ce vieux contentieux du camp de Thiaroye. Ni du côté malien qui, à ce moment là, a la tête ailleurs, pour x raison, ni du côté français qui ne souhaite vraiment pas qu’on reparle alors de cette page noire.
Les amants en sont convaincus, les choses ont du se passer ainsi ; ils se taisent, un peu comme des marcheurs qui feraient une pause avant de reprendre la route. Racine attaque à nouveau, un temps plus tard :
« Et il aurait remis ça, notre Benhyahia, avec Graffin, enfin avec le fils Graffin ?
Là, ils sèchent. Le lien est plus dur à faire. Puis Racine ose :
« On sait où il habitait ?
« Emile ?
« Bin oui.
« Il y a une adresse dans le dossier. Mais c’était à l’époque. A l’époque du film. En 1988. Il travaillait juste à côté de l’hippodrome.
« On y fait un tour ? On connaît son nom, son âge approximatif, son métier...
« On risque rien de se renseigner.
Chapitre 20
Kayes
Samedi, 14h
La chatte grise, sur le pallier, attend sagement qu’on lui ouvre la porte ; c’est à peine si, en regardant Magali, elle se permet un léger miaulement pour appuyer sa demande. Le siège de l’ONUDC est au rez de chaussée d’un immeuble qui jouxte la tour couronnée de la BCEAO, la Banque de l’Afrique de l’Ouest. La jeune femme frappe, pas de réponse, elle ouvre. La pièce est dans la pénombre, les rideaux tirés ; il y a dans l’air une drôle d’odeur qu’elle ne parvient pas à identifier. Derrière le bureau, à deux pas du seuil, un homme a la tête effondrée sur son portable qui a l’air de se refermer sur ce crâne comme des mâchoires. Battisti ? L’ordinateur est explosé, maculé. La chatte disparaît, la situation devient soudain trop compliquée pour elle, elle aime mieux se cacher. Magali approche doucement du bureau, comme si elle craignait de réveiller le diplomate. Le vacarme dans le quartier est permanent, elle se dit que les voisins n’ont probablement pas entendu grand chose. Un suicide ? De la fenêtre donnant sur le parking intérieur lui parvient un bref rugissement. Elle a juste le temps d’écarter la voilure ; un pickup exécute une marche arrière furieuse, grimpe sur la pelouse où il laisse sa trace et part dans un couinement de boîte de vitesses. Sur la portière, elle reconnaît le sigle bleu de l’ONUDC. D’instinct, elle ressort, se précipite vers sa Méhari et prend en chasse la voiture mais les deux véhicules ne jouent pas dans la même division. L’autre est déjà loin et file dans la direction du fleuve. Magali fait hurler son tacot où elle est secouée comme un yoyo. Devant elle, tout au bout de l’avenue, le bolide bouscule des plots et emprunte le pont malgré les grands gestes d’ouvriers. Le tablier est désert, le pickup file... et disparaît. Il y avait une voiture et il n’y a plus rien. Avant, après. Ça s’est passé comme ça, tout d’un coup, comme un jeu de passe-passe. Pourtant l’édifice est long, interminablement long même ; la camionnette a beau être surpuissante, elle n’a tout de même pas pu en venir à bout aussi vite. Et elle ne s’est pas envolée non plus. Bêtement Magali fixe le ciel, revient sur terre. Par quel tour de magie l’engin s’est-il volatilisé ? Le temps d’arriver à l’entrée du pont, elle se heurte à des employés surexcités qui redressent les dispositifs de signalisation et font barrage en hurlant. On ne passe pas. On ne passe plus, très exactement. Magali réalise que le pont est en réfection, des pans entiers du tablier manquent ; un peu comme un damier géant où les cases noires donneraient sur le néant ; des grues monumentales sont en train d’installer de nouvelles plaques d’acier là où pour l’heure il n’y a plus que de grands trous ; c’est dans un de ces abîmes que le pickup s’est engouffré. La machine est tombée dans le vide. Vue imprenable sur la mort.
Depuis plusieurs jours, le temps des travaux, la circulation est détournée ; elle passe par le lit du fleuve qui, ici, est presque à sec ; la Méhari exécute une marche arrière, descend lentement sur la rive et se trouve bloquée par une caravane de voitures à l’arrêt. Les chauffeurs, fascinés, contemplent le pickup renversé, encastré entre deux énormes rochers ; le véhicule des flics arrive assez vite, le commissariat est tout proche. Papa est à son bord. Magali abandonne sa Méhari dans l’embouteillage et veut rejoindre le commissaire ; la police craint l’incendie et tient le public à distance. Seul Papa s’approche de la carcasse, inspecte, bavarde avec un de ses collaborateurs qui a ramassé un sac tombé de la voiture et le lui tend. De retour, le flic repère Magali :
« Ecrabouillée ! C’est Fernande ! Fernande Bandiaga ! Vous la connaissiez, je crois ?
« Fernande ?!
« On ne peut plus rien pour elle, croyez moi. Allons au commissariat, si vous voulez bien.
Magali est bouleversée. Elle était avec Fernande ce matin encore, dit-elle. Le flic semble au courant. Elle lui parle aussi de Battisti, de la mort du représentant de l’ONUDC. Là, Papa accuse le coup. Il rassemble aussitôt une équipe et passe par l’agence, invitant la pigiste à l’accompagner. Curieusement, il garde à la main la sacoche qui devait appartenir à Fernande. Des collègues arrivés entre temps forment un cercle autour du bureau de Battisti. Personne n’a osé le toucher. Le commissaire ne s’attarde pas ; il confie l’enquête à un adjoint. Pas Issiaka Dembelé, invisible, un autre de ses collaborateurs. La jeune femme cherche la chatte, elle est invisible. Papa et Magali se retrouvent, seuls, assis dans une voiture de police à l’arrêt sur le parking d’où Fernande s’est enfuie tout à l’heure. Au sol et sur un bout de pelouse, on distingue nettement les traces de la voiture qu’elle a dérobée. Le commissaire fouille machinalement dans le bagage de Bandiaga, manipule un boubou jaune pétant. Magali tremble un peu :
« C’est elle qui l’a descendu, non ? Vous vous rendez compte ?! En tout cas, c’est elle qui sortait de son bureau.
Papa ne réagit pas, Magali est agacée.
« Plus rien ne vous étonne, vous ?!
« Oui et non. Ecoutez, on avait Mlle Bandiaga dans le collimateur, Battisti et moi, mais on n’avait rien pu prouver.
« Fernande ? Vous soupçonniez Fernande ?
« On savait que les Colombiens de la « Famiglia », la famille comme ils disent, un clan redouté de trafic de drogue, on les savait très actifs en Afrique de l’Ouest, au Mali ; on avait appris aussi par un repenti que leur homme à Kayes était une femme, mais sans plus de précision. Fernande était une fille de bonne famille, elle avait un casier vierge mais elle fréquentait depuis plusieurs mois de drôles de lieux, à Bamako ou ici.
« Vous aviez des doutes et vous m’avez laissée entre ses pattes ?
« Oui, vous étiez notre chèvre, ma chèvre. La chèvre de monsieur Séga !
Il faillit rire puis se ressaisit aussitôt, se faisant violence :
« Excusez, c’est plus fort que moi. Désolé. Désolé surtout pour Battisti. J’appréciais beaucoup ce gars, un type doué, un besogneux aussi, un vrai flic ; on travaillait bien avec lui. »
Magali songe à son « amie », son ex-amie ; elle n’avait rien senti venir :
« C’est elle qui m’a cherchée ; dans le train, mardi dernier... D’ailleurs vous étiez là, vous aussi ? Elle écrivait un mémoire, disait-elle, sur Transfer...
« Je crois surtout que les Colombiens se demandaient ce que vous faisiez là, vous, la Française. Fernande avait sans doute pour mission de vous coller au train, et de savoir ce que vous vouliez ? Pour le compte de qui ? D’apprendre aussi où en était l’enquête sur Graffin. A mon avis, ils voulaient savoir ce qu’on savait ; ils pensaient le savoir par votre intermédiaire et prendre le cas échéant les contre-mesures nécessaires. C’est sans doute comme ça qu’ils sont remontés à Battisti.
Papa récupère dans une glacière à l’arrière du véhicule deux cannettes de bière, blonde, en offre une à Magali, boit, soupire, continue.
« François Graffin, je vous l’ai dit hier soir je crois, était depuis des mois sous la pression des narco-trafiquants. La police avait été mise au courant par son entourage à Transfer. Les Colombiens s’étaient livrés à différentes approches, insinuations, propositions, chantages. Il avait eu du mérite à résister... »
Et la semaine dernière, au routier « L’harmattan », c’est elle, Fernande, qui était là pour le voir...
« Le boubou jaune pétant !
« Exact. Elle voulait effectuer sans doute un bout de voyage avec lui, lui faire de nouvelles avances. C’était elle qu’on aperçoit sur la photo. Moi, je n’ai pas tilté en regardant le cliché mais Battisti, lui, a compris tout de suite quand il l’a vu ; et il vous a appelé aussitôt. Enfin, ce matin, aux aurores, c’est ça ?
Sans attendre de réponse, il poursuit :
« L’autre soir, à L’Harmattan, Fernande était sans doute chargée d’une nouvelle et ultime proposition, sonnante et trébuchante, à Graffin ; ou alors elle le menace carrément. En tout cas, pour que l’organisation la délègue en personne, la dévoile ainsi, la grille en quelque sorte, il fallait qu’ils soient déterminés à emporter le morceau coûte que coûte. Et vite. Ils devaient avoir peur de la concurrence.
« La concurrence ?
« Oui le marché de la coke attire une sacrée faune ; on parle des Nigérians qui sont des durs en affaires, et connaissent bien le terrain ; on a même vu dans le coin des Pakistanais qui ont des ambitions sur la zone...
« Le meurtre de Graffin pourrait avoir été commis par un de ces concurrents ?
« Non, je ne le crois pas. Bien sûr, je n’étais pas à L’Harmattan l’autre soir. Ce qui s’y est passé exactement ? Difficile à dire. D’abord, ce chauffeur, le vieux, personne ne le connaît. Et ce zèbre semble avoir fait du zèle, il s’est comporté comme un garde du corps. Mais elle, Fernande, ou les siens, ont dû intercepter plus tard la voiture, se saisir du boss de Transfer, le trucider de la manière qu’on sait et buter le chauffeur ensuite en escamotant la voiture ; c’est le scénario le plus probable. Fernande est morte et, comme on dit chez nous, « Lorsque la tête du serpent est coupée, le reste n’est qu’une corde... »
Paternel, il pose sa patte sur les genoux de Magali :
« Le seul truc positif de cette journée de merde, chère demoiselle, c’est qu’on va pouvoir à présent libérer Tiécoura Traoré. D’accord ?
La fin d’après-midi au commissariat est très agitée. Papa mobilise ses troupes pour rameuter les journalistes et organiser une conférence de presse, ouverte aux correspondants étrangers présents à Kayes dans le cadre d’un salon du tourisme. Devant un parterre plutôt fourni, il fanfaronne :
« Voilà au moins une affaire réglée. Comme vous vous en doutez, nous nous étions servis de l’arrestation de Tiecoura Traore pour tromper l’ennemi. C’était un leurre ; notre ami Tiecoura ne nous en voudra pas trop de ces quelques jours de rétention, je l’espère ; et qu’il me permette de le remercier pour sa collaboration bien involontaire. Lui en prison, la vraie coupable, rassurée en quelque sorte, est sortie du bois et a commis la faute que nous attendions.
Il sourit, attend les questions :
« C’est ce qui s’appelle du flair ? Demande un localier obséquieux.
« En effet.
« Enquête terminée ?
« Enquête terminée. »
Pas la moindre question critique, personne n’émet la plus petite remarque. La mort de Battisti ? A peine évoquée. Les photographes prennent quelques images de la libération, en direct, du docteur Tiecoura, de ses retrouvailles avec Magali. S’il vous plaît, s’il vous plaît, embrassez vous à nouveau. Merci. Papa s’arrange pour être sur toutes les photos. Puis, soudain pressé, il propose à la journaliste et à l’ex-détenu de rentrer sans tarder sur Bamako.
« Un train est annoncé dans moins d’une heure, faudrait pas rater l’occasion. »
Magali veut repasser à l’hôtel, à deux pas de la gare, récupérer quelques affaires mais elle y renonce : on lui signale que se tient devant l’établissement une nouvelle manifestation contre le « voleur de sexe », il y a même une radio libre qui s’est faite l’écho du rassemblement. Tant pis pour la brosse à dents et le dernier Mondoloni.
Chapitre 21
Bamako
Samedi 14h
Les vitres grandes ouvertes, la voiture de Mimi descend la longue rue Banconi, bordée de petites résidences, et débouchant sur l’hippodrome. Sur les trottoirs sont dressées, régulièrement, des palettes pour protéger de jeunes pousses d’arbres. L’autoradio propose en boucle la dernière cassette de Kar-Kar et Racine bat la mesure sur la portière. Soudain la conductrice freine si brusquement que le moteur cale. Elle manque se faire emboutir par un Sotrama, minibus bondé qui les double en beuglant. Racine suit le regard de Mimi. Sur un parking, un peu en retrait de l’avenue, et devant une maison à l’air dévasté, un vieil homme est en train de retirer la bâche qui recouvre son véhicule. Apparaît une splendide Mercedes 300 bleu nuit immatriculée TRANS 2000. C’est très exactement la voiture et le numéro de plaque dont leur a parlé Magali, l’autre soir au téléphone.
Mimi laisse sa Peugeot en plan, sort, crie :
EMILE ?! EMILE BENHYAHIA ?!
Le type, un quinqua chauve, mince collier de barbe grise et portant un costume de toile de la même couleur exactement que sa voiture, la regarde, se fige, gardant la housse dans ses mains. Les yeux fixes, les lèvres pincées, manifestement, il est sur ses gardes et attend la suite. Mimi s’approche de lui avec les précautions d’un chasseur de grand fauve qui ne veut pas effaroucher sa proie, Racine suit. Mimi tente de retrouver en cet homme les traits de l’expert du film d’Ousmane Sembene ; elle a un peu de mal, il y a si longtemps.
« On peut parler ? On va chez vous ? C’est ici ?
L’homme murmure, sans vraiment leur parler, « Allah me suffit, il est mon meilleur garant », puis il désigne la maison qui leur fait face et qui semble à l’abandon. Ils entrent, les pièces sont vides ; seul un canapé défoncé a survécu ; les deux visiteurs s’y assoient, l’homme de la Mercédès reste debout. Racine joue franc jeu, direct. Il assure qu’ils ne sont pas des flics, simplement ils veulent comprendre, ils souhaitent lui poser quelques questions.
« Puis on part, ok ?
L’autre ne dit rien, il hoche à peine la tête.
Mimi enchaîne :
« Vous êtes Emile Benyahya, fils de Samaké Benhyaya. On pense que vous avez tué le général Danian, en 1978. Encore une fois, on a peu de sympathie pour le disparu ; on est même révolté par l’affaire de Thiaroye et on pense - elle regarde Racine qui approuve - que vous avez bien fait. Voilà ! C’est dit !
Elle fait une pause, l’afflux de mots et l’émotion l’étouffent un peu.
« Donc, comme l’a dit mon ami Racine, on ne vous retiendra pas. On veut juste ne pas mourir idiot.
On dirait qu’elle s’adresse à un enfant ou un malade en phase terminale. Un rire nerveux les saisissent tous les deux, Racine et Mimi, leur hôte reste impavide.
« On va vous raconter un bout de votre histoire, comme on l’a comprise ; vous nous direz si on se trompe ? Il y a des morceaux qui manquent ; là, on aimerait votre aide. Et vous pourrez donc partir quand on aura fini. J’ajoute que non seulement on ne vous retiendra pas mais on ne préviendra personne. OK ?
Le silence qui s’installe entre ces tirades est particulièrement tendu. Mimi parle donc de la visite de Danian à Bamako, en 1978, de l’aéroport, du taxi, de la blague et de la rage, du meurtre, des WC de la gare, de la chéchia. L’autre écoute, regarde alternativement ces deux intrus, s’impose une sorte de détachement. On le sent à cran.
Racine continue :
« On pense aussi que vous vous êtes vengés plus récemment du PDG de Transfer, qu’on appelle le flamand rosse. A mon avis, après la mort du général, vous allez, au fil des ans, oublier ou presque cette histoire. C’est à peine si elle vous hante de temps à autre par des rêves de règlements de compte. Je me trompe ?
L’autre opine du bonnet, semblant dire p’têt bin que oui, p’têt bin que non, mais continuez, allez, continuez.
« Jusqu’au jour où vous décidez de remettre ça, trente ans plus tard. Pourquoi ? Mon hypothèse : il y a quelques semaines, vous avez en effet le sentiment que tout recommence. Vous attendez, toujours dans votre taxi, à l’aéroport ; un toubab grimpe dans votre voiture. Il voit votre nom sur le compteur et refait la méchante blague du « Y a bon Benyahia ». Vous fâchez pas, OK ? On fait juste que raconter une histoire. Bien. Vu la réputation de Graffin, il doit « plaisanter » de manière tonitruante, à la façon du colon fier de lui et dominateur, de sorte que toute la colonne des taxis, toute l’assistance des clients en profitent :
« Y a bon, Benyahia ?! » Et il rigole, le con, imité par quelques touristes. Les Maliens eux sont plutôt indignés, non ? Cette blague, on ne vous l’avait plus faite depuis des lustres ; vous étiez devenu un homme presque apaisé et voilà que toute votre énergie noire resurgit : ce mauvais jeu de mots agit comme un mot de passe.
L’autre s’adosse au mur, il semble plus concentré, il sent aussi que l’affaire va durer. Le fait que ses « invités » soient si bavards, étrangement, le tranquillise un tout petit peu.
« Vous encaissez ! D’une manière ou d’une autre, vous avez vu son nom. Graffin ! Toute l’histoire de Thiaroye revient, d’un coup, en vrac, en vagues puissantes, un vrai glissement de terrain. Votre père a souvent parlé de Danian, certes mais aussi de ce capitaine Graffin Edmond, celui qui avait dirigé la brillante opération de reconquête du camp. Alléluia ! Vous avez loupé le père, vous voilà en présence du fils. Il était au Mali depuis quelque temps déjà ; vous aviez peut-être vu son nom dans la presse mais vous n’y aviez pas prêté attention ni fait le rapprochement. Ce jour de la prise en charge à l’aéroport, vous ne pouvez pas lui réserver le même sort qu’au général. Graffin est un géant, le général était un petit gabarit ; vous, de votre côté, vous avez vieilli. Et puis son arrivée se passe en plein jour, l’autre était arrivé de nuit...
Alors, vous faites la course comme si de rien n’était mais ensuite, c’est à dire les jours suivants, vous allez le pister ; ça, c’est pas trop difficile pour un chauffeur comme vous. Certes c’est du gros gibier, une huile, toujours protégé, accompagné, épaulé... mais vous ne vous laissez pas décourager. Votre haine est revenue, intacte, obsessionnelle. Ce règlement de comptes par fils interposés vous exalte. Ce n’est pas simple d’approcher ce genre de prédateur mais vous finissez par connaître ses moindres habitudes, ses fréquentations nombreuses, ses déplacements...
L’homme, à présent assis sur ses talons, exprime non seulement une infinie patience mais aussi une attention étonnée.
« Et une idée vous vient, simple, géniale, celle de remplacer son chauffeur.
Le barbu, soudain, est pris d’une quinte de toux ; il s’époumone, expectore, se ressaisit et fait un vague geste d’excuse.
« Par quels moyens vous récupérez la place du chauffeur habituel ? Ça, on ne sait pas : vous allez le corrompre ? ou le menacer ? Ou faire donner la magie ? En tout cas, ça marche et vous allez conduire la voiture du boss ce fameux dimanche soir. Vous avez de la chance, le patron ne vous reconnaît pas, mais pourquoi reconnaitrait-il d’ailleurs un simple chauffeur de taxi, croisé à l’aéroport des semaines ou des mois plus tôt ? À mi parcours, dans un routier nommé L’Harmattan, vous le droguez, puis vous l’exécutez lors d’un cérémonial un peu compliqué, chapeau et compagnie. Vous vous dites, sans trop y croire, que les tensions à l’intérieur de Transfer peuvent vous aider, sa mise à mort pourrait passer pour un acte de vengeance sociale. Sans trop y croire ni sans trop se cacher non plus, d’ailleurs. Le chapeau rouge, c’ est tout de même une signature, non ? Ou un signe, adressé à qui ? A votre père ? Voilà, j’ai fini.
Fin de la narration. Un silence électrique envahit la pièce dévastée. Seul bruit de fond, le passage incessant des véhicules sur la route toute proche de l’hippodrome. Chacun attend que l’autre se manifeste. Finalement l’homme au complet bleu se redresse lentement et dit juste :
« J’ai quelque chose à vous montrer, vous permettez ?
Il sort ; les deux attendent. On entend le ronronnement d’un moteur qui s’éloigne lentement et se fond dans le trafic :
« Il se tire ! Dit Mimi.
Elle regarde Racine, hausse les épaules.
« C’est ce qui était prévu, non ?
Chapitre 22
Bamako
Dimanche, 10h
Magali et Tiecoura sont de retour dans la matinée après un trajet miraculeusement sans problème. Ils retrouvent au maquis « Bolche vita » leurs compères Mimi et Racine. Ce dernier est en train de ratiociner sur la polygamie avec un grand serveur plutôt complaisant :
« Finalement, c’est facile de critiquer ça vu de loin. La réalité n’est pas aussi simple, c’est pas un bloc, il faut voir les nuances. Bien sûr, à Paris, on a vite fait de trancher mais ici... Ça demande de réfléchir un peu ; moi je trouve qu’il n’y a pas que des inconvénients. »
Magali, qu’il n’a pas encore remarquée, reprend la balle au bond :
« Et puis, plusieurs mecs, c’est pas mal non plus...
« Je te parle moi de polygamie.
« Prends le Larousse, mon grand. Polygame : se dit d’un homme marié à plusieurs femmes ou - OU, OK ? - d’une femme mariée à plusieurs hommes, simultanément bien sûr.
Tiécoura Traoré, mine de rien, apporte sa touche, subtile, comme d’habitude. Pour cet expert en abeilles, « la nature est encore plus compliquée ; ainsi on dit d’une plante qu’elle est polygame si elle possède des fleurs hermaphrodites et des fleurs unisexuées, mâles ou femelles, sur le même pied...
Ce préambule réussi, Magali raconte la libération de Tiécoura, l’histoire de Fernande, l’infiltrée ( « Vous vous rappelez cette fille qui t’avait invité à danser, Racine, ici même »), la responsabilité des « Colombiens », les retournements de « Papa »...
Mais Racine aussitôt rectifie : vive la libération de Tiécoura, dit-il, et les « Colombiens » ont peut-être, via Fernande, buté Battisti, paix à son âme mais c’est pas eux qui ont « fumé » Graffin :
« Il n’est pas mort pour une affaire de drogue, le Flamand ! Il est la dernière victime d’une vieille histoire coloniale. »
Et, épaulé par Mimi, il détaille longuement leur propre enquête.
Magali est sidérée, consternée, ébaubie. Le réquisitoire de son libraire préféré est implacable. Magistral. En conversation avec « Papa » qui s’assurait qu’ils étaient bien arrivés à Bamako, elle lui fait part du récit de Racine. Le Flamand aurait payé pour son père qui lui-même était le capitaine de la garnison de St Louis qui, en 1944... Elle refait l’histoire et suggère qu’il serait peut-être bon de démentir la version donnée publiquement à Kayes, la veille. Mais Papa n’est pas chaud. Et aligne sans peine quelques arguments. Danian ? Plus personne n’y pense, à quoi bon rouvrir ce dossier ; et puis Fernande est une tueuse crédible de Graffin. « Elle a bien descendu Battisti, oui ou non ? Oui ! » On lui reproche un crime avéré, on peut très bien lui en coller deux.
« J’ajoute, conclut le flic, définitif, que les autorités ont souvent été accusés de laxisme face au trafic de drogue ; ils ont ici une occasion en or de montrer leur détermination. J’ai déjà reçu les félicitations de la Présidence et même de plusieurs capitales, on ne va pas bouder ce plaisir. Quant à votre « coupable », enfin, cet Emile Benmachin, il est où au juste ? Envolé. Comment je pourrais justifier ma volte-face, moi ? Et avec quelles billes ? Non, non, vraiment, pas question de bouger. Après tout, l’important pour vous, c’est que le docteur Tiécoura soit libre, n’est-ce pas ?
Chapitre 23
Kadiolo, frontière avec la Côte d’Ivoire
Dimanche
La Mercédès approche de la douane. Le vieil homme noir à la barbe blanche sourit. Mais il y a plus de mélancolie que de joie sur son visage. Il serre le volant et bredouille : « Gloire à Allah qui a mis cela à notre disposition car nous n’aurions rien pu faire de nous mêmes. Et c’est vers lui que nous devons nous tourner. »
D’habitude, c’est toujours un peu compliqué le passage ici mais lui n’est pas trop inquiet, il connaît, par leur nom et prénom, tous les fonctionnaires du poste, des deux postes, des deux côtés. Et puis c’est de toute façon un tel bordel chez les voisins : les Ivoiriens ont autre chose à faire que de s’occuper des papiers d’une voiture immatriculée au Mali. Inch Allah !
L’homme parle :
« Tu es vengée, Bintou, ma puce !
Il tend le bras, ne rencontre que du vide ; il parle à un fantôme qui aurait pris la place du mort.
« Tu les as entendus, l’autre avec son toubab, à Bamako, tout à l’heure ? Quels zozos, non ?! Des martiens ! T’as compris quelque chose, toi ? Moi, ton père, j’ai compris qu’ils m’ont pris pour un autre, oui ! Ils m’ont pris pour un certain Emile Benyahia ou Banania... Si, si, c’est vrai, ils m’ont pris pour lui. J’ai connu, il y a longtemps, un chauffeur, dans le quartier, qui avait ce nom ; mais ça remonte à des années, je ne sais vraiment pas ce qu’il est devenu. Quel roman ils m’ont fait ?! Des histoires de camp, de guerre. Jamais entendu parler ! Remarque : ils ont peut être raison pour le vieux, le général ; il a sans doute été tué comme ils disent ; ça, c’est pas mes affaires, mais pour le Flamand, alors là, ils étaient à côté de la plaque. Enfin pas tout à fait... Ils ont senti des trucs, c’est sûr, l’histoire du conducteur que je remplace, la Mercedes, là, ils ont visé assez juste... Ils se sont approchés du but. Comme on dit dans ce jeu d’enfants où on cherche un objet caché, là ils « chauffaient » ; ils brulaient pas mais ils chauffaient. Mais pour le reste, ils se sont trompés d’histoire. Marrant ce mélange de vrai et de faux. Devraient écrire des livres ces deux-là au lieu de harceler les pauvres gens. Alhamdoulilah !
De part et d’autre de la chaussée, des rangées de Néscafé attendent le client. Devant la Mercédès, une file de camions est détournée vers un parking proche par des douaniers maliens. Grève du zèle ? se demande le vieil homme qui poursuit son monologue :
« T’as vu, Bintou, ils m’ont pas laissé parler... Et blablabla, et blablabla... De toute façon, j’aurais rien dit ! J’avais rien à leur dire. Pourquoi étaient-ils si sûrs d’eux ? Etonnant, non ? A cause de la voiture, je crois bien ? Dès qu’ils l’ont vue, ils étaient persuadé de leur coup ; pour eux, j’étais Emile Banania ou Benyahia, puisque que j’avais la Mercedes 300 bleu, point ! Quand on a une idée derrière la tête, c’est terrible, non ?
Le passage semble s’accélérer à la douane, reste à peine trois véhicules devant lui avant d’arriver à la guérite, une camionnette avec deux zébus sur la plate-forme et deux dourounis, Peugeot 504 sans âge où s’entassent de jeunes femmes, des tchatchos, croit-il voir, ces femmes qui se blanchissent la peau. Lamentable.
« Si j’avais décidé de parler, si j’avais choisi de me confier, si, si... j’aurais pu leur dire que la fin du Flamand ne correspond pas complètement à ce qu’ils ont dit ; j’aurais parlé de toi, ma fille, ma gazelle, mon enfant, mon amour ; toi qui t’es laissée séduire, envoûter par ce porc de PDG ; j’aurais parlé de ce chacal qui te poussait toujours plus loin dans ses petits jeux dégueulasses, cette ordure qui aimait te ligoter, te ficeler, te saucissonner, mais pourquoi jouais-tu ce jeu avec lui, toi ? Pourquoi acceptais-tu tout ça, ma Bintou ?! Par peur ? Pour plaire ? Pour faire comme les autres ? Ne me dis pas que t’aimais ça ?! Un jour, il t’étrangla, le mécréant, comme une merde, par jeu dira-t-il plus tard ! C’est un toubib de Kayes, celui qui s’est occupé de ton cas, qui me l’a dit. Ce médecin, à mon avis, quand il a appris la fin de Graffin, il a dû comprendre. Et penser à moi très fort. Mais il ne dira rien, j’en suis sûr !
Déjà le vieil homme prépare ses papiers, son tour va arriver.
« Et bin, moi aussi, j’ai fait mon « bondage » comme ils disent ! Bondage sauvage ?! Un bondage équatorial ! Ferroviaire ! Il aimait la ficelle ? Il aimait attacher ? Alors, il en a eu de la ficelle, le cochon ! Et puis, il en a eu des attaches. Un vrai saucisson qu’il était devenu. Paraît aussi que dans ses soirées, il aimait courir à poil avec sa chéchia. Alors moi, je lui en ai trouvé une belle, de chéchia, bien rouge, bien raide, bien droite. L’animal a eu sa ration !
Un douanier s’approche. C’est à lui de passer, il tend ses documents au jeune fonctionnaire souriant, Ray ban sur le nez, deux dents en or bien en vue.
« Quand je pense à ce couple, à Bamako ! Une seconde, j’ai eu peur. Juste une seconde. Je croyais qu’ils m’avaient vraiment démasqué. Qu’ils voulaient me faire chanter. Les pauvres ! Qu’ils gardent leurs idées, ils n’ont pas besoin de savoir. Pas vrai, ma puce ?
L’agent, qui regarde à peine son passeport, lui fait signe de circuler. Inch Allah.
Chapitre 24
Dans l’avion Bamako-Paris
Lundi
Magali a serré la main du steward. Elle ne fait jamais ça d’habitude. Elle prend l’avion depuis des années, et une telle idée ne lui était encore jamais venue. Elle ne s’explique vraiment pas son geste. L’autre, au bout du couloir, dans l’encadrement de l’espace « cuisines », montre sa pogne à deux de ses collègues. Il a l’air contrarié. Tous trois regardent Magali, les sourcils en accents circonflexes. Gênée, la jeune femme gesticule. Racine sort son nez d’un polar de Slocombe, il la regarde :
« Ça va pas ?
« Tu sais ce que c’est un voleur de sexe ?
« Un quoi ?!
« Je vais te raconter.
FIN